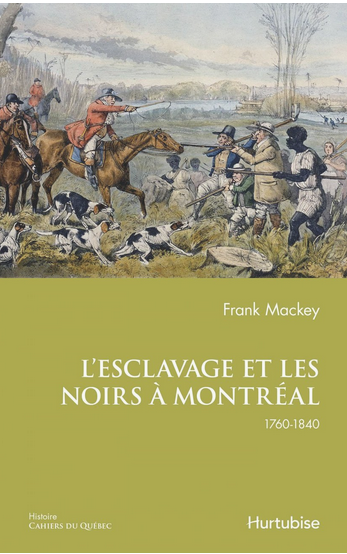Frank Mackey aborde une question peu présente dans l’historiographie : les Noirs dans l’histoire du Canada.
L’auteur veut réparer un oubli et son étude pose la question de la place des esclaves dans la société canadienne de 1760 à 1840.
Dans son introduction, l’auteur explique longuement les difficultés rencontrées pour définir qui est Noir. « Les documents ne nous disent pas toujours explicitement qui était noir » (p.39) d’autant que les mariages interraciaux n’étaient pas rares.
Plus qu’une étude de l’esclavage, le propos vise à rendre une place aux Noirs libres et non-libres dans la société montréalaise au début de l’administration britannique.
Quel esclavage ?
Le questionnement part d’un jugement, dans les années 1840-1850, à Saint-Louis. La question traitée concerne l’existence ou non d’esclaves en Nouvelle-France, avant la conquête anglaise. La consultation des témoignages, contradictoires, permet de tenter de cerner un fait, à la fois banal et très peu présent. Certains affirment n’avoir jamais vu d’esclaves, quand d’autres décrivent des exemples précis. La situation est cependant très différente de celle des Antilles ou du sud des États-Unis, des esclaves bien traités et ayant une liberté de déplacement. Il existait des Noirs au Québec, souvent domestiques, esclaves, mais aussi des hommes libres. Certains esclaves sont des Panis, des Amérindiens.
Quelques textes, antérieurs à la conquête anglaise, affirment le droit de posséder des esclaves, mais le « code noir » ne s’appliquait pas en Nouvelle-France. L’auteur évoque quelques exemples tel le premier esclave noir, Olivier Le Jeune, arrivé à Québec en 1628 ou Mathieu Léveillé, esclave de Martinique devenu bourreau en Nouvelle-France en 1730.
Les archives judiciaires montrent qu’aucune loi ne régissait l’esclavage en Nouvelle-France. Les choses changent peu sous le régime britannique.
Une abolition graduelle de l’esclavage
L’étude des dossiers juridiques montre une abolition graduelle. La réunion de sujets noirs à Montréal, en 1833, alors que se discute à Londres l’abolition de l’esclave, atteste d’une situation beaucoup plus favorable que celle qui prévalait aux Antilles anglaises. Déjà en 1793, une forme d’abolition avait été votée pour le Haut-Canada. Pour le Bas-Canada, la province du Québec devenue anglaise après 1763 dès 1787, il est fait mention de la nécessité d’interdire l’introduction d’esclaves puisque contraire à la constitution britannique. L’auteur décrit les tentatives législatives comme le projet d’Adam Mabane. Malgré l’échec, on ne constate ni vente, ni condamnation d’esclave en fuite après 1800, malgré les protestations des propriétaires, dont la dernière offensive date de 1803.
Un recomptage perpétuel
S’il rend hommage au travail précurseur de Marcel TrudelDeux siècles d’esclavage au Québec, Biblothèque québécoise, 2021, Nouvelle édition, l’auteur en montre les limites concernant les Noirs. À partir de quelques cas étudiés en détail, il montre la difficulté à comptabiliser cette population, car un même individu change de prénom et de nom, au fil du temps, selon les actes d’état-civil.
D’après le recensement de 1784, sur environ 100 000 habitants du Bas-Canada, 304 étaient esclaves, sans doute Amérindiens pour les deux tiers, désignés sous le terme de Panis. L’auteur évalue à 40 le nombre de Noirs à Montréal, à cette date, esclaves ou libres.
Il y a une réelle difficulté à définir qui était noir ? Était-il libre ? Avait-il été esclave ? Tout dénombrement semble illusoire.
« Ce qui se passait autrefois »
Dans ce chapitre, l’auteur tente de décrire la vie de l’esclave, assez différente de l’image que le lecteur en a quand il fait référence à la situation des esclaves aux Antilles ou dans le sud des États-Unis.
L’esclavage est une réalité admise à l’époque, peu nombreux en l’absence de grandes plantations, ils sont peu visibles.
L’étroitesse du marché et le climat ont, sans doute, empêcher un commerce organisé. La vente d’un esclave est occasionnelle. L’exemple du distillateur John Lagorde est une exception avec huit transactions entre 1786 et 1789. Les maîtres ont rarement plus de deux esclaves, généralement des domestiques. Tous n’étaient pas riches, on trouve, parmi les maîtres, des boulangers, des aubergistes, des religieux ou des militaires.
La dispersion des esclaves n’a pas permis l’émergence d’une culture, ni de révoltes collectives. Il semble que la situation d’un esclave noir et celle d’un Noir libre ait été assez proche et la violence contre les esclaves rarissime. Les affranchissements, à la mort du maître furent nombreux.
L’auteur évoque quelques cas particuliers : servitude volontaire par contrat, cas des esclaves faits prisonniers pendant la Guerre d’Indépendance.
Le passage de la servitude à la liberté
Certes, la liberté améliore le sort des anciens esclaves, mais les possibilités d’émancipation sont réduites. Après leur affranchissement, beaucoup restent au service de leur maître. Certains parvenaient à acheter une maison ou une petite terre. Il semble que ce soit plutôt le cas de Noirs libres récompensés pour leur loyauté à la couronne pendant la guerre.
D’autres ont pu profiter, pour s’installer, des compétences acquises en esclavage comme Caesar Johonnot, venu de Boston, qui s’installe à Montréal en 1788 comme gérant de la Montréal Distillery Compagny.
L’auteur étudie les transactions immobilières. Quelques esclaves deviennent propriétaires, plutôt à l’extérieur de la ville. Le cas de John Trim qui fut l’un des pionniers de la communauté noire, fait l’objet d’une longue étude.
Sur les bateaux à vapeur et autres emplois
Au début du XIXe siècle, les Noirs ont trouvé un emploi de serviteur sur les bateaux qui assurent la liaison entre Montréal et Québec. Quelques exemples sont présentés en détail comme celui de Robert Ashley et ses gendres.
L’emploi est saisonnier et comme pour tous la recherche d’un emploi est importante. L’auteur cherche à reconstituer la liste de leurs divers métiers : employé de service dans les hôtels, cuisinier, cordonnier, barbier… souvent à la journée. Des emplois subalternes, bien sûr, mais certains se sont distingués. La négritude des frères William et Henry Blake (médecin et notaire) n’est pas certaine.
Quelques emplois publics recrutent comme Henry Moore engagé pour inspecter les cheminées.
L’auteur présente leur place dans l’artisanat et le travail agricole en périphérie de la ville. Quelques-uns ont participé à la traite des fourrures comme les frères Bonga dont les parents avaient été affranchis par le capitaine commandant du fort de Michilimackinac à son départ de ce poste.
Enfin, est évoquée la situation des Noirs dans l’armée.
Aux urnes, citoyens
Les Noirs bénéficiaient, sur le papier, des mêmes droits que les Blancs, mais la situation étaient en fait différente.
S’ils étaient exclus de la fonction publique, à partir des années 1820, ils pouvaient voter librement. L’étude, dans le Comté rural de Bedford et à Montréal, précise le niveau de possession nécessaire pour être électeur. On peut noter que les femmes aussi avaient le droit de voteavant de la perdre entre 1934 et 1836, puis après 1849., même si elles sont peu nombreuses à l’exercer.
La description des conditions du vote étonne, les bureaux sont ouverts, à Montréal, entre le 8 et le 20 mars.
Les Noirs sont électeurs, principalement dans le quartier Est de la ville. Il est difficile de déterminer à quel camp ils pouvaient se rallier, notamment durant la révolte des patriotes. Par contre, on sait qu’ils se sont mobilisés au moment du vote, à Londres, de la loi sur l’abolition de l’esclavage.
Rendre Justice
Si aucun n’a été convoqué pour faire partie d’un jury dans une administration « résolument blanche »(p. 379), l’auteur rappelle leur rôle comme bourreau comme Mathieu Léveillé, une pratique continuée sous le régime britannique avec Georges Burns, Benjamin Field… dont l’auteur retrace les carrières.
Il décrit le fonctionnement de la Justice, les châtiments prononcés et notamment la peine de mort.
Les délits commis par les Noirs sont plutôt mineurs et la Justice, à leur égard, semble assez équitable. L’étude de l’affaire Betsy Freeman montre que « la Justice ne faisait d’aucun préjugé racial »(p. 413).
Coude-à-coude
Dans ce chapitre, il est question d’apprentissage et de mariage. L’auteur étudie les contrats d’apprentissages : maître blanc et apprentis noirs, mais aussi maîtres noirs et apprentis blancs.
Les mariages interraciaux analysés ne concernent pas ceux impliquant une ou un autochtone qui demanderait une étude à part. Les mariages étudiés jusqu’en 1840 concernent la classe ouvrière, une vingtaine, où la couleur de peau ne semble pas être importante. Si une certaine égalité s’exprime dans ces mariages mixtes, les Blancs « persistent à voir toutes les personnes à la peau foncée ou aux traits négroïdes comme des “Noirs” indifférenciés sans égard à leur lieu de naissance ni à leurs origines ancestrales et à les exclure d’une participation pleine et entière à la société » (p. 464).
Mille personnages en quête d’auteurs
Les Noirs ne constituent pas un groupe suffisant pour faire communauté. Il faut attendre 1863 pour voir se créer une première association : la St Augustine Society.
Ce dernier chapitre montre l’écart entre le ressenti blanc qui les désigne sous le terme de « nègres de nation » et le sentiment identitaire des personnes de couleur aux origines souvent différentes. Les projets de migration vers la Jamaïque, après 1840, furent sans succès.
Des notes très abondantes et une large bibliographie complètent l’ouvrage.
L’étude repose sur une documentation extrêmement riche et variée qui, si elle donne parfois dans l’anecdote, permet de dresser un portrait des Noirs au Québec du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle.