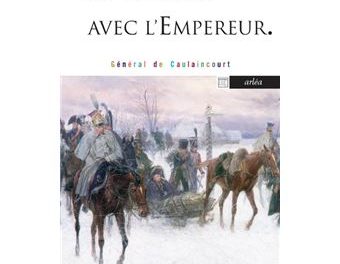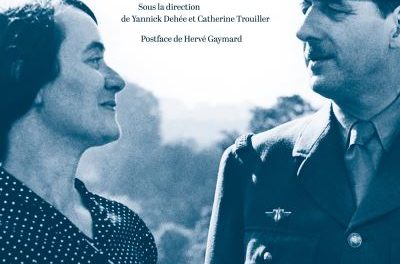La Guerre d’Indépendance espagnole (1808-1814), appelée aussi Guerre contre les Français (Guerra del Francés) ou Guerre Péninsulaire, est un des rares moments de l’histoire espagnole enseignés à l’école, même s’il n’en est implicitement question qu’à travers les toiles emblématiques de Goya exposées au Musée du Prado à Madrid (les « Dos » et « Tres de Mayo ») et, éventuellement, les scènes que le peintre croqua dans « Les Désastres de la Guerre ». L’historiographie française n’a pas, non plus, négligé le sujet, si l’on s’en tient à la production des dernières décennies : on peut par exemple s’en faire une bonne idée avec l’ouvrage, à maints égards pionnier, de Jean-René Aymes consacré à « L’Espagne contre Napoléon. La Guerre d’Indépendance espagnole (1808-1814) », publié en 1973 et réédité en 2003, ou plus récemment avec la thèse éditée en 2001 de Richard Hocquellet, « Résistance et Révolution durant l’occupation napoléonienne en Espagne, 1808-1812 ». Quant à l’historiographie espagnole elle est, évidemment, d’une incomparable richesse. Et pourtant, comme le remarque l’historien Lluis Ferran Toledano Gonzalez, on est encore très loin d’avoir épuisé le sujet, des lacunes notables subsistant en particulier quant au sens profond des projets politiques napoléoniens pour l’Espagne.
L’on doit donc se réjouir de la publication des actes du Colloque international qui s’est tenu en avril 2008 à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence dans le but d’ « approfondir [le] rapport entre régénération et révolution en 1808 » (p. 6), la régénération étant ce concept français, utilisé par les partisans de Joseph Ier, renfermant le projet réformiste de « régénérer » la veille monarchie espagnole alors en crise profonde.
À cette époque, la cour d’Espagne n’avait pas bonne presse auprès de l’opinion, en raison des diverses intrigues qui la minaient, à commencer par le conflit qui opposait le Prince des Asturies (le futur Ferdinand VII) à Godoy, le favori détesté, et à son père le roi Charles IV. En mars 1808, l’émeute d’Aranjuez avait chassé Godoy et écarté Charles IV, qui avait ensuite abdiqué en faveur de son fils, Ferdinand. L’Espagne étant alors arrimée diplomatiquement à la France, elle n’avait pu empêcher l’invasion de son sol par les troupes napoléoniennes, Napoléon entendant forcer le Portugal à appliquer le Blocus continental contre l’Angleterre, et la famille royale n’avait pas rechigné quand Napoléon lui avait demandé de se déplacer à Bayonne. Le 2 mai, les Français furent violemment pris à partie par le peuple de Madrid qui voulait empêcher ces derniers d’emmener l’infant Francisco de Paula à Bayonne. La répression organisée par Murat fut impitoyable comme le suggèrent désormais à nos élèves les fameuses toiles de Goya. Charles IV étant finalement revenu sur sa décision d’abdiquer, Napoléon somma Ferdinand de renoncer au trône d’Espagne, à la suite de quoi Charles IV abdiqua une seconde fois, cette fois en faveur de Napoléon qui se chargea de trouver un remplaçant : Joseph Bonaparte, qui devint Joseph Ier. En outre, une constitution fut donnée à l’Espagne (la Constitution de Bayonne n’était en fait qu’une charte octroyée qui, de plus, ne fut jamais appliquée).
La première partie de l’ouvrage « Conception et perceptions du projet impérial pour l’Espagne » permet de creuser quelques thématiques, relatives à un personnage (Napoléon Ier, Joseph Ier, Ferdinand VII), un groupe d’acteurs (le haut clergé espagnol, les afrancesados) ou une région (la Catalogne).
La contribution que Nathalie Petiteau consacre aux « justifications impériales de l’intervention en Espagne » permet d’appréhender les mécanismes décisionnels de l’empereur. Nuançant les conclusions d’une historiographie très sévère à l’égard d’une intervention qui allait, au bout du compte, être fatale à Napoléon Ier, elle souligne combien ce dernier ne s’est pas engagé à la légère en Espagne : il était au départ très prudent quant à l’attitude à adopter face au conflit interne à la dynastie des Bourbons. L’erreur de Napoléon fut finalement d’avoir choisi le parti de Godoy contre celui de Ferdinand, en mars 1808, suscitant de ce fait la révolte d’Aranjuez. La presse française prépara l’opinion à une intervention au-delà des Pyrénées en présentant Napoléon comme le sauveur d’une Espagne minée par les divisions et l’impuissance de la dynastie régnante. Napoléon endossa cette responsabilité lorsque, par la déclaration de Bayonne du 25 mai 1808, il invita les Espagnols à voir en lui « le régénérateur de l’Espagne ».
La politique de régénération allait être mise en œuvre par Joseph Ier auquel Gérard Dufour consacre un bel article. C’est à une esquisse d’histoire comparée que nous invite, in fine, l’historien, puisqu’il fait un parallèle entre le roi Charles III (1759-1788) et Joseph Ier (1808-1813), « roi d’Espagne et des Indes par la grâce de Dieu et la Constitution ». Comme Charles III, Joseph Ier entendit mener un ambitieux programme de réformes, à l’image de ce qu’il entreprit à Naples. Retenons que « jamais l’Espagne ne connut un rythme aussi rapide de réformes dans tous les domaines que sous le règne de Joseph I et, indubitablement, il prit très au sérieux la mission régénératrice que lui avait confiée ou avait semblé lui confier son frère. » (p. 30). Notons qu’il prétendit, au grand dam de Napoléon, agir en souverain d’une Espagne indépendante de l’Empire : ainsi tenta-t-il de reconstituer une armée espagnole digne de ce nom… Gérard Dufour n’hésite pas à conclure que « des deux souverains espagnols ayant d’abord régné à Naples, le plus réformateur des deux fut incontestablement Joseph » (p. 36).
Quant à Ferdinand, « le Désiré », il était l’horizon de ceux qui n’avaient pas fait leur deuil de la dynastie des Bourbons et entendaient restaurer la monarchie de leurs aïeux et l’Ancien Régime singulièrement malmené par les réformes joséphines. Emilio La Parra Lopez montre combien le Bourbon, retenu à Valençay, fut complètement soumis à l’empereur. Alors que ses partisans le présentaient comme l’âme de la résistance espagnole à l’occupation française, Ferdinand cherchait à bien se faire voir de l’empereur, que pourtant il ne portait pas dans son coeur. Comme le souligne l’auteur, « Ferdinand fit passer avant tout autre chose l’obtention de la reconnaissance impériale et le châtiment de Godoy. La régénération de la monarchie espagnole, de ce fait, ne pouvait venir de l’intérieur. » (p. 54) L’attitude de Ferdinand, une fois rétabli dans ses prérogatives royales par Napoléon en 1813, allait confirmer ce point de vue, le roi mettant un acharnement peu commun à détruire la Constitution de Cadix et à instaurer un ordre absolutiste hostile à toute réforme.
On présente encore parfois le clergé espagnol comme étant massivement hostile aux Français. L’affirmation mérite d’être nuancée, comme le montre l’article de Maximiliano Barrio Gozalo relatif au haut clergé espagnol. Jusqu’à la bataille de Bailén (fameuse défaite française en juillet 1808), la majorité du haut clergé, craignant par-dessus tout l’anarchie, accepta le nouvel ordre des choses. Comme le note l’historien espagnol : « lorsque le décret impérial du 4 juin 1808 proclame Joseph I roi d’Espagne et des Indes, les divergences d’une grande partie du haut clergé étaient déjà manifestes : certains acceptent la nouvelle dynastie comme un moyen de régénérer une Espagne malade et d’autres s’opposent à tout ce qui est français et à la moindre réforme. » (p. 61) Si beaucoup de prélats quittèrent leur diocèse à l’arrivée des Français, d’autres préférèrent rester sur place. Comment interpréter leur position? Il n’est pas certain que l’utilisation de termes tels que « collaborateurs », voire « collaborationniste » (p. 69), soit des plus judicieux pour éclairer l’attitude des prélats qui pactisèrent avec les Français. La plupart d’entre eux semblèrent s’accommoder des Français pour éviter un plus grand malheur à leurs ouailles; d’autres prirent le parti des Français en connaissance de cause (comme les « joséphins » Félix Amat, archevêque titulaire de Palmyre, et Ramon José de Arce, archevêque de Saragosse). L’analyse de quatre trajectoires de prélats espagnols permet d’affiner le tableau : l’auteur évoque d’une part deux ecclésiastiques zélés et réactionnaires, Rafael Menéndez de Luarca, évêque de Santander, et Pedro Quevedo, évêque d’Orense, d’autre part deux clercs réputés pour leur caractère éclairé et réformateur, Félix Amat, archevêque de Palmyre et abbé de la Résidence Royale de Saint Ildefonse de la Granja, et Fr. Miguel de Santander, évêque auxiliaire de Saragosse.
La contribution que Lluis Ferran Toledano Gonzalez consacre à la Catalogne occupée permet de se faire une idée de la mise en œuvre locale du projet napoléonien et de la précarité des réformes de Napoléon, même s’il ne permet pas de tirer des conclusions générales pour l’Espagne occupée tant l’observatoire retenu est trop particulier. L’historien note en effet que la Catalogne était perçue par la France comme une entité spécifique au sein de l’Espagne, avec ses particularités culturelles, et qu’il convenait de la traiter comme telle : un rapport daté de 1813 affirmait ainsi qu’il [fallait] laisser aux Catalans l’illusion de l’indépendance et la province [serait] vite pacifiée’ (p. 98). La France entendait y mener une politique visant à préparer l’annexion du territoire à l’Empire (ce qui fut fait brièvement avec la création de quatre départements sous l’administration Decaen, en 1812-1813). L’historien souligne les tensions entre les civils chargés de mettre en oeuvre une politique réformiste (on pense en particulier au rôle du baron de Gérando et de Jean-Paul Alban de Villeneuve-Bargemont) et les militaires soucieux de pacifier la région (en particulier Duhesme et Suchet) : « les efforts des administrateurs civils furent en grande partie réduits à néant par le comportement et les exigences des militaires. » (p.117)… La Catalogne constitue par ailleurs un bon terrain pour qui s’intéresse au groupe des afrancesados : ainsi Luis Ferran Toledano Gonzales analyse-t-il le cas de l’emblématique Tomas Puig.
Une seconde section scrute « Visions et rôle de la presse ». De l’ensemble des contributions qui structurent ce volet, deux articles se singularisent par leur richesse et leur originalité.
C’est à la construction du mythe du Deux Mai et à sa portée idéologique entre 1810 et 1814, que s’attaque Beatriz Sanchez Hita (« Mai 1808 dans la presse de Cadix pendant la Guerre d’Indépendance »). Cadix, siège du pouvoir « patriotique », concentre de très nombreux périodiques reflétant les clivages idéologiques entre libéraux et « serviles » (partisans de l’absolutisme). C’est en 1811 que la Junte Centrale choisit de commémorer ce jour, mais seule la presse libérale rendit alors hommage aux victimes du Deux Mai, principalement l’emblématique Semanario Patriotico de Quintana, « l’Evangile de tous ceux qui optèrent […] pour la cause libérale. » (p. 211) En 1812 et 1813, la presse « servil » passa globalement sous silence l’événement, contrairement aux titres libéraux. En 1814, alors qu’on transférait les Cortes à Madrid et que s’aiguisait le débat concernant le devenir de la Constitution de 1812, le Deux Mai fut instrumentalisé par les libéraux comme un symbole de lutte contre l’oppression (non plus napoléonienne, mais réactionnaire, illustrée par l’attitude de Ferdinand VII et de ses partisans) : les libéraux présentaient toute atteinte à la Constitution comme une trahison envers les « martyrs de la Patrie », les victimes du Deux Mai, les « serviles » se contentant d’évoquer les insurgés qui avaient combattu « pour le Roi et la Religion ». Après le pronunciamiento de Riego (1820), les libéraux firent du 2 mai une fête nationale.
L’historien du droit Jean-Baptiste Busaal consacre une belle étude au « discours constitutionnel dans « El Imparcial » de Pedro Estala (1809) », à travers lequel se laisse en partie saisir le discours réformiste de Joseph Ier et de ses partisans afrancesados (ou « joséphins »). L’afrancesado Pedro Estala se fixa comme mission de justifier, auprès de ses compatriotes, la nécessité de la Constitution de Bayonne, par le biais de son périodique bihebdomadaire « El Imparcial », dont la durée de vie fut fort brève (1809). Pour les « joséphins », les Espagnols étaient placés face à une alternative simple : soit ils se ralliaient à la Constitution, et l’Espagne sortirait de ses malheurs séculaires, soit ils s’y opposaient, et ils prenaient le parti de plonger le pays dans le « despotisme anarchique » de l’insurrection… Comme le souligne fort justement Jean-Baptiste Busaal qui définit, globalement, la pensée « afrancesada » comme une « expression attardée de la Ilustracion » (p. 294), par sa critique anti-nobiliaire, et comme hostile aux conséquences de la Révolution française de 1789 : « Les joséphins s’opposaient à la fois à la structure traditionnelle d’un Etat divisé en ordres et à l’intervention du peuple en politique. Il était indispensable d’éduquer ce dernier pour qu’il puisse jouer un rôle et la fonction des élites était de le former. […] La notion de constitution chez Estala n’était pas empruntée au ‘modèle’ exporté par Napoléon en Espagne; elle était héritière de la culture politique espagnole qui tendait à encadrer le pouvoir royal de façon à établir un équilibre entre ses prérogatives et les droits de la ‘nation’. » (p. 297) Les afrancesados ne sont donc pas ces partisans, qu’on voit parfois en eux, de l’importation d’un modèle français qu’il se serait agi de plaquer purement et simplement sur les réalités espagnoles.
La « guerre de la plume » (p. 253) qui s’empara alors de la presse espagnole est particulièrement bien rendue par les contributions de Manuel Moreno Alonso sur « La presse de guerre à Séville » et de Vicente Leon Navarro sur « La presse valencienne face à la Guerre contre les Français, 1808 ». Une véritable « rhétorique de combat » (p. 245) diabolisa alors l’empereur et les Français.
Les contributions réunies dans ce volume intéresseront principalement les spécialistes de la question qui parviendront sans peine à en synthétiser les apports, d’autant plus notables qu’ils proviennent de quelques-uns des plus éminents historiens espagnols. Les néophytes seront sans doute bien moins à l’aise, d’autant que l’introduction des deux maîtres d’œuvre du colloque ne définit pas les concepts censés structurer le corpus : ainsi, à aucun moment n’est défini le terme de « régénération » qui ne se laisse qu’imparfaitement saisir au fil de la lecture. Par ailleurs, aucun bilan synthétique ne vient clore cet ouvrage, par ailleurs excellemment édité par les Presses de l’Université d’Aix-en-Provence, puisqu’il dispose d’un riche index onomastique et de substantielles notes infrapaginales dans lesquelles figure l’original espagnol (ou anglais) de tous les extraits de sources cités par les auteurs (gageons que cela sera d’une grande utilité pour les collègues enseignant en classes européennes).
C’est donc au lecteur qu’il revient de démêler parfois les fils d’un moment historique particulièrement complexe. Ainsi, les clivages idéologiques se dévoilent au fil des contributions, mettant au jour trois grandes tendances:
– les « serviles » ou absolutistes, partisans du Roi et de la Religion, attachés à l’Ancien Régime et qui ne veulent entendre parler ni de révolution ni de régénération;
– les afrancesados, ou « joséphins », partisans de Joseph Ier et d’un certain réformisme, sous la houlette de l’occupant français;
– ceux enfin qu’on allait appeler libéraux, dès 1811 à Cadix, attachés aux libertés publiques comme antidote au despotisme, hostiles à la fois aux Français et à l’Ancien Régime, fidèles aux idéaux de la Révolution française que Napoléon aurait trahis; pour eux, c’est dans la nation que réside la souveraineté et non dans la dynastie régnante. Les libéraux seraient donc partisans d’une révolution ou d’une régénération, en dehors de toute compromission avec une puissance occupante.
C’est bien la tendance « joséphine » qui est l’objet de toutes les attentions dans le recueil, plusieurs auteurs scrutant la pensée et l’action d’afrancesados notoires comme Tomas Puig, Pedro Estala ou Félix Amat, et permettant de ce fait une analyse fine et contrastée de ce courant. La pensée libérale est évoquée au détour d’études d’histoire de la presse, puisque le périodique de Quintana fait l’objet de nombreuses références, sans qu’une contribution spécifique lui soit toutefois consacrée.
Alors que le titre évoque la « régénération » et la « révolution », cette dernière figure comme le parent pauvre de l’ouvrage. Par exemple, un seul article questionne, incidemment, la dimension révolutionnaire des juntes qui fleurirent dans l’Espagne « patriotique ». Même si les historiens ont bien montré la faible nature révolutionnaire des juntes, une contribution n’aurait pas été de trop sur l’état historiographique de la question, sans parler d’une étude relative à la fameuse Constitution de 1812…
Malgré ces quelques critiques, et bien qu’il s’adresse avant tout à des spécialistes ou à des amateurs éclairés, ce colloque mérite d’être lu. Il éclaire sans nul doute « la complexité de la crise de la Monarchie et [les] ambiguïtés politiques des tentatives de la résoudre pendant la guerre d’Indépendance. » (p. 304) et, en tout cas, il démontre en grande partie que la compréhension de l’Espagne de 1808 ne se laisse pas enfermer dans l’hypothétique alternative que met en exergue le sous-titre de l’ouvrage (« Régénération ou Révolution ?»).