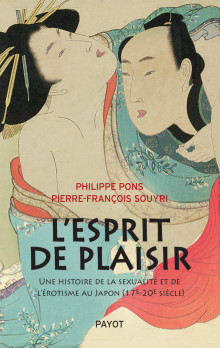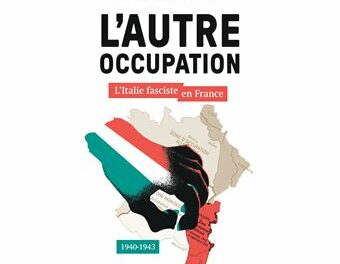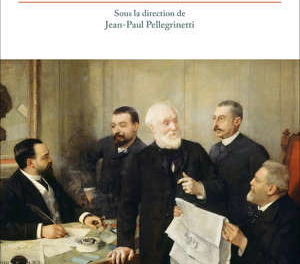Entre histoire culturelle, histoire des émotions et études des genres, l’esprit de plaisir tend à nous faire connaître le Japon sur un de ses pans les plus mystérieux, les plus fantasmés à force de déconstruction et de reconstruction, que ce soit depuis le Japon même ou bien de l’Occident qui l’observe. Longtemps simplement limitées par l’étiquette et les convenances, les formes de séductions et les pratiques en découlant propres au Japon sont vastes et loin de notre conception occidentalisée.
Le bouddhisme et le shintoïsme japonais de la période ancienne, au-delà d’un profond mépris pour la femme, n’a véhiculé aucune signification de bien ou de mal autour de la sexualité (au sens large du terme), ne fixant ainsi aucun tabou, aucune pratique immorale. Au contraire, il s’en dégage une vision du monde teintée de la croyance en l’impermanence de toutes choses. Il naît alors une volonté de profiter de chaque instant et, indirectement, cette idée de « désirer tout ce qui est désirable » (Foucault).
Une histoire culturelle évolutive : d’une recherche du plaisir à un projet politique
Dès, les origines du Japon racontées dans le Kojiki, l’île est le résultat de l’accouplement de deux divinités primordiales. Bien que cet évènement soit décrit d’une manière totalement désincarnée et purement descriptive, la vie intime conserve une place centrale dans la société japonaise.
L’ouvrage en lui même prend racine sur la période Edo débutant au XVIIème siècle et caractérisée par la sortie des longues guerres civiles entre guerriers des deux siècles précédents (guerre d’Onin et période Sengoku). Maintenir la paix et la stabilité sociale ont été les premiers objectifs de l’État des Tokugawa. Pour cela, l’autoritarisme a fait loi, bien qu’en réalité les mœurs de la population n’ait été que très peu impactés tant que les apparences et la bienséance étaient respectées. Même les édits régentant les comportements n’ont pas donné fréquemment lieu à des condamnations, le pouvoir ne s’imposant pas dans ce domaine. Il existe un cadre mais il est possible de jouir des libertés à l’intérieur.
L’évanescence de toute chose a pu donner une tonalité nostalgique à la recherche à corps perdu du plaisir sous Edo. Le sentiment de l’éphémère a développé cette esthétique du plaisir : autant vivre pleinement le moment. La geisha, et avant elle la tayu, représente cet esthétisme du jeu de séduction faisant de l’élégance et du raffinement des considérationssupérieures au rang social. De plus, cet état d’esprit d’Edo ne s’est pas limité à une élite aristocratique et bourgeoise libertine, mais bien à tous les rangs de la société.
Avec l’ouverture obligatoire du Japon sous l’influence des États Unis à partir de 1853 (à la recherche d’un port d’attache dans cette partie du monde), cet esthétisme disparaît au profit d’une vision hygiéniste de la sexualité : on ne parle plus de volupté mais de maladies vénériennes, on ne parle plus d’érotisme mais de sexualité. Il s’agit du passage d’un ars erotica à une scientia sexualis, comme a pu le décrire Foucault. La catégorisation des pratiques sexuelles des Japonais est entamée. Ce qui s’éloigne du puritanisme victorien est alors jugé et décrit comme pathologique.
C’est un véritable choc des conceptions entre une tradition charnelle millénaire et la caution scientifique des interdits chrétiens. Le Japon entre dans la modernité de l’ère Meiji dont le but n’est pas simplement le contrôle des mœurs afin de paraître civilisé aux yeux de l’Occident. Il s’agit aussi de policer les corps pour les mettre au travail. L’influence du capitalisme et de l’économie de marché se font sentir eux aussi. Cette optique de retrouve une fois l’occupation américain terminée en 1952.
Une seconde modernité apparaît à partir des années 1910/1920. Le Japon a intégré les caractéristiques de la modernité occidentale et décide d’hybrider cet ensemble avec les valeurs et conceptions japonaises. Le pays entre dans la période Taïsho.
Sur cette période, comme à la fin de la période du shogunat des Tokugawa, les images érotiques tirent vers le grotesque, puis vers la bizarrerie, usent de violences (tortures, ligotage, viols) et sortent des cadres habituels (zoophilie, nécrophilie). Cette influence s’ancre dans une très ancienne tradition que les auteurs mettent en avant : la sexualité est vecteur du rire, dans les représentations produites et diffusées. Ces thèmes sont repris et développés durant les années folles japonaises (environ 1915 à 1933) dans la culture ero-guro-nansensu.
Durant la militarisation progressive de la société et la guerre, le corps est extrêmement genré. Celui de l’homme est fort, puissant, apte au sacrifice pour son pays. La femme, elle, est un soutien moral en tant qu’épouse ou mère, qui pleure les pertes et attend son mari en adhérant aux associations de soutien à l’État. Pourtant, après la défaite, c’est ce même État qui embauchera des dizaines de milliers de jeunes femmes pour servir de « filles de loisirs » aux occupants américains afin d’éviter des débordements proches de ceux que les troupes japonaises elles-même ont fait subir en Asie. Pendant l’occupation, la société japonaise fuit la misère constante dans une fureur de vivre faisant du plaisir charnel la seule réalité à laquelle se raccrocher.
Enfin, l’érotisme japonais, face à une mondialisation croissante, rentre dans l’ère de la société de consommation. Le plaisir devient standardisé et perd de son particularisme, même si les auteurs nous proposent une nuance à ce sujet en fin d’ouvrage. De plus, la volonté de performance économique vient limiter grandement les subtilités d’un monde des plaisirs où les courtisanes de haut rang, mais aussi les prostituées vivant dans la misère, sont interdites dès 1958. En parallèle des manuels comme les Fondements de l’éducation pure font légion. Pourtant, cela n’a pas empêché le Japon de tomber dans un excès inverse : une pornographie violente, exutoire d’une société fixée uniquement sur le rendement.
Un panorama des lieux de plaisirs : les « mondes flottants »
Le vocable de monde flottant est tiré du mot japonais uwaki qui signifie littéralement « le cœur ballotté, le cœur qui flotte ». Il est à percevoir comme un détachement du monde réel et illustre cet univers de personnes qui sont arrachées à toute stabilité, qui n’ont aucune prise sur leur vie. Il représente l’univers des plaisirs, centré sur un quartier en particulier dès la fin du XVIème siècle et qui perdure jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.Cependant, ces espaces connaissent un progressif déclin avec l’arrivée de la modernité occidentale.
Pourtant, les lieux se centrant sur le monde du plaisir avant cette époque sont nombreux. Dans les temps anciens, des lieux reculés, souvent des sanctuaires sont ornementés de représentations phalliques, dans une optique classique de culte de la fertilité. Les lieux religieux ont une signification particulière : les premiers pèlerinages sont l’opportunité des premiers dortoirs mixtes. Ils représentent donc une initiation à la sexualité. De même les bains publics, non séparés jusqu’à la fin du XVIIIème siècle voir jusqu’à l’époque Meiji, sont des lieux d’apprentissage du corps.
La nudité ne représente pas un tabou, ni même les relations charnelles : les cloisons sont fines, les pièces ouvertes sur l’extérieur. De même au sein de la maison, une géographie particulière se met en place : la chambre de la fille est a l’entrée pour qu’elle puisse facilement nouer des relations avec un prétendant qui lui rend fréquemment visite la nuit. De ces relations naissent souvent quelques enfants qui viennent renforcer la maisonnée. Au delà des lieux, il existe des moments de plaisir. C’est le cas des concours de poésie durant la période d’Edo : on boit énormément de saké, on s’oppose dans le maniement des mots et le trophée de cette opposition est très souvent une femme qui accepte cette situation.
Mais, avant toute chose, le monde flottant correspond à un quartier spécifique, distinct du reste des villes : le quartier des plaisirs. Les courtisanes et prostituées y sont enceintes et permettent le développement d’une culture raffinée du plaisir. Avant de se limiter à un quartier distinct, les bains collectifs ont pu servir de lieux de substitution, tout comme les barques traversant la Mer Intérieure. Les autorités décident ensuite de soumettre les courtisanes à des règles strictes et à des limites de déplacement. Ces lieux sont vite soumis aux pouvoirs locaux et central qui y voient une manne fiscale importante : la réglementation de ce commerce a eu une visée intéressée. Le quartier des plaisirs le plus connu est celui de Yoshiwara à Edo, même si d’autres sont plus anciens comme celui de Kyoto, Shimabara.
D’abord construit dans les limites de la ville le quartier est ensuite déplacé à plusieurs heures de marche de la ville. On y va pour la journée et profite d’un jour de détente. Dans le contexte d’une société verticale, Yoshiwara a laissé de côté toute hiérarchie sociale : le samouraï qui y entre laisse ses sabres à l’entrée. La seule distinction se fait par les moyens disponibles, ce qui fait du marchand un des personnages les plus importants du lieu.
Au final, ce type de quartier est soumis à de forts débats, notamment de la part des contemporains : certains y voient le comble du raffinement dans le côtoiement des geisha (ou des tayu avant elles), d’autres perçoivent la misère des prostituées de basse extraction, contraintes à vendre leur corps et à perdre toute stabilité. Dans le premier cas, certains élevèrent la fréquentations de ces lieux à une voie, comme c’est le cas de Fujimoto Kizan. Dans le second on peut s’épouvanter des catalogues très détaillés présentant les filles travaillant dans certains établissements et les marchandisant.
La place de la femme dans la vie sociale et intime du Japon
Avant même la période dont s’intéresse l’ouvrage, les femmes – de cour notamment – ont eu une influence littéraire remarquable. C’est le cas de la période Heian (IXème – XIIème siècle) durant laquelle est rédigé un pilier de la littérature japonaise : le dit de Genji par Murasaki Shikibu. Initiées aux arts, ces femmes avaient une place centrale dans l’image de la dynastie. Elle jouissaient d’une relative liberté sexuelle avec les hommes. Une sorte de polygamie dans les deux sens était officieusement acceptée. L’arrivée au pouvoir des guerriers mit fin à cette conception de la femme au profit d’une position de subalterne, de bonne épouse et de bonne mère.
Malgré ces attendus sociaux, la femme doit malgré tout être une femme raffinée connaissant les arts de la harpe, du jeu de go ou bien des poèmes. Elle est soumise aux hommes : le système d’adoption dans le cas d’une succession sans fils est créé pour éviter de mettre une femme en tête de maisonnée. Par ailleurs avoir une fille est perçu comme un moyen d’ascension sociale, par le mariage qu’elle pourra contracter. De même, officiellement, seul l’homme peut demander le divorce. Dans les faits, la femme trouve toujours un moyen d’être répudiée : elle quitte le domicile commun, avoue des sentiments pour un autre homme, se retire du monde pour entrer en religion …
Un idéal féminin se dégage avec la période d’Edo : une femme soumise, digne, capable de distinction. Dans le monde guerrier et aristocratique, la femme est limitée aux quartiers intérieurs. Elle devient la responsable des mariages de la maisonnée. Elle doit apprendre les arts, maîtriser les codes littéraires. Tout est codifié, jusque dans les relations intimes qu’elle entretient avec son mari (ne jamais jouïr après lui, ne pas passer la nuit avec lui, garder un certain maintien …).
Au sein de cette image de la femme idéale, la figure de la courtisane de haut rang a un rôle central. D’abord concubine impériale, puis dans l’aristocratie et enfin employée des parties luxueuses des quartier de plaisir, l’éducation aux arts est leur caractéristique principale. Elles sont d’une distinction très élevée. Le figure de la tayu puis de la geisha représentent cette vision de l’art de séduction. Elles sont des femmes fortes, capables de refuser des clients. De plus elles imposent un protocole de rencontre très strict et très coûteux et savent se faire désirer. Elles sont, pour les geisha du moins, avant tout des servantes et des danseuses qui gratifient de leur présence le temps qu’un homme passe dans un établissement. Pourtant, le terme de geisha a pu avoir de multiples facettes : c’est le cas des geisha des rue, assimilables à des prostituées.
L’amour vénal est l’autre penchant de cette vision de la femme. Durant Edo, la prostitution n’a jamais été une profession stigmatisée, bien qu’elle ne fut pas pour autant acceptable. La population semble avoir de la compassion pour ces femmes obligées de vendre leur corps : on les perçoit comme des filles « abandonnées au courant » d’une existence instable sur laquelle elles n’ont pas de prise. Pourtant, vendre son corps est parfois la seule solution pour échapper à la misère. Il arrive que mari lui même impose la prostitution à sa femme pour compenser des difficultés financières. Au lendemain de la défaite de 1945, ce sont des centaines de milliers de Japonaises qui se sont prostituées dans les rues en ruine de leur ville.
Avec l’ouverture sur l’Occident, la prostitution est traitée différemment. D’abord la profession est déréglementée : l’amour vénal s’accroît, les prostituées sillonnent les rues. Ensuite, les autorités vont contrôler leurs pratiques uniquement dans le cadre de la gestion des maladies vénériennes. La prostituée est alors stigmatisée et marginalisée, perçue comme une nuisance sociale.
Avec la restauration de Meiji, la femme est alors totalement soumise à l’homme. On lui crée de nouvelles obligations morales, totalement déprises des réalités culturelles anciennes du Japon. La question de la virginité n’apparaît qu’à ce moment là et sert à distinguer la grande dame de la fille de rien. Cette politique réactionnaire, mais inspirée de la modernité, entama grandement les quelques domaines dans lesquels la femme et l’homme étaient relativement égaux. L’instauration des mariages arrangés, décidés par la famille, est généralisée à l’ensemble de la population. La femme est confinée au foyer et doit transmettre les valeurs idéologiques de la nation à ses enfants.
Durant la seconde modernité et les années folles au Japon, une nouvelle figure de la femme se développe : la modern girlou moga. Elle est le résultat de cette volonté contradictoire du régime de Meiji de faire de la femme l’actrice de la transformation du pays mais aussi la figure prémoderne de la soumission aux valeurs traditionnelles (pour partie réécrites). Dans ce contexte, la moga ne put que dépasser cette contradiction et chercher, par son attitude, son apparence (mais non ses prises de position) à remettre en cause l’ordre patriarcal. Elles se maquillent et s’habillent à l’occidental, se coupent court les cheveux. Les vêtements légers qu’elle portent cherchent à signifier la beauté de l’intégralité du corps de la femme. Une moga se distingue des autres et devient une égérie : Naomi, serveuse dans un bar dansant, séduisant un homme rangé qui finira par l’épouser.
La faiblesse des écrits de femmes elles-mêmes depuis la prise de pouvoir des guerriers (durant le XIIème siècle) limite la fiabilité des sources qui nous sont parvenues. Il est donc constamment nécessaire de s’interroger sur les représentations véhiculées par les sources majoritairement masculines. Ne serait-ce que le reflet d’un imaginaire ? Quoiqu’il en soit, ils ont transcrit leurs attentes envers les comportements des femmes et non pas uniquement la norme dominante. Dans tous les cas il a fallu attendre le début du XXème siècle pour entrevoir une libération de la parole des femmes.
La sensibilité féminine a pu alors être rédigée par des femmes à la fois écrivaines, poétesses et militantes, prônant leurs libertés individuelles et leur capacité à choisir pour elles-mêmes. Influencées par les pensées marxiste et anarchiste, ces femmes ont eu un impact très important dans les années folles, notamment en faisant du corps, du désir, des attentes déçues des femmes et de leurspassions des thèmes de prédilection.
Une longue histoire de l’homosexualité et de la transgression des genres
Avant l’ouverture forcée sur le monde au milieu du XIXème siècle, l’homosexualité, féminine comme masculine, ainsi que la transgenrité n’ont pas été le fruit d’un jugement d’anormalité.
Le travestissement a une longue tradition japonaise que pratiquent de nombreux individus. Le phénomène est inscrit dans des textes fondateurs comme le Kojiki où le légendaire Yamato Takeru no mikoto le pratique comme une stratégie politique, un détournement de l’attention de ses adversaires. On retrouve aussi des récits de frères et sœurs qui inversent leur genre par expérience et pour cumuler différentes formes d’amour. Il était possible de le pratiquer pour découvrir ce que cela fait. La société avait de la compassion pour ceux qui ne sentaient pas à l’aise dans leur genre, perçus comme victime d’un mauvais karma les emprisonnant dans le mauvais corps.
Il en va de même pour les pratiques homosexuelles qui étaient pratiquées par deux populations en particulier : les moines et les samouraïs. Les deux cas ont en commun les rapports qui se mettent en place entre les deux partenaires. Il s’agit fréquemment d’un homme assez âgé, relativement puissant et d’un jeune débutant, encore adolescent (moinillon, page, apprenti) mettant ainsi en avant une certaine forme de compagnonnage. Les relations expriment une soumission à un supérieur, une certaine forme de remerciement ou d’admiration. Une fois l’adolescence passée, l’apprenti perd sa place passive et pourra, progressivement, exprimé son désir à un jeune du groupe. Par ailleurs ces deux phénomènes divergent sur certains points. Dans le cas des moines, ces pratiques sont liées à l’interdiction du commerce des femmes, jugé comme impur. Les moinillons se travestissent dans des pratiques de substitution.
Dans le cas des samouraïs, les relations homosexuelles sont portées à une esthétique : la voie des garçons ou nanshoku. Les apprentis ne s’efféminent pas, font naître des relations d’attachement à leur maître. Les guerriers, fondamentalement misogynes, en viennent à glorifier ces pratiques comme une capacité à rester des hommes viriles. Ils considèrent que la vie au contact des femmes féminiserait leur comportement. Certains iront même, d’après les écrits de Saikaku, se laver les yeux et les oreilles après que des femmes leur fassent des avances.
Pourtant, cette vision de la sexualité n’est pas exclusive pour la majorité des guerriers. Ils pouvaient avoir à tour de rôle des pratiques homosexuelles et hétérosexuelles, les deux se complétant parfaitement et leur apportant des avantages particuliers. Il n’existe pas de catégorisation de l’identité sexuelle des individus sur cette période. Tout semble dépendant du contexte, de la personne à qui l’on fait face. Tokugawa Ieyasu lui même, fondateur de régime d’Edo, est connu pour avoir des relations intimes avec de jeunes éphèbes pour qui il a fait aménager une partie de son palais. De même, à Edo, il existe un quartier de prostitution réservé aux relations avec les hommes.
Concernant l’homosexualité féminine, elle n’est jamais pensée pour elle même mais comme un substitut à une relation avec un homme. Seule la pénétration d’un homme est capable de contenter les femmes d’après la pensée populaire. C’est pour cette raison que les femmes ne se touchent pas peau à peau dans les estampes représentant ces pratiques mais par l’entremise d’un godemichet. Ce besoin phallique en deviendrait même un besoin médical : une femme qui n’a pas eu de relations avec un homme avant ses 20 ans attraperait facilement la tuberculose.
Une fois l’ouverture du Japon sur l’Occident effectuée, le pays va condamner, ou simplement tolérer, au mieux, les pratiques homosexuelles perçues alors comme pathologiques. Elles sont condamnées mais restent durables. La littérature et les arts visuels sont totalement expurgés des connotations homosexuelles des personnages y étant décrits. Le célèbre romancier Saikaku est décrédibilisé. Avec l’influence de la scientia sexualis occidentales, l’homosexualité devient alors une pathologique psychologique qu’il faut s’évertuer à chasser chez l’homme adulte. Chez l’adolescent, les pulsions homosexuelles sont considérées comme une phase passagère de construction de la libido. Pourtant, dans les faits, l’homosexualité continue d’être pratiquée, notamment à cause d’une contradiction majeure dans l’idéologie du régime au début du XXème siècle.
Suite à la victoire sur la Russie en 1905, le Japon va glorifier son passé militaire et sa tradition de la voie du samouraï (entraînant la réécriture du bushido) pour expliquer sa réussite et sa puissance. Mais comment glorifier l’héritage du samouraï et rejeter une de ses composantes structurantes ? Il est décidé de muséifier cette partie de l’héritage, en faire une caractéristique totalement dépassée, à connaître mais à ne plus reproduire. La condamnation complète de la pratique en devient impossible et se traduit alors par la discrétion de la « voie des garçons » ou bien la marginalisation de ceux la visibilisant.
Durant les années folles au Japon, l’hybridation de la modernité occidentale et des particularismes japonais ont permis l’émergence de la culture Ero-guro-nansensu. Le goût pour la transgression des normes fit de l’homosexualité une identité sexuelle de nouveau acceptée, bien qu’elle le fut en tant que telle et non plus comme une pratique non exclusive.
La littérature s’empare du sujet et met en avant deux formes d’amour entre hommes : un esprit de camaraderie ainsi que des rapports intimes. La seconde forme de cette amour est peu décrite et le sera de moins en moins avec la militarisation et l’ultranationalisation de la société. Dans les années 1930, l’homosexualité redevient progressivement une pratique mal vue : d’abord par rejet et dégoût de celui qui est passif, puis ensuite par endoctrinement. Seule la camaraderie fût alors encouragée.
Une histoire des structures familiales
Le système de la maisonnée, copié sur le modèle guerrier, se généralise progressivement à l’ensemble de la société durant la période Edo. Ce système familial élargi est dominé par un chef de famille, le père. La succession se fait par un des fils, bien qu’au Moyen Age l’héritage se faisait à part égale entre les différents garçons. Ce moment de passation de l’influence sur la maisonnée est crucial. Dans le cas où il n’y aurait pas de fils, l’adoption est la solution permettant d’éviter l’affaiblissement. On estime entre 13 et 25 % le nombre de chefs de maisonnées ayant été adoptés durant Edo.
La pratique du mariage durant cette période n’est ni formalisée ni rattachée à un quelconque rite religieux. Il entraîne seulement le renforcement de la famille. Dans la majorité des cas c’est la femme qui rejoint la maisonnée de son mari mais dans environ un quart des situations le mari rejoignait la maisonnée de son épouse, souvent dépourvu de successeur mâle. Il venait donc prendre cette place dans le foyer. Dans la pensée de cette période, le mariage de l’homme et de la femme est une question d’harmonie. Mais il arrive très fréquemment que des divorces soient prononcés, générés par un simple billet du mari. Cette pratique est même une des justifications du jugement d’infériorité des Occidentaux sur les Japonais au XIXème siècle.
Les cas d’infidélité ne sont pas moralement condamnables : juridiquement, l’homme peut avoir droit de mort sur le couple adultérin, mais dans les faits peu ont réclamés cette sentence. En effet, cette condamnation (ou bien son exécution par le mari les prenant sur le fait) entraînait une longue enquête et donc l’interrogation sur la famille. Les cas dramatiques se sont centrés sur des situations d’inégalités sociales, lorsque l’amant était inférieur socialement. L’infidélité est donc socialement condamnables.
La restauration de Meiji et la modernité qu’elle apporte vont totalement modifié la vision de la famille et son organisation. Les hommes ne peuvent, officiellement, plus prendre de concubines en plus de leur femme. La sexualité se recentre sur le couple légitime. Officieusement, les hommes de l’élite, et d’ailleurs les dirigeants du nouveau régime, entretiendront des concubines, tout en les cachant.
La place des arts : illustration de l’imaginaire et des espérances d’un pays
Les arts littéraires ont avant tout profité des grands progrès de l’éducation et de la lecture/écriture dès le XVIIIème mais surtout au XIXème siècle. La maîtrise de l’écrit devint alors une nécessité sociale permettant la prolifération des œuvres et de leurs applications dans le domaine amoureux : manuels de pratiques, romans sentimentaux voir érotiques … Ces manuels traitant de sexualité, par la transgression d’une certaine forme d’ordre social, ont été des vecteurs de critique, sans pour autant tendre vers l’agitation. Aucun personnage n’est directement cité mais certaines scènes métaphoriques ont pu rappelées des faits existants. De nombreux formats de textes ont pu existé, comme les senryu (poèmes courts du début XIXème siècle usant du double sens pour observer des mœurs de la société).
Des manuels de plaisir sont rédigés dès le XVIIIème siècle. Ils ont un double rôle : présenter aux femmes les comportements à tenir et expliquer aux garçons comment donner du plaisir. On y dresse un tableau détaillé de ce que doit être la sexualité.
Au sein des arts visuels, l’inexistence de tabou sur la nudité influence énormément les productions érotiques. Le corps intégralement nu n’est pas l’objet de stimulations particulières. Les artistes favorisent la représentation du vêtement. Le kimono peint est codifié et, selon ses motifs, apporte un sens à la scène. Le vêtement doit cacher autant qu’il ne montre car le corps partiellement dévêtu suscite l’imagination et l’émoi.
De même, le choix des parties visibles du corps leur donne de l’importance : ce sont souvent les organes génitaux. Au cœur de cette tradition des arts visuels, on retrouve les estampes japonaises et plus particulièrement les shunga. Cette tradition iconographique représente à l’origine des scènes de la vie quotidienne et donc des moments d’intimité. Dans ce cadre des shunga érotiques, les premières représentations sont très fines et portent sur les habits, sur des éléments de détails, sur des paravents pour se changer.
Puis, ils connaissent rapidement une grande diversité de thèmes beaucoup plus crus : scène de voyeurisme, concours de taille de pénis … Dans ces estampes l’homme et la femme ne sont que peu différenciés. Ce sont les détails normatifs (comme la coupe de cheveux du samouraï, le haut de son crâne intégralement rasé) qui viennent les distinguer. Cette tradition picturale connaît un déclin majeur sur la fin de la période Edo en tombant dans des représentations extrêmes (viol, nécrophilie, torture de femmes enceintes) puis lors de la restauration de Meiji et l’interdiction de représentations jugées immorales.
Le jeu sur les genres n’est pas limité aux estampes. On le retrouve aussi dans le théâtre, notamment dans les pièces de kabuki : à l’origine ce sont des troupes d’actrices jouant tous les rôles, masculins comme féminins. Le travestissement est une tradition artistique ancienne qui touche ensuite les hommes, jouant des rôles de femmes. Dans les deux cas, les acteurs travestis sont souvent sollicités par des demandes de prostitution, auxquelles ils cèdent pour une majorité. Ce phénomène pose ainsi la question de l’acceptation de l’androgynie au Japon. Perçu comme la quintessence de la beauté physique, l’androgyne cumule tous les attraits physiques de l’homme et de la femme. Il est même perçu comme une figure sacrée de la désirabilité avant l’entrée dans la modernité occidentale.
La censure dans les arts visuels et la littératures s’installe progressivement sous les Tokugawa en lien avec, d’une part, le développement de l’édition et de l’écriture au XVIIIème siècle et, d’autre part, le développement de la morale néo-confucéenne, fondée sur une hiérarchie à toutes les échelles. Elle atteint son apogée avec la première modernisation du Japon, dans la seconde moitié du XIXème siècle, puis durant la militarisation de la société avant le début de le Seconde Guerre mondiale.