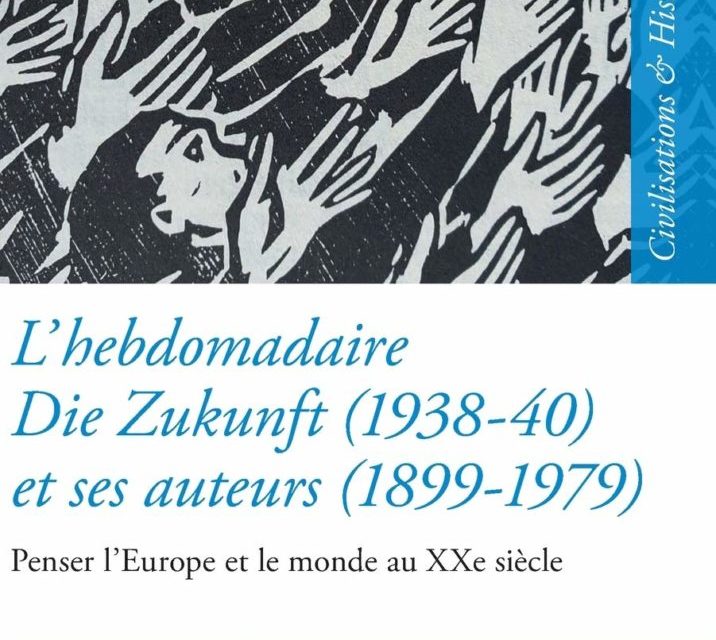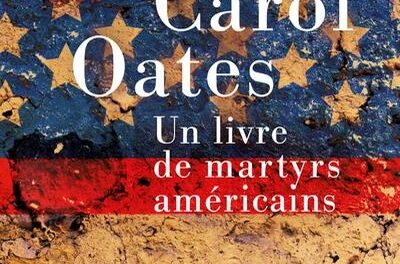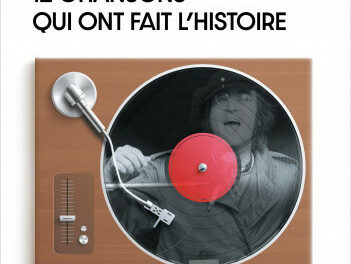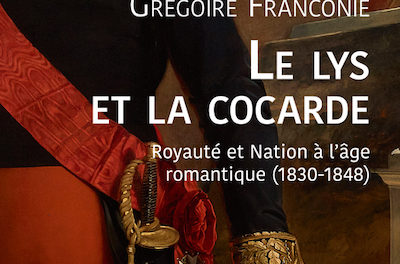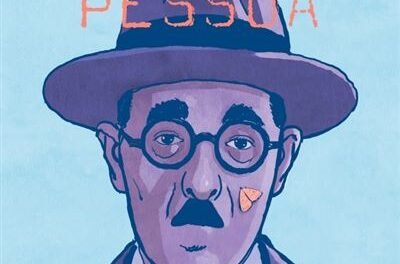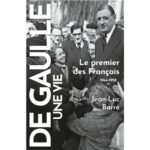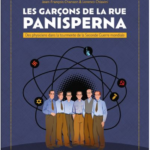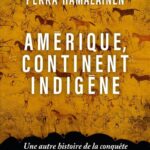C’est déjà une Europe de la culture, et même une Europe intellectuelle qui se dessine en creux dans la construction éditoriale de cette revue.
Die Zukunft (1938-40), L’hebdomadaire et ses auteurs (1899-1979) : Penser l’Europe et le monde au XXe siècle
Collections : Zivilisationen und Geschichte / Civilizations and History / Civilisations et Histoire

Le titre Die Zukunft signifie d’ailleurs « l’avenir », et celui-ci, cinq ans après l’arrivée de l’Hitler à la chancellerie, ne se présentait pas sous les meilleurs auspices.
C’est déjà une Europe de la culture, et même une Europe intellectuelle qui se dessine en creux dans la construction éditoriale de cette revue.
L’hebdomadaire Die Zukunft en exil (1938-1940) : les armes intellectuelles de la lutte contre le nazisme
Annette Nogarède-Grohmann
Dans Revue historique 2019/2 (n° 690), pages 371 à 404
On peut parler d’un réseau transnational de premier ordre, qui regroupe 332 auteurs issus de 25 pays. On compte 81 numéros entre le 12 octobre 1938 et le 3 mai 1940, dont des éditions spéciales « Angleterre-Allemagne » (« England-Deutschland »), « Suède-Allemagne » (« Schweden-Deutschland ») et « France-Allemagne » (« FrankreichDeutschland »), édité dans les deux langues.
L’auteur aborde dans la première partie la construction de ce réseau d’intellectuels qui a vu, au moins jusqu’en 1933, et même en partie 1938, un véritable réseau se constituer, en amont de la première parution, le 12 octobre 1938.
Au lendemain de la première guerre mondiale Berlin a pu constituer un des pôles intellectuels européens, mais le phénomène est largement antérieur, puisque des réseaux pacifistes ont pu se constituer à partir de 1899, –la date est importante puisqu’il s’agit de la première conférence internationale de la haye
Les conférences internationales de La Haye, 1899 et 1907
c’est d’ailleurs un paradoxe de voir ces mouvements pacifistes qui en France sont très largement influencés par le mouvement chrétien-démocrate, avec le sillon de Marc Sangnier, et le maître d’œuvre de cette revue, Willi Münzenberg, membre du parti communiste allemand, agent de l’internationale communiste, qui rompt avec Staline en 1938, ici aussi la date n’est pas innocente.
Les précurseurs
Pendant la première guerre mondiale des intellectuels comme Romain Rolland, Stéphan Zweig, Jean Giraudoux, et bien d’autres, envisagent déjà « le monde d’après » basé sur des valeurs visant à promouvoir une culture européenne ouverte et tolérante.
À certains égards on peut citer l’action de Annette Kolb, issue d’une famille franco-allemande et qui dénonce en 1915 la guerre comme « un chef-d’œuvre de la stupidité masculine ».
Le christianisme social qui porte ces intellectuels s’oppose clairement à ce petit groupe qui se réunità Zimmerwald du 5 au 8 septembre 1915, en présence de Lénine et de Trotsky. Si la déclaration de Zimmerwald est d’inspiration pacifiste, la position de Lénine entend « transformer la guerre impérialiste en guerre civile des classes opprimées contre leurs oppresseurs ».
D’autres mouvements pacifistes se développent, y compris en Angleterre où ils bénéficient d’ailleurs d’une certaine liberté d’expression. Robert Cécil membre du cabinet britannique, en charge du blocus, publie pourtant en temps de guerre un mémorandum intitulé : « propositions pour diminuer les chances de futures guerres ».
La société des nations et les accords de Locarno constituent dans une certaine mesure l’apogée des mouvements pacifistes qui vont militer dans diverses structures pour essayer de construire la paix, et au premier point la réconciliation franco-allemande. Dans les futurs collaborateurs de la revue de 1938, on trouve la plupart des grandes personnalités marquantes de l’entre-deux-guerres, comme Édouard Herriot, Léon Blum, Saint John perse, Paul Valéry, Élie Faure.
En Allemagne, au moment de la montée du nazisme, et jusqu’en 1933, une revue « Deutsche républik » alerte sur les dangers de l’idéologie hitlérienne.
Le temps de l’exil
L’auteur aborde dans cette première partie le contexte politique, marquée par la division des forces de gauche en Allemagne, qui conduit à l’arrivée de l’Hitler au pouvoir. Jusqu’en 1932, avant les élections législatives, plusieurs artistes et intellectuels comme Heinrich Mann, pressenti comme candidat à l’élection présidentielle d’ailleurs, lancent un « appel urgent pour la constitution d’un front ouvriers uni », avant les élections législatives du 31 juillet 1932.
La prise de pouvoir par Hitler implique pour de nombreux protagonistes allemands de prendre le chemin de l’exil. Toutefois Willi Münzemberg qui est toujours lié à l’internationale communiste continue son action de contre-propagande face à Goebbels.
Kolb, Eberhard, Deutschland, 1918-1933. Eine Geschichte der Weimarer Republik

Exilé en Suisse, Willi Münzemberg, qui commence à avoir des doutes sur la stratégie du Komintern, qui est encore, jusqu’au rapport Dimitrov, « classe contre classe », commence à développer un réseau autour de lui, en ayant comme but, et bien avant que cela ne devienne la ligne officielle de l’internationale communiste, un front uni contre le nazisme. Willi Münzemberg peut s’exiler en France, avec le soutien de nombreuses personnalités comme Henri Barbusse, mais aussi Léon Blum, Édouard Daladier, Pierre Cot, Édouard Herriot. Un réseau d’aide aux réfugiés allemands se met en place, tandis que Münzemberg constitue une maison d’édition à Paris, avec l’argent du parti communiste français.
Le but est de combattre sur le terrain de la propagande et des idées la propagande nazie. La première publication s’intitule d’ailleurs « le livre brun sur l’incendie du Reichstag », dans lequel on démontre la responsabilité des nazis dans l’incendie. Jusqu’en 1934, Münzemberg se révèle comme un redoutable organisateur, qui s’appuie sur des réseaux directement liés au Komintern dont il a été l’un des fondateurs en mars 1919. L’ouvrage de Annette Nogarède se révèle particulièrement intéressant à cet égard. On notera d’ailleurs avec quel aveuglement Staline a lui-même détruit une structure qui était pourtant porteuse de l’idéal de la révolution communiste mondiale.
Les 188 pages de cette première partie abordent donc les conditions qui ont pu conduire à la convergence de mouvements issus du christianisme social, de la social-démocratie, mais également du marxisme, pour constituer cette revue intellectuelle de haute tenue, qui cherche pendant deux ans à imaginer « un avenir « comme son nom l’indique, pour l’Europe. Ces théoriciens des années 20 et 30 ont assisté à la montée du totalitarisme de type fasciste, et plus précisément nazi, mais ils ont été exposés, pour certains de l’intérieur, à la construction du totalitarisme de type stalinien.
Il est minuit dans le siècle
La deuxième partie de l’ouvrage y est largement consacrée.
On différencie d’ailleurs très vite, même si cela ne semble plus très à la mode aujourd’hui, le socialisme voulu par les révolutionnaires d’octobre et le système mis en place par Staline. Münzemberg publie le 22 septembre 1939, après le pacte germano soviétique du 23 août, « le coup de poignard russe ».
Il convient d’en citer quelques lignes, tellement éclairantes, pour la suite.
« Les fronts se sont clarifiées. La paix et la liberté doive être défendue à contre Hitler et contre Staline, la victoire doit être remportée contre Hitler et contre Staline, et le nouveau parti unifié indépendant des ouvriers allemands doit se forger dans la lutte contre Hitler et contre Staline.
Pendant des années, une presse corrompue a jeté le soupçon sur des milliers d’ouvriers courageux et n’a cessé de répéter : avaler nuisibles, abat les traîtres. Aujourd’hui, des millions de personnes se lèvent, ils tendent le bras écrit, en désignant l’est, le traître, Staline, c’est toi. ».
L’analyse du totalitarisme apparaît en effet comme très complète, aussi bien sur l’approche économique, qui lui est spécifique, que la partie consacrée à la propagande, l’endoctrinement et la terreur.
Mise au pas de l’industrie, monopole de la propagande, et vase clos du système politique, écrit Richard Löwenthal. https://maitron.fr/spip.php?article216455
Comme dans la précédente partie, Annette Nogarède développe les événements de la période, notamment avec l’annexion des Sudètes ou le pacte germano soviétique à la lumière des réflexions des auteurs de la publication Die Kuzunft.

On est d’ailleurs surpris par la lucidité dont peut faire preuve un Georges Duhamel qui envisage dans un article intitulé « le sort des vassaux ? » Les conséquences d’une conquête allemande pour la France. Il met en garde contre le pacifisme qui semble anesthésier une partie des élites françaises. Dans l’édition suédoise de la revue, Victor Vinde fait état de la sympathie que la Suède aurait ressentie pour l’Allemagne dans les années 20. Il en ressort de toutes ces prises de positions une appréciation réaliste de la nature agressive de la politique étrangère d’Hitler et les auteurs sont tous d’accord avec une politique de fermeté de la part des puissances occidentales afin de limiter l’expansionnisme des états totalitaires européens. On retrouve la même démarche à propos d’une éventuelle alliance avec l’Union soviétique. Et lorsque le pacte germano soviétique signée Staline est considérée comme responsable, puisque ce pacte de non agression laisse les mains libres à Hitler pour attaquer la Pologne.
La lucidité de Münzemberg surprend très largement, et on voit dans ses échanges dans une revue que l’on a pu découvrir à cette occasion, la barrière de la langue explique cette méconnaissance, que les bases intellectuelles d’un débat qui refuse à la fois, au lendemain de la guerre, l’alignement sur l’Union soviétique mais également la soumission aux États-Unis, bref une troisième voie, sont posées.
La revue disparaît en 1940, Münzemberg ressortissant allemand est emprisonné en France, mais il parvient semble-t-il à s’évader avec la complicité d’un agent du NKVD. Il est retrouvé mort, partiellement décomposé, une corde au cou, et l’enquête de gendarmerie conduite à un suicide.
Dans le contexte de l’époque, avec un Staline qui règle un certain nombre de comptes, jusqu’au Mexique, avec l’assassinat de Trotsky, on ne peut qu’avoir un certain nombre de doutes.
Inventer un avenir européen ?
Cet ouvrage se poursuit, après la disparition de la revue par une étude d’histoire intellectuelle sur les auteurs pendant la guerre, leur participation à la mise en place d’un nouvel ordre européen et mondial et leurs interventions dans un débat doctrinal sur les relations internationales.
Ces deux dernières parties s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la question d’histoire contemporaine de l’agrégation interne, et seront traitées sur Clio prépas dans le cadre de fiches de lecture, appliquant les règles éditoriales des Clionautes en matière d’accompagnement aux préparations des concours.
On notera en conclusion partielle, la grande richesse documentaire de cette étude qui permet de découvrir une publication mal connue qui semble avoir réuni les grands esprits européens du XXe siècle.
Cela permet de s’interroger aujourd’hui sur le rôle de l’intellectuel dans l’histoire, sur sa responsabilité aussi, cette fois-ci devant l’histoire. Lorsqu’en France des revues comme « le débat » disparaissent, simplement parce que la production numérique agit comme un rouleau compresseur, on se prend à espérer que dans des situations de crise comme celle que nous traversons, de tels instruments puissent à nouveau émerger.
Lorsqu’il était minuit dans le siècle, ces femmes et ces hommes, venus de divers horizons idéologiques, savaient se retrouver, confronter leurs idées, échanger des points de vue.
Au moment où l’anathème, que l’on appelle cela « cancel culture », ou autre effet de mode venue d’outre-Atlantique, on se met à espérer en une pensée et en une culture européenne féconde, capable d’inventer un avenir, le nom de cette revue publiée entre 1938 et 1940.
Vous souhaitez lire la suite ?
Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.
Article publié dans la revue l’histoire
Willi Münzenberg : un génie de la propagande politique
François Fejtö dans mensuel 17
Chef d’orchestre de la propagande du Komintern dans l’entre-deux-guerres et grand maître des rassemblements internationaux contre le fascisme, l’Allemand Willi Münzenberg était peu connu. Depuis peu, il est révélé par une série de témoignages*.
Contenu:
La première moitié du siècle a connu deux génies de la propagande totalitaire : le nazi Joseph Goebbels[1] et le communiste Willi Münzenberg. Mais de ces deux Allemands, de l’hitlérien ou du stalinien, le plus inventif et sans doute le plus moderne était le second. Lors du grand duel – à propos du procès spectaculaire contre les « incendiaires du Reichstag » – qui opposa, en 1933, Münzenberg à l’agitateur suprême de Hitler, le chef d’orchestre de la propagande du Komintern l’emporta brillamment sur son adversaire nazi. L’acquittement de Dimitrov, à la grande confusion des hitlériens, était d’abord l’œuvre de Münzenberg. Personne, auparavant, n’avait su mobiliser l’opinion mondiale de manière si efficace pour la défense d’une cause qui n’était juste que de manière très relative. Comme l’écrit Koestler dans son autobiographie (La Corde raide, Paris, Calmann-Lévy, 1953), où il trace un portrait aussi nuancé qu’attachant de Münzenberg : « Les deux parties étaient coupables des crimes dont elles s’accusaient l’une et l’autre. Les deux mentaient… »
Cinq ans plus tard – il y a juste quarante ans -, le même Münzenberg, qui avait tout essayé pour faire éclater l’innocence de Dimitrov, a non moins efficacement contribué à faire admettre par les « grandes consciences » du monde occidental la culpabilité de Boukharine, de Radek et des autres bolcheviks accusés par Staline. Il savait pourtant parfaitement qu’ils n’étaient ni traîtres, ni espions. En fait, Münzenberg avait déjà rendu un service inestimable, d’abord à Lénine, ensuite à Staline, en les aidant à sortir du ghetto spirituel dans lequel leur sectarisme révolutionnaire les avait enfermés. Il couvrait l’installation du totalitarisme le plus hypocrite par la propagation mondiale de l’image idyllique de la Russie des Soviets, incarnation du socialisme, championne des valeurs humaines les plus sacrées : la paix, la justice sociale, la défense des opprimés et des persécutés. Or cette image a survécu longtemps à son auteur.
Les belles âmes
Certes, comme le dit sa veuve dans la monographie qu’elle vient de lui consacrer[2], ce n’est pas Willi Münzenberg qui a inventé les « compagnons de route » – ces auxiliaires précieux du communisme, recrutés dans les milieux intellectuels et qui, sans être membres du Parti, lui apportent la sympathie de l’extérieur et le soutien moral indispensable à son expansion. L’intellectuel de gauche, nostalgique de la révolution – aussi généreux que crédule et dépourvu de sens politique -, existait déjà avant la Première Guerre mondiale : on l’avait rencontré dans diverses manifestations pacifistes et anarchisantes. Mais il n’avait pas encore trouvé sa traduction en une organisation politique. Or, au lendemain de la guerre de 1914-1918, le courant de gauche, anticapitaliste, anticolonialiste, est devenu particulièrement puissant. Le mérite, si l’on peut dire, de Münzenberg a été d’exploiter ce courant, de le canaliser, de s’en servir pour le compte du Komintern dont il a été l’agent virtuose et dynamique.
Si Willi Münzenberg n’a pas inventé les fellow-travellers (compagnons de route), en revanche c’est bien lui qui a inventé la machine permettant de les fabriquer en série. C’est lui qui a inventé ce qu’on appelle en anglais les front organisations (les organisations de façade), les innombrables ligues et comités contre l’impérialisme et l’oppression coloniale (1927), d’aide à la classe ouvrière (1921-1931), d’aide à la Chine, aux victimes du fascisme, les comités contre la guerre, les Associations d’amis de l’URSS, etc., vers lesquels il a attiré des milliers, des dizaines de milliers d’intellectuels de bonne volonté qui tous ignoraient – ou faisaient semblant d’ignorer – qu’ils étaient manipulés par le Komintern. Il a organisé à Berlin un des empires de presse les plus puissants au monde, avec un nombre impressionnant de journaux, de périodiques, dont les activités s’étendaient jusqu’au Japon. Après l’avènement de Hitler, il déplaça le centre de ses activités à Paris où il organisa un formidable réseau mondial de propagande, superstructure et camouflage des officines du Komintern et des services de renseignements soviétiques. Il suscita de nouvelles campagnes de pétitions, de manifestations, des congrès à grand spectacle comme le Congrès pour la paix qui donna naissance au Mouvement Amsterdam-Pleyel (1934) et une douzaine de réunions internationales pour la défense de la culture, dont la plus brillante fut celle de Paris, en 1935.
Le Gotha de la paix
Willi Münzenberg fut le premier à mettre tous les mass média – cinéma, théâtre, radio, presse à grand tirage – au service de la propagande politique. Il fut le premier à faire appel efficacement, pour la manipulation de l’opinion publique, aux grands noms du Gotha mondain, de la science, des lettres et des arts ; il mobilisa des duchesses en quête de parures intellectuelles, des bourgeois snobs, des écrivains, des journalistes, des peintres, des médecins, des grands avocats – dont il exploitait la générosité, la crédulité et, souvent, la vanité : par son appareil politique, il était en mesure d’assurer une célébrité mondiale à des hommes qui n’étaient pas jusqu’alors sortis du rang. Ses émissaires – dont le Hongrois Louis Gibarti, que j’ai bien connu, et Otto Katz, alias André Simone, qui sera pendu en 1952 à Prague, à la suite du procès Slansky – ont parcouru le monde afin de créer partout des sous-comités, en Chine comme au Japon, au Brésil comme au Mexique, aux États-Unis comme en Angleterre, d’organiser des collectes d’argent et d’obtenir la présence à ses congrès internationaux d’hommes comme Nehru, Albert Einstein, le comte Karolyi, ancien président de la République hongroise exilé à Paris, Romain Rolland, Malraux, Gide, Benda, Éluard, Francesco Nitti et Sir Stafford Cripps, Walter Gropius et Paul Klee, Th. Dreiser, Upton Sinclair, Heinrich et Thomas Mann, Valle Inclan, Manuel Ugarte, Mme Sun Yat-sen, Havelock Ellis, Bertrand Russell, Joliot-Curie, etc.
Qui eût osé, parmi les grands de l’esprit sollicités par Münzenberg, refuser de soutenir, du moins symboliquement, par une signature ou une présence, de si nobles causes dont cet homme « au visage fidèle et décidé » (Soljénitsyne, Lénine à Zurich, Paris, Éd. du Seuil, 1975) était l’avocat irrésistiblement persuasif ? Grâce à son infatigable énergie, Münzenberg avait réussi à monopoliser au profit du Komintern, qui finança sans compter ses entreprises, toute action antifasciste et cela malgré les mises en garde de la IIe Internationale dont les leaders étaient à peu près les seuls à voir la « main de Moscou » dans ces entreprises à grand spectacle.
Sorcier, magicien, pendu
C’est l’époque du Front populaire et de la guerre d’Espagne qui marqua l’apogée de la carrière de Münzenberg. A ce moment-là, la politique étrangère de l’URSS sembla s’orienter dans la même voie que celle suivie par Münzenberg sur le front culturel et humanitaire : alliance avec toutes les forces progressistes. Au cours des années du Front populaire (1934-1936), les esprits jusqu’alors rétifs cessèrent de résister au charme légendaire de Münzenberg. L’idée de la grande démocratie soviétique – alliée le plus sûr contre le fascisme -, celle du communisme, seul rempart contre la barbarie, se trouvaient déjà si profondément enracinées dans les esprits que – comme me l’a dit Manes Sperber qui travaillait, à cette époque, au côté de Münzenberg – personne parmi les militants et les sympathisants ne voulait croire aux nouvelles affligeantes venues de Moscou : qui pouvait imaginer les purges féroces qui s’abattaient précisément sur les plus loyaux bâtisseurs du régime ?
Münzenberg n’a évité – pour quelques années – le même sort qu’en désobéissant à l’ordre de se rendre à Moscou. Il dut alors comprendre que ses succès l’avaient rendu suspect aux yeux des bureaucrates du Kremlin, car Münzenberg eut beau exécuter fidèlement et souvent contre ses convictions toutes les consignes du Komintern, il avait cependant apporté à l’exercice de ses fonctions une indépendance d’esprit, une liberté d’initiative qui n’étaient plus de mise. C’était un artiste, un sorcier, un magicien ; mais Staline n’avait plus besoin que de bureaucrates.
D’instinct, le maître du Kremlin prévoyait que des hommes comme Münzenberg – dans lesquels la « foi léniniste » n’a jamais complètement étouffé la voix de la conscience -, sincèrement antifascistes et anticolonialistes, pourraient être dangereux au moment du grand tournant : le pacte avec Hitler. En effet, en 1939, Münzenberg, déjà sur la touche, se retourna contre Moscou et contre le Komintern. Mais peu de ceux qu’il avait séduits et intoxiqués le suivirent dans la dissidence. Car il leur avait inculqué une foi sécurisante, une certitude, en leur donnant l’illusion de la communauté. A présent, il n’avait à leur offrir que la déception et la solitude. Sa mort survenue dans des circonstances obscures, est passée inaperçue : selon toute probabilité, ce sont des communistes allemands qui l’achevèrent au moment où en juin 1940, il essayait de gagner la Suisse. Des gendarmes français, à proximité de la frontière helvétique, le trouvèrent pendu à un arbre.
Le chacal au stylo
Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, l’URSS n’aura plus besoin d’un génie comme Münzenberg pour manipuler les compagnons de route. Des Jdanov, des Ehrenbourg, des Aragon suffiront pour attirer à Wroclaw, en 1948, au Congrès des intellectuels pour la paix, des « combattants » comme Paul Eluard, Picasso, Pablo Neruda, Jorge Amado, Julian Huxley. Münzenberg méprisait les intellectuels, mais les flattait dans leur orgueil culturel ; à l’inverse, les bureaucrates de l’après-guerre les méprisaient et les rudoyaient, sachant qu’ils aimaient cela.
Au congrès de Wroclaw, Fadéev dénonçait la « culture décadente de l’Occident » et qualifiait Sartre de « chacal muni d’un stylo ». « Picasso arracha ses écouteurs, Éluard soupirait », écrit un témoin[3]. Mais enfin, comme le disait Vercors à Janine Bouissounouse quelques années plus tard : « En dehors du communisme, il n’y a rien. Donc ne jamais agir contre lui[4]. » Le modèle de cette attitude néocléricale – consistant à absoudre tous les péchés du monstre adoré, à subir humblement les tortures morales infligées par lui -, c’est Münzenberg qui l’avait institué et propagé à travers le monde.
Note:
* Gilbert Badia et alii, Les barbelés de l’exil. Études sur l’émigration allemande et autrichienne (1938-1940), Presses universitaires de Grenoble, 1979 ; Arthur Koestler, Hiéroglyphes, Livre de poche, coll. « Pluriel », 1979 ; David Caute, Les Compagnons de route, Robert Laffont, 1979.
1. Goebbels, Derniers carnets, 28 février-10 avril 1945, Paris, Flammarion, 1977, 395 p. (présentation de Michel Fournier).
2. Publication à la Deutsche Verlags Anstalt de Stuttgard d’une monumentale biographie de Willi Münzenberg écrite par sa veuve, Babette Gross, avec une préface d’Arthur Koestler.
3. Dominique Desanti, L’Internationale communiste, Paris, Payot, 1970.
4. Voir l’importante contribution des compagnons de route d’après-guerre : Janine Bouissounouse, La Nuit d’Autun, le temps des illusions, Paris, Calmann-Lévy, 1977, et The Fellow-travellers, a Postscript to the Enlightenment, New York, MacMillan, 1973.
Encadré:
CARTE DIDENTITÉ
Nom : Münzenberg.
Prénom : Willi.
Date et lieu de naissance : 1889 à Erfurt (Allemagne).
Profession : Cordonnier, puis permanent des organisations communistes internationales, dans lesquelles il s’illustre comme un propagandiste hors de pair ; a été député communiste au Reichstag à partir de 1924.
Domicile : Séjourne principalement à Berlin. Après l’arrivée de Hitler au pouvoir, s’installe à Paris. Nombreux voyages en URSS.
Fin de carrière : En 1938, il est radié du Comité central du parti communiste allemand clandestin (KDP) puis exclu du Parti. Emprisonné en France à la déclaration de guerre, il est retrouvé pendu à la frontière suisse en 1940.