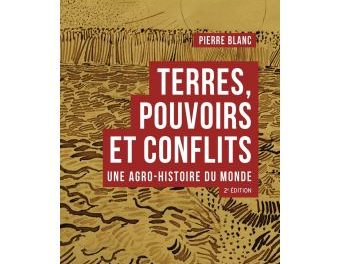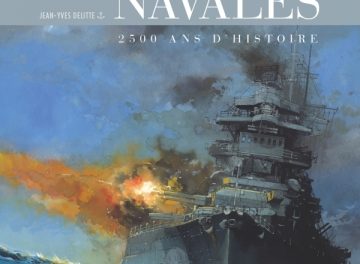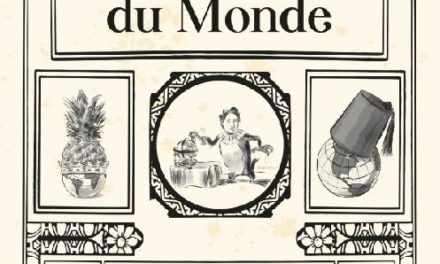« Faire l’histoire d’un mot, ce n’est jamais perdre sa peine » Lucien Febvre
Terme omniprésent dans le vocabulaire, « libéralisme » compte parmi les mots les plus vagues et complexes à définir. Mouvant, aux définitions contradictoires, Helena Rosenblatt entend ici faire l’histoire de ce terme, afin d’en donner une définition claire et neutre (l’auteur se défend d’une lecture partisane), et d’en tracer les évolutions. En somme il s’agit ici de faire « une histoire du mot libéralisme »Helena Rosenblatt, L’histoire oubliée du libéralisme, page 13.
A la faveur de cette relecture, Helena Rosenblatt recentre l’histoire du terme, et donc du concept en lui-même, au niveau de l’Europe continentale. Tranchant avec une approche classique qui fait du monde anglo-saxon le pionnier du libéralisme contemporain, avec des auteurs canoniques comme John Locke ou Stuart Mill ; l’auteur affirme le rôle central de la France et de l’Allemagne dans sa naissance au début du XIXe. Loin d’exalter l’individualisme comme aujourd’hui, le libéralisme est d’abord pensé en conçu comme une doctrine morale mettant en avant contre les dangers de l’égoïsme (pensons à Tocqueville) et soucieuse des valeurs civiques. Helena Rosenblatt entend souligner le rôle central des révolutions françaises du XVIII-XIXe siècles dans la réflexion libérale. Héritage largement méconnu, dépassé par l’« américanisation du libéralisme » (page 17) opérée au cours du XXe siècle.
L’antiquité d’une notion
Pour autant, avant même la naissance du terme, la libéralité était connue et participait de l’éducation des élites sociales. Etre libéral signifiait alors s’impliquer pour le bien commun (la res publica) et « être paré de toutes les vertus du citoyen »Ibid.page 19. Cette libéralité prend forme sous la plume de Cicéron qui, dans Les Devoirs, parle de liberalitas. Reprise par Sénèque, conçue comme une vertu aristocratique (et donc réservée à l’élite de la société seulement), elle sera christianisée et diffusée au Moyen Age via des auteurs comme Saint Ambroise. La libéralité se retrouve dans la charité et l’amour du chrétien et se diffuse dans l’aristocratie médiévale via les arts libéraux.
Cette dynamique perdurera à la Renaissance, les arts libéraux prenant une importance de plus en plus marquée dans la formation princières et élitaires. Le « libéral » devient peu à peu un homme généreux qui, conscient de sa fortune, entend ne pas amasser les richesses pour lui seul mais redistribue une partie de ses biens pour les nécessiteux. Sous l’influence du protestantisme, la libéralité, initialement réservée aux élites, gagne la population. Sans remettre en cause les positions hiérarchiques, les églises (catholiques et issues de la Réforme) et les multiples prêches exhortent à éveiller la population à la libéralité, notamment sur le plan de la connaissance.
L’on comprend ainsi que bien avant Hobbes et Locke, à qui on attribue généralement la paternité du libéralisme, la notion existait dans la conscience européenne. Les théories et apports des deux auteurs sont donc à replacer dans ce cheminement intellectuel, d’autant que, Helena Rosenblatt le souligne bien, les conceptions sont antagoniques. Les Lumières feront évoluer la libéralité en élargissant son périmètre : on ne parle plus seulement de libéraux mais « de sentiments, d’idées et de modes de pensée libéraux »Ibid.page37. Cette libéralité est promue via la tolérance religieuse, qui apparait dans les écrits des contemporains (Locke en premier lieu) et la naissance de la « théologie libérale » en Allemagne et du « christianisme libéral » en Amérique.
La Révolution française : aux origines du libéralisme
La France a joué un rôle central dans l’évolution du libéralisme, passant de vertu individuelle aristocratique à concept politique. La Fayette, Benjamin Constant ou encore Madame de Staël oeuvrèrent en ce sens au cours de la période. Fortement influencé par l’expérience étasunienne, La Fayette pousse dans les premiers temps de la Révolution à lui donner une orientation libérale. La rédaction de la DDHC en est l’illustration, oeuvrant pour la défense des libertés civiles de tous.
La défense de ces principes libéraux sera par la suite assurer par le tandem Constant/Madame de Staël, face aux poussées contre-révolutionnaires de la période du Directoire. Napoléon et le Premier Empire mirent à mal les principes libéraux qu’il avait annoncé vouloir préserver au moment de son coup d’Etat. Au contact de cette politique illibérale, les principaux penseurs du libéralisme français affutèrent leurs idées et les confrontèrent à leur époque : forme de gouvernement, étendue des prérogatives de la puissance publique, importance de la moralité etc. Parallèlement la politique d’expansion française favorisa l’émergence de partis libéraux en Europe (naissance des Liberales espagnols en 1808).
La chute de l’empire napoléonien fut le retour en grâce de la réaction. Associée à l’Eglise, la monarchie oeuvra à dénoncer les idées libérales et à les combattre par une reprise en main spirituelle et développement des missions catholiques. La situation fut équivalente en Allemagne, également en proie aux conflits idéologiques, mais aussi en Grande Bretagne où les tories ne manquèrent pas de dénoncer les libéraux comme étant le « parti français ».
Malgré les efforts de Constant et ses proches pour unifier la penser libérale sur le continent, les opinions demeuraient diverses, notamment sur le plan économique (la majorité des libéraux étant alors loin d’être acquise aux théories du laisser faire). Néanmoins certains traits communs unissaient les libéraux : une réflexion sur les institutions devant bloquer toute dictature ou le rejet du droit de vote universel (de crainte de favoriser par là la montée de tyran).
Le libéralisme au prisme de la question sociale
A la suite des Trois Glorieuses les discours libéraux durent affronter la montée de la question sociale. Les premières dissensions au sein des libéraux apparurent sur la question du droit de vote. Les espoirs incarnés dans Louis-Philippe Ier et Guizot furent rapidement mis à bas, poussant une partie des penseurs libéraux à se « radicaliser » et dénoncer une nouvelle aristocratie basée sur l’argent. Pour autant Helena Rosenblatt met en garde contre toute conclusion hâtive : les libéraux, en dénonçant le nouveau collège électoral, ne sont pas favorables au suffrage universel. Nombreux étaient ceux associant suffrage universel et tyrannie de la majorité.
Certains libéraux radicalisés contribuèrent à fomenter des révolutions dans la plupart des pays européens. Ce fut le cas de l’italien Mazzino, tout autant admiré en Europe que craint, notamment pour ses méthodes violentes. Associé au processus révolutionnaire français, l’usage de la violence fut de plus en plus dénoncé et rejeté, au projet d’une approche réformiste et progressive afin de se rapprocher du modèle britannique.
La crainte du suffrage universel prend place dans un contexte de structuration des discours socialistes, notamment le socialisme scientifique de Marx qui résida en France entre 1843 et 1845. Les contemporains (Lorenz Von Stein) sont conscients de l’importance joué par le régime de Louis-Philippe dans le développement du socialisme : les espoirs de la classe ouvrière placés dans les politiques libérales furent brisés une fois ces hommes au pouvoir. Pour beaucoup l’interventionnisme économique allait entraîner le développement de la paresse dans le monde ouvrier. Cette désillusion fut un carburant pour les discours venus d’Angleterre (Owen) puis d’Allemagne (Marx et Engels). Rapidement le libéralisme fut unanimement attaqué comme doctrine égoïste.
Pour autant, rappelle l’auteur, la question économique demeura un point de division entre libéraux. Certains prônèrent le laissez faire, à l’image de Frédéric Bastiat en France ou William Leggett aux Etats-Unis d’Amérique. Mais nombreux furent les libéraux ne voyant aucune contradiction à l’intervention de l’Etat dans l’économie. Citons à cet effet Tocqueville en France ou Von Stein et Lizst en Allemagne.
Le manque de cohérence idéologique du libéralisme contemporain s’exprime dans d’autres domaines, qu’Hélène Rosenblatt évoque successivement. Sur la question coloniale tout d’abord : si la grande majorité des penseurs s’opposent aux entreprises coloniales dans un premier temps, les discours évoluent une fois dans l’exercice du pouvoir. Les divergences étaient également profondes sur la question religieuse, notamment concernant le catholicisme. Si certains auteurs, comme Montalembert et Lamennais oeuvrèrent à un rapprochement entre le libéralisme et le catholicisme, via leur journal l’Avenir, le pape Grégoire XVI condamna explicitement l’entreprise. Nombre de libéraux non catholiques, mais tout de même chrétiens, se rapprochèrent du protestantisme, notamment en Allemagne (naquirent ainsi dans la décennie 1840 les Amis protestants et les catholiques allemands).
Le choc de 1848
Comme annoncé par Tocqueville, dans un discours resté célèbre rétrospectivement, la monarchie de Juillet chute dans les premiers mois de 1848, incapable de prendre conscience de la montée de la question sociale et de ses propres vices. Ces tensions furent exacerbées par les mauvaises récoltes des années précédentes. Le refus de la tenue d’un banquet fut le point de départ de la révolution. Le renversement de la monarchie de Juillet laissa rapidement la place à l’élection d’une chambre largement conservatrice puis à l’élection de Louis Napoléon Bonaparte comme président, qui rallia rapidement le Parti de l’ordre, devant la crainte d’une poussée socialiste.
L’élection de Louis Napoléon fut perçue comme une terrible nouvelle : « le libéralisme était mort et enterré » Ibid.page 145. Le régime nouveau marchait dans les pas de l’oncle illustre : il était pseudo démocratique, donnant d’immenses pouvoirs au président, légitimé par la souveraineté populaire. Rapidement les commentateurs étrangers nommèrent ce mariage étrange entre libéralisme et pouvoir fort : le césarisme. L’Eglise catholique était, dans le même temps, en pleine mutation. Elu en 1846, le pape Pie IX étendait prendre elle virage libéral.
Cependant la révolution de 1848 fut un électrochoc : celui-ci rejoignit le camp réactionnaire pour ne plus jamais le quitter. Afin d’oeuvrer au réarmement spirituel des peuples européens, le Vatican déploya de grandes campagnes de missions dans les divers pays d’Europe qui furent d’immenses succès (plus de 20 000 personnes pour certaines en Allemagne).
Les libéraux attribuèrent le choc de 1848 non à l’échec des politiques sociales mais à la très faible instruction et éducation morale. Les moyens pour lutter contre la situation firent l’objet de débats. Pour certains la solution résidait dans la diffusion des principes économiques du laissez faire, comme Frédéric Bastiat. Cependant cette approche était loin de faire l’unanimité : la plupart des auteurs allemands la rejetaient, ainsi que de grands penseurs anglais comme John Stuart Mill. Les réflexions libérales remirent également en cause la structure familiale. Cellule centrale de la société, conçue comme premier échelon de l’éducation et de la moralisation de la population, il devenait nécessaire de repenser les rapports entre ses membres, notamment en ce qui concerne les femmes.
Celles-ci devaient éduquer les hommes comme des citoyens respectables et leur transmettre le caractère adéquat. Le mariage devait également être repensé pour ne plus être basé sur le patriarcat. Pour autant la question des droits civiques ne se posait pas : les femmes ne devaient pas voter et participer à la vie de la cité, si ce n’est chez certains auteurs libéraux et notamment certaines femmes comme Harriett Taylor.
Le choc de 1848 remit également en avant la question religieuse et la nécessité, largement partagée, de fonder la moralisation civique sur une religion. Le catholicisme demeurait rejeté et jugé peu à même de remplir cette mission. Au contraire le protestantisme libéral emportait les opinions de la plupart des penseurs abordant la question (Edgar Quinet), ainsi que la franc maçonnerie pouvant « enseigner la religion d’humanité » (page 162).
Césarisme et démocratie libérale
A la question morale, qui explique pour les libéraux le choc de 1848, s’ajoute la question du gouvernement. Les démocraties étaient-elles condamnées à être illibérales ? Le gouvernement de Napoléon III pouvait y faire penser. Les craintes de Constant sur l’hybridation du pouvoir se confirmait dans ce césarisme : « progressiste du point de vue économique tout en étant socialement conservateurs, populaire mais autoritaire »Ibid.page 167. Pour autant, durant les années 1860, devant les crises, Napoléon III dut concéder à la libéralisation de son régime.
Ce fut le retour de Thiers dans le pays qui prit la tête de l’Union libérale. Très divers politiquement, cette Union libérale se retrouvait sur un certain nombre de fondamentaux, notamment la référence au modèle étasunien ou britannique. C’est à cette période que Montalembert forgea l’expression de démocratie libérale. Cette démocratie doit reconnaitre les libertés fondamentales (presse, expression, conscience, éducation). Les discours de Montalembert reçurent un accueil glacé de l’église catholique en la personne du pape Pie IX, ce qui creusa encore davantage le fossé entre libéraux et catholicisme.
Au moment où les libéraux français œuvraient à la libéralisation du régime de Napoléon III, la figure d’Abraham Lincoln émergea, représentant le modèle du dirigeant libérale rêvé. Lincoln fut pourtant attaqué et considéré en son temps, par certains, comme un despote. Pour autant une grande partie des libéraux voyaient en lui le défenseur acharné de la démocratie libérale et admiraient ses positions, notamment sur l’abolition de l’esclavage. Au delà des questions économiques et du périmètre de l’action de l’Etat, ce qu’admirait plus que tout les libéraux européens furent ses qualités morales et sa lutte contre l’égoïsme. Naturellement ces libéraux soutinrent le Nord au cours de la guerre de Sécession, à l’inverse de l’Eglise catholique qui soutint le Sud. La mort prématurée de Lincoln renforça encore sa popularité en Europe.
En Grande Bretagne le premier ministre Gladstone devint également un modèle du dirigeant idéal. Profondément attaché à l’égalité civique, aux libertés de conscience d’expression et de la presse, Gladstone devint le représentant du libéralisme victorien. Loin de réduire le périmètre de l’Etat dans l’économique, le second mandat de Gladstone fut attaqué et considéré comme « socialiste ». Gladstone passait davantage pour libéral en raison de ses qualités morales et personnelles, en oeuvrant pour le bien être général et luttant contre l’égoïsme et l’individualité. Ces mêmes traits de caractère le rendirent très impopulaire dans l’aristocratie britannique.
A l’inverse, à la même période, le dirigeant prussien Bismarck apparaissait comme un contrepoint et un anti-modèle de libéralisme. Parvenu au pouvoir en 1862, sur un concours de circonstances, Bismarck oeuvra dès ces débuts contre le libéralisme allemand en s’entourant de conseillers anti-libéraux (Hermann Wagener). Le mouvement libéral se fissura à son contact. Certains perçurent l’arrivée d’un homme fort à la tête de l’Etat comme une excellente nouvelle et tentèrent de négocier à son contact des évolutions. Ceux-ci formèrent le Parti national-libéral.
Les libéraux gagnèrent effectivement leur pari en obtenant des évolutions notables sur la constitution de 1871 (liberté de la presse, de conscience, liberté des débats). Ceux-ci soutinrent également le kulturkampf de Bismarck, persuadés de soutenir ainsi la liberté. Le kulturkampf fut également soutenu par les libéraux étrangers (Etats Unis d’Amérique et Grande Bretagne) mais fini par se retourner contre eux : Bismarck renversa les alliances politiques à la faveur du parti allemand du centre.
Les libéraux et la question éducative
La chute du Second Empire et la Commune, réprimée dans le sang, marquèrent le monde entier : les journalistes, commentateurs, français et étrangers, accablèrent les communardsEvoquons à cet effet la funeste sentence d’Alexandre Dumas: « Nous ne dirons rien de leurs femelles par respect pour les femmes à qui elles ressemblent – quand elles sont mortes. » et s’interrogèrent de nouveau sur les causes de cette quatrième révolution en moins d’un siècle. La question morale fut de nouveau mise sur le devant de la scène, notamment chez les libéraux qui attribuèrent la déroute de la première puissance militaire de son époque à l‘influence néfaste du catholicisme sur les esprits (Charles Renouvier dans ses écrits publiés dans la revue La Critique religieuse). L’éducation devint un enjeu majeur du nouveau régime républicain.
Cet enjeu est illustré par les lois Ferry et Goblet prises entre 1881 et 1886. Ce nouveau système éducatif était très clairement anticatholique. Les décisions du gouvernement républicain furent facilitées par la très grande présence des protestants dans les instances publiques : le principal architecte de la réforme des écoles françaises, Ferdinand Buisson, était protestant et franc maçon. Selon Buisson le système scolaire se devait d’enseigner les disciplines essentielles et « l’art de vivre en honnêtes gens et en bons citoyens »L’école et la nation en France. Extraits de l’Année Pédagogique (1913).
En cela Buisson admirait le système éducatif étasunien, lourdement influencé par le pédagogue Horace Mann. Ce système faisait d’ailleurs également l’objet d’attaques de la part des catholiques locaux (l’évêque Bernard McQuaid) mais également de tous les orthodoxes qui remettaient en cause cette intrusion du gouvernement dans l’instruction et notamment religieuse. Ce système scolaire était accusé de développer le féminisme et de remettre en cause les bases de la société. Le combat éducatif local fut renforcé par la fondation en 1876 de la Ligue libérale nationale, visant à séparer les Eglises et l’Etat.
L’objectif final de Buisson était double : encourage la liberté de penser chez les élèves tout en développant l’éthique libérale chez le citoyen. Les réformes concernaient également les filles qui devaient bénéficier de réformes profondes afin de faire d’elles de meilleures épouses et mères. L’Eglise catholique répliqua en publiant sous le pontificat de Léon XIII deux encycliques condamnant les lois Ferry et Goblet ainsi que la franc maçonnerie en 1884. L’Eglise récidiva en 1888 en condamnant les libéraux qui suivaient l’oeuvre de Lucifer. Le pape condamne alors l’éducation des filles, le libéralisme et l’américanisme qui gagne le continent et notamment la France.
La stratégie vaticane évolua vers la fin du siècle en reconnaissant le régime républicain pour mieux oeuvrer en son sein. Est ainsi créé en 1901 un nouveau parti : l’Action Libérale Populaire (ALP) qui devait servir de relais à l’Eglise dans sa lutte contre le socialisme et le jacobinisme. Rapidement l’ALP devint une force politique majeure, comptant près de 70 députés à la chambre et devenant l’ennemi résolu d’Emile Combes, anticlérical convaincu.
La querelle des anciens et des modernes
A la suite de la défaite de 1870 la Prusse, et le gouvernement Biscmarck, stupéfia le monde en engagea des réformes étatistes profondes, améliorant la condition physique et sociale de la population : dès la guerre de 1870 les soldats prussiens étaient vaccinés contre la variole, et en 1876 la couverture maladie devint obligatoire pour les travailleurs. Les libéraux se tournèrent rapidement vers les nouvelles idées venues d’Allemagne, notamment économistes pionniers que sont Roscher, Hildebrand ou Knies. Ces économistes analysèrent de manière empirique l’échec des politiques du laissez faire et condamnèrent également d’un point de vue moral l’égoïsme de ces politiques.
Progressivement ces idées gagnèrent les grandes nations européennes et occidentales : le débat fut ouvert en France entre Charles Gide (partisan de la théorie nouvelle) et Léon Say (partisan du laissez faire). Pour Gide la défaite de 1870 sonne le glas de la politique du laissez faire. En Grande Bretagne les défaites électorales du parti libéral poussèrent de nombreux leaders à traduire et étudier les nouvelles théories. Elles gagnèrent également les Etats Unis d’Amérique via le penseur Richard Ely. Ces nouvelles idées se heurtèrent à la résistance des partisans du laissez faire, notamment Spencer ou Sumner. Mais le mouvement de transformation était là et le basculement idéologique était en cours.
Les partisans du laissez faire condamnaient ces nouvelles théories, qu’ils qualifiaient de socialisme. Ces libéraux n’en avaient cure et acceptaient d’être appelés ainsi (Churchill en tête). Une pondération en France fut forgée autour de la notion de solidarisme, portée par Léon Bourgeois, premier ministre en 1895.
Les nouveaux libéraux demeuraient attacher à l’engagement moral auprès de la population. Cet engagement moral s’accompagnait alors à l’époque d’une défense de politiques eugénistes, conçues comme une étape d’amélioration de la race. Ces libéraux demeuraient racistes et adoptaient une approche largement partagée quelque soit le bord de l’échiquier politique. Ces approches eugénistes marquèrent également les politiques vis à vis des femmes, menant les penseurs à considérer les femmes comme plus faibles que les hommes et donc devant être traitées différemment politiquement. L’opposition au droit de vote demeurait forte, pour divers raisons : les femmes étaient gouvernées par leurs émotions, demeuraient des soutiens aux catholiques. Pour autant les oppositions à de tels discours montaient parmi les libéraux, notamment allemands (Baümer, Wieland).
Et le libéralisme devint le credo de l’Amérique
Helena Rosenblatt termine son ouvrage sur le basculement géographique du libéralisme. S’il est né en Europe, en France d’abord puis en Allemagne, le libéralisme gagna peu à peu le monde anglo-saxon, puis traversa l’Atlantique pour devenir, dans l’imaginaire collectif, l’idéologie étasunienne. Le libéralisme s’américanise réellement lors du mandat de Wilson, premier président à se déclarer « libéral » en 1917.
Le rapprochement s’était produit à la faveur de la notion d’empire. Le discours libéral était largement marqué par le colonialisme, dans une volonté civilisatrice menée par le commerce. Les « races supérieures » avaient pour devoir de civiliser les « races barbares ». Or les penseurs britanniques et étasuniens partageraient de plus en plus le mythe anglo saxons : la « race teutonne », par son sang, était digne pour l’a démocratie. Ils devaient oeuvrer collectivement à la diffusion du libéralisme et de la civilisation dans le monde (Andrew Carnegie évoquant même une confédération anglo-saxonne prête à dominer le monde sur une base racialeIbid.page 266).
Peu à peu les libéraux britanniques et étasuniens prirent leur distance avec la pensée européenne, notamment allemande. Le premier conflit mondial confirma cette tendance. L’association Etats-Unis d’Amérique/libéralisme gagna peu à peu les sphères intellectuelles du pays, à travers les cours de civilisation américaine à l’université. La situation bascule définitivement lors du second conflit mondial, effaçant largement les contributions françaises et allemandes à l’histoire du libéralisme.