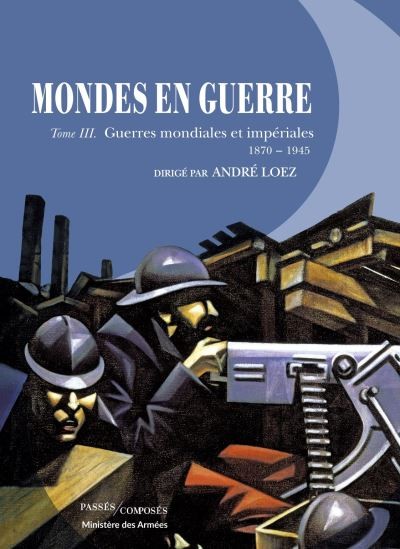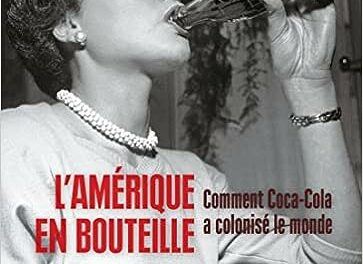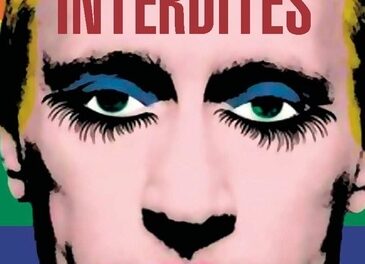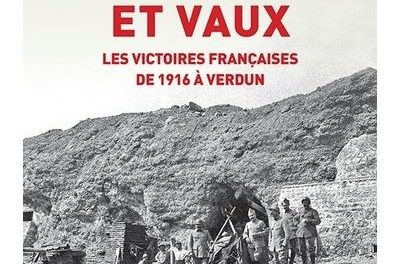Mondes en guerre, suite de la série dirigée par Hervé Drévillon, n’est pas de ceux que l’on peut lire d’une traite. En plus de 750 pages, agrémenté d’une iconographie riche, il est avant tout un outil pour explorer le fait guerrier entre la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle. À la tête d’une équipe de spécialistes, André Loez exprime dès son introduction sa volonté de participer à ce projet extrêmement stimulant en s’inscrivant dans les pas de John Keegan et de son The face of the battle qui, en 1976, a été le premier ouvrage scientifique à rendre physiquement concrets les tourments de la guerre sur le champ de bataille.
Cette guerre est à la fois celle des empires, comme le rappelle l’historien, mais aussi et surtout la guerre qui expose les corps humains aux capacités destructrices décuplées par les bouleversements de la révolution industrielle. Il ne s’agit pas, dans un cadre chronologique classique (1870-1945), d’une étude exhaustive, approche de toute façon impossible, mais les auteurs se proposent d’explorer des facettes multiples d’une guerre, occultant certaines questions pour mieux se centrer sur les acquis de l’historiographie la plus récente. Comme les deux précédents tomes, des cartes, des documents iconographiques mais aussi et surtout des témoignages, des encadrés, rendent cette exploration aussi passionnante que dense.
L’ouvrage est divisé en 3 parties : la première, intitulée « États de guerre », se propose en quatre chapitres d’explorer les enjeux géopolitiques d’une façon assez classique, bien que renouvelée par les apports historiographiques les plus récents. La seconde partie fait la place belle à l’histoire sociale, en s’attelant à l’analyse autant des combattants que des civils, s’appuyant sur leurs témoignages, dans un ensemble qui s’articule autour de six chapitres. Enfin, la dernière partie pousse la réflexion jusqu’aux extrêmes, en centrant son propos sur la violence, sous toutes ses formes, ainsi que les réponses et analyses qui ont pu y être apportées. On le voit il s’agit ainsi avant tout d’une approche thématique, autour de bornes conventionnelles, ce qui permet d’autant plus le papillonnage en fonction des envies.
États de guerre
Le système international et la guerre
Le premier chapitre est consacré au système international et aux guerres. Dans ce sens la réflexion de Jean-Michel Guieu est tout à fait adaptée aux programmes de collège et de lycée, et encore plus à la spécialité HGGSP en Terminale pour son thème 2 consacré à la guerre. Il n’y a pas véritablement de surprises dans l’approche proposée ici. La réflexion s’articule autour de la montée en puissance allemande, entre 1870 et 1890 avant d’explorer le monde d’avant-guerre et la bipolarisation du système international. On retrouvera ici les réflexions sur la construction de deux blocs antagonistes, la Triple-Entente et la Triple-Alliance. Les pages les plus stimulantes sont néanmoins celles consacrées à l’élargissement de la réflexion avec l’affirmation de nouvelles puissances européennes, les États-Unis et le Japon. Dans ces deux cas l’impérialisme ne fait pas de doute. Avec le recul, la course à la guerre semble évidente à l’été 1914. Pourtant l’historien permet aux lecteurs de mesurer combien cette marche irrésistible vers un affrontement généralisé doit être mis en perspective avec les efforts déployés par les puissances pour mettre en place des coopérations, à tous les niveaux, mais aussi plus d’échanges pour la paix. Malgré les nouveaux mécanismes, par exemple la première conférence internationale de la paix en 1899, c’est pourtant bien la guerre qui l’emporte. La question du déclenchement de cette dernière, de ses responsabilités, reste posée sur des charbons ardents. L’historiographie a longtemps fait peser sur l’Allemagne et sa dimension impérialiste la cause essentielle de la guerre mais Jean-Michel Guieu rappelle, fort à propos, les travaux de Christopher Clark autour du rôle central joué par la Serbie et l’alliance franco-russe.
La période 1929 1945 est marquée par « la destruction du système international », pour reprendre les mots de l’historien. Les coups de force, la volonté hégémonique de l’Axe cèdent progressivement la place à l’affirmation de deux superpuissances, les États-Unis et l’URSS. La leçon essentielle de cette période est la mise à l’écart partielle de l’Europe en tant que centre prépondérant des puissances mondiales. Le temps de la Guerre froide, dans un système international bipolaire, s’impose petit à petit.
L’évolution des stratégies et technologies guerrières
La question des technologies et des stratégies est évidemment importante, et ce d’autant plus qu’André Loes a précisé dans l’introduction que cet ouvrage aurait pu s’appeler la guerre industrielle. C’est Yves le Maner qui propose ici, tout au long second chapitre extrêmement limpide, les principales pistes de réflexion nécessaires à la compréhension de ces questions. L’on peut percevoir les racines d’une industrialisation progressive de la guerre, dont les prémices sont perceptibles entre 1850 et 1871, sous la forme de l’augmentation de la puissance de feu des armées. Cette tendance est largement confirmée par les premiers conflits XXe siècle. La force de cet ouvrage est d’être capable d’élargir la focale au-delà des simples cas européens, suivant le chemin de l’histoire globale. Sont donc ici abordées, avec un grand intérêt, la guérilla des Boers et les leçons de la guerre russe japonaise de 1904-1905, certes rapidement, mais fort justement. Les bouleversements induits par les premiers combats de 1914 poussent les belligérants dans une vaste réflexion. Les masses sont colossales : au tout début du mois de septembre, ce sont un million de soldats français et britanniques qui affrontent près de 900 000 Allemands sur un front de 300 km. La question de la logistique est absolument centrale, même si cette dernière existait bien entendu par le passé, mais dans des niveaux bien moindres. Les pertes sont monstrueuses, du fait des nouvelles armes employées, de l’artillerie lourde aux mitrailleuses. L’incapacité à offrir des réponses efficaces de la part du commandement pousse les armées à s’enterrer. Le blocage de leur pensée, structurel, nécessita des pistes de contournement, faisant la part belle aux stratégies navales et aux affrontements périphériques. Des pages de tout premier ordre sont consacrées aux affrontements en Afrique et au Moyen-Orient et à la nouvelle dimension tridimensionnelle de ces mondes en guerre.
L’entre-deux-guerres est marqué par des réflexions techniques et tactiques autour des nouveaux outils, le char, mais aussi l’aviation. Pour cette dernière la question de bombardement stratégique est essentielle, et l’on retrouve les théoriciens plus connus, italien Guido Douhet et l’Américain Billy Mitchell, penseurs de premier plan qui occultent néanmoins souvent les réflexions de Hugh Montague Trenchard, pourtant décisif quant à l’élaboration des principes de bombardement préventif contre les centres urbains. Les pages consacrées à la Seconde guerre mondiale permettent de brosser rapidement plusieurs éléments, somme toute assez connus. Un encadré sur l’ère des missiles est particulièrement stimulant. Le rappel du mythe du Blitzkrieg, sur lequel l’historien allemand Karl-Heinz Frieser a écrit des lignes salvatrices pour montrer combien il n’y avait pas de stratégie préméditée mais davantage le fruit du hasard, les erreurs incroyables du commandant de l’armée française, aggravées par la capacité d’autonomie décisionnaire des commandants d’unités blindées sur le terrain, l’est tout autant. On regrettera peut-être que la doctrine soviétique ne soit pas à tout le moins explorée au-delà d’une simple phrase. L’écrasement militaire de l’Allemagne en 1944, l’opération Bagration, chef-d’œuvre de la pensée opérative soviétique, sont tous juste cités et l’historien continue de véhiculer l’image classique d’une armée Rouge laissant les Allemands écraser l’insurrection polonaise au début du mois d’octobre 1944. Les travaux de Jean Lopez ont montré une réalité plus complexe car les troupes soviétiques étaient incapables à ce moment-là de pouvoir prendre la capitale polonaise. Après plus de deux mois d’une offensive gigantesque ayant offert l’Allemagne sa plus grande défaite de toute son histoire. L’Armée rouge était épuisée et un ultime contre des troupes allemandes menées par le Generalfeldmarschall Walter Model stabilise le front jusqu’en 1945[1] .
États et économies de guerre
Le questionnement économique et la place de l’État sont au cœur du 3e chapitre proposé par Arndt Weinrich. Dans le cadre d’une guerre industrielle, cette question est évidemment essentielle. Au cœur de cette réflexion la notion de mobilisation s’impose. Cette dernière concerne autant la capacité des États à mobiliser les masses, à l’image de l’effort sans précédent des années 1914-1915, que de la capacité encore plus totale explorée tout au long de la Seconde guerre mondiale à tout mobiliser. À travers l’exemple de l’URSS et d’une mise en perspective du cas allemand, sont explorées les pages les plus terribles des travaux forcés, des souffrances imposées aux populations, à l’image du « plan de la faim » de mai 1940 qui prévoyait du côté nazi la réquisition systématique de vivre au profit de la Wehrmacht, afin de détruire près de 30 millions de slaves. Ce voyage au cœur des arcanes étatiques est aussi l’occasion de s’intéresser à la justice militaire, aux fusillés pour l’exemple, mais plus encore de la transformation fondamentale des États. Le caractère total de la guerre, la Première puis la Seconde, a profondément transformé selon l’historien la nature même de l’État. C’est ici que se développe une véritable mystique de l’État, d’un État fort, et ce qu’il s’agisse de l’Allemagne nationale socialiste, de l’URSS ou encore de l’État fasciste. On trouvera avec intérêt réflexion complémentaire sur l’occupation japonaise en Asie et l’approche pratique de l’occupation des territoires conquis par la force.
Conflits et combattants impériaux et coloniaux
Le dernier chapitre de cette partie est l’occasion de suivre Laurent Dornel au détour de pages lumineuses consacrées aux conflits et aux combattants impériaux et coloniaux. C’est ici un véritable tour de force, permis par cette collection, d’embrasser, bien au-delà des sphères occidentales, la diversité des pratiques guerrières à travers le monde dans le cadre d’une véritable histoire globale. La guerre est un fait permanent dans la seconde moitié du XIXe siècle. Reposant sur des mécanismes anciens et accompagnant le décollage industriel, l’historien met au cœur des années 1880 le tournant décisif pour l’appropriation, par la force, de vastes empires coloniaux, essentiellement en Afrique. Conquête de l’Afrique de l’Ouest par les Français, volonté d’acquérir les terres riches en promesses d’Indochine pour la IIIe République à partir de 1882, affrontements meurtriers des Britanniques, mais aussi des Néerlandais au cœur des Indes, autant de champs d’analyse que des exemples portugais, belge, allemand italien et japonais viennent compléter avec force d’analyse. Ces pages sont très stimulantes et permettent de mettre en parallèle des guerres nationales et des répressions souvent méconnues, à l’image de celles ayant cours en Corée 1919 lors de la colonisation japonaise, la guerre marocaine entre 1907 et 1925 pour la France, particulièrement meurtrières (12 500 mort hommes), et des réflexions quant à la nature même de ces guerres. Ainsi on peut se poser la question des moyens qui sont consacrés à ces guerres, de la notion de petite guerre, que les théoriciens ont décliné en guerre d’annexion, de soumission ou de pacification. Au coeur de ces mondes en guerre on trouvera grand intérêt à redécouvrir les réflexions françaises sur la guerre coloniale, à l’image de celles du général Bugeaud, acteur central de la conquête de l’Algérie au milieu du XIXe, ou celle de Lyautey, théoricien de la guerre coloniale à la française. Parmi les documents les plus intéressants qui nous sont proposés, on retrouve des cartes postales italienne de 1935 absolument saisissantes et pouvant être largement utilisées en classe. Toutes autant lumineuses sont les lignes consacrées à l’écho des guerres coloniales dans la métropole, la circulation des informations de tous bords. Assez clairement la Seconde guerre mondiale a accru le poids des empires coloniaux dans l’effort de guerre ce qui, bien entendu, a ouvert la voie aux mouvements de décolonisation qui suivront.
Les épreuves de la guerre
Lieux, formes et expérience de la guerre
Il s’agit ici du cœur de cet ouvrage. Plus encore que pour la première partie, il n’est pas souhaitable de lire ces chapitres à la suite, mais bien d’y venir en fonction de questionnements précis. Tous permettent largement d’agrémenter la préparation de nos cours, sous des angles novateurs et stimulants. Julie Le Gac ouvre le bal brosse dans une synthèse extrêmement précise un état des lieux de la recherche autour des questions concernant les combattants. Qu’ils soient volontaires ou irréguliers, tous se sont confrontés à leur immense vulnérabilité face aux armements industriels. C’est ici que la réflexion de l’historienne trouve ses approches les plus percutantes. Bien qu’il soit impossible de mesurer véritablement les souffrances de la guerre pour nous qui lavons fort heureusement pas vécu, jusqu’ici, avec cette intensité, Julie Le Gac parvient à mettre le doigt sur les ressorts de cette « expérience ahurissante ». Au-delà de la capacité d’adaptation sans bornes des troupes, chose parfois extraordinaire, au-delà des hécatombes, des blessures psychologiques, l’oubli semble impossible. La question du sens de ces sacrifices, la nécessaire nuance apportée au concept de George Mosse de brutalisation, permettant lecteur de nourrir une réflexion d’autant plus intense qu’elle est étayée par de très nombreuses citations et auteurs.
Civils et structures sociales à l’épreuve des guerres
C’est de la même logique que André Loez s’intéresse quant à lui aux civils et aux conséquences sociales de la guerre. Le sujet est immense et les choix de l’historien pour ce chapitre permettent véritablement d’explorer de multiples pistes. Réflexions sur la notion même de l’arrière, en rappelant que les civils furent exposés aux réalités guerrières de façon certes indirecte, mais tout à fait tangible, à l’image des explosions, citées dans la démonstration, de poudrerie à Castres ou Moulins en 1918, bien loin des tranchées. La guerre est un choc économique, dont les répercussions vont bien au-delà des pénuries, de la faim. Les civils sont emportés dans un maelstrom de tensions identitaires, alimentées par une propagande intense. C’est ici que prennent tout leur sens les nombreuses caricatures proposées par le livre, ainsi que les affiches destinée à mobiliser toutes les ressources pour la guerre totale. L’on découvre la militarisation du travail, afin d’obtenir toujours plus de productivité, ce qui perceptible autant chez dans l’URSS stalinienne que dans les démocraties occidentales. De très nombreux graphiques permettent de soutenir la démonstration qui va d’une étude fine des campagnes en Europe mais aussi en Afrique, à travers l’analyse des restructurations agraires, que de l’étude, à la suite des travaux de Walter Scheidel, des inégalités sociales sur la longue durée, des grèves ou de la nécessaire renégociation du contrat social après la guerre. La conclusion de l’historien et sans appel : après des espoirs de gains initiaux la guerre est d’abord le moment de la perte de presque tous, avec le seul espoir que Phobos laissera les vivants en paix.
Rapports sexués et redéfinition des rôles féminins et masculins à l’épreuve des conflits
Manon Pignot se propose quant à elle d’aborder les questions du genre dans les entrailles des mondes en guerre. Si ce chapitre est plus court que les précédents, il ne reste pas moins très intéressant quant à la diversité de ces problématiques. Qu’il s’agisse de la place des hommes et des femmes dans ce conflit, tour à tour en tant qu’acteurs ou victimes, des questionnements autour des transformations des rôles ou des questions plus intimes de la sexualité, l’historienne parvient à brosser un tableau parfaitement étayé de ces questions essentielles. Si l’on peut – malheureusement – s’attendre aux lignes sur le viol comme arme de guerre, la place des femmes combattantes héritées véritablement que l’on s’y attarde, ce qui est fait ici de façon admirable. Car la guerre est aussi le moment de l’affirmation des femmes, comme en témoigne Lucie Aubrac citée dans le chapitre, le moment d’une émancipation potentielle. Tout ceci pose nécessairement la question de la nouvelle place des hommes, la peur d’un déclassement, d’atteindre virilité. Des lignes passionnantes nous permettent de mieux cerner la place des travaux consacrés aux prisonniers, mettant en avant la faim, la misère sexuelle, la question de l’homosexualité qui, fait paradoxal, peut s’affirmer comme un exutoire là où elle était jusqu’ici largement cachée. Même si les stéréotypes virils restent la norme, ce chapitre montre combien la recherche nous permet aujourd’hui de mieux saisir la complexité de ces questions.
La guerre comme expérience idéologique et politique
Fait politique total la guerre est bien entendue au cœur de matrices idéologiques et politiques. La période traitée permet d’aborder 3 axes définis ainsi par Stéphanie Prezioso : Guerre ou révolution ? 1870-1914, Guerres et révolutions 1914-1922 et enfin Révolutions au fascisme ? 1922-1945. Ce découpage somme toute attendu permet de mesurer les acquis de la guerre sociale incarnée par la commune de Paris, véritable matrice pour les révolutions postérieures, tout en plongeant dans les rêves belliqueux des nationalistes nourrissant la ferveur guerrière de 1914. La guerre est aussi l’occasion de nourrir les espoirs révolutionnaires ; ceux de 1917, suivi des mouvements de contre-révolution qui court jusqu’en 1922. À cet égard les affiches soviétiques proposées en illustration sont de merveilleux moments et des supports tout désignés par des préparations de cours. Le chapitre permet également, en s’appuyant sur de nombreuses citations et textes, de plonger dans les arcanes des mouvements internationalistes, des milices et autres formations paramilitaires qui agrémentent de sortir de la première guerre mondiale. Un long moment est consacré à la guerre d’Espagne, mise en perspective de façon judicieuse avec la guerre civile chinoise. C’est ici toute la force des allers-retours dans la guerre, qui permettent de mieux comprendre les ponts nécessaires entre les différentes régions du monde secouées par ces tumultes révolutionnaires.
Quitter le combat, chercher la paix
La guerre étant au centre des réflexions il eût été impensable de pouvoir occulter son visage de Janus, la paix. Derrière les évidences des mots qui viennent à l’esprit, antimilitarisme, pacifisme par exemple, Nicolas Offenstadt pousse l’analyse au cœur des combats et « au-dessus de la mêlée ». Utilisant massivement les tracts, les citations, l’historien plonge dans les mécanismes révolutionnaires de 1917, dans la matrice de la désertion et de la lutte contre cette dernière, à l’image de l’ordre de 227 de Staline du 28 juillet 1942. C’est une question qui est au cœur de lignes consacrées à la cohésion des troupes, à la capacité des soldats à rester face à la charge de blindés. Si les désertions touchent tous les camps, la mobilisation idéologique radicale qui concerne, sur le front de l’Est, les deux camps, permet de comprendre comment, malgré des exemples nombreux de désengagement de troupes, la structure n’a jamais véritablement été mise à mal, comme l’ont montré les travaux d’Omer Bartov. Mais la Première est encore plus la Seconde guerre mondiale ont profondément bouleversé les mentalités pour la paix. Le militantisme pour cette dernière a pu être critiqué pour avoir permis l’arrivée des nazis et donc générer la guerre, mais la guerre froide qui commence, la menace de l’arme nucléaire sont autant de pistes qui vont lui offrir de nouvelles perspectives, sans doute dans le prochain tome.
Images, témoignages et représentations de la guerre
La fin de cette partie de l’occasion de toucher de plus près les acteurs et leur représentation de la guerre. Plusieurs supports permettent de s’y attarder et, dans les pas de André Loez, l’on peut suivre la tradition de l’écrit qui concerne toute la période étudiée, mais aussi les mutations picturales qu’il s’agisse d’art, mais aussi de photographies et, petit à petit, de films des combats. C’est ce qui irrigue l’intégralité de ce nouveau chapitre. La guerre est de plus en plus vue, dans toute son horreur, et ce dès les premières photographies de guerre dues à Roger Fenton lors de son reportage photographique de mars à juin 1855, en Crimée, ou une décennie plus tard à travers le Photografic Sketch Book d’Alexander Gardner (1863), écumant les champs de bataille de la Guerre de sécession. La photographie change tout. Dès le départ surgissent les premières manipulations à des fins de propagande. Mais le principal bouleversement vient de l’abandon progressif du visage strictement héroïque du combat, pour une vision beaucoup plus dure de la guerre, beaucoup plus réaliste dans sa capacité à transmettre les bouleversements de ses âmes humaines. Ici sont questionnées la nécessité de transmettre, à la fois pour les militaires tels Éric Maria Remarque ou Ernst Jünger, ou pour des civils aux portes de la mort dans les camps ou les ghettos de la Seconde guerre mondiale. Il est d’ailleurs important de noter que ces témoignages sont là pour dénoncer, transmettre une vérité sur l’horreur de ces faits, mais aussi, dans le cas Ernst Jünger, s’agit-il de transmettre une fascination pour ces moments terribles. Dessins plus personnels, photographies, peintures, sont autant de sources utilisées ici avec une grande justesse. La diabolisation reste bien entendu souvent la clé, dès lors qu’il s’agit de propagande, avec toutes les limites induites. À cet égard les ultimes lignes de l’historien soulèvent des questions que le prochain tome ne devrait pas occulter : la révolution audiovisuelle et sa capacité à transmettre la guerre doivent être profondément questionnées quant à leur but, quant aux rapports la vérité.
Les extrêmes de la guerre
Les civils entre combats et politique de violences
Cette dernière partie est concentrée sur 3 thématiques : les victimes, la violence et enfin les crimes et leurs résolutions judiciaires. Le chapitre rédigé par Tal Bruttmann offre une brillante synthèse des acquis de la recherche de la part de l’un des meilleurs spécialistes de la question. Pour les personnes ayant déjà été confrontées à ces travaux, il n’y aura pas de surprise quant à la qualité de la démonstration. Parmi les équations décisives des guerres de la fin du XIXe et de cette première moitié du XXe siècle, se trouve la place des populations qui deviennent, dès la Guerre de sécession, des cibles à part entière. L’intérêt de l’analyse est ici de démontrer combien, à la suite d’une analyse fine des méthodes de Sherman entre 1860 et 1865, comment se développent petit à petit une réflexion stratégique visant à dépasser la ligne de front comme simple lieu de violence pour frapper la profondeur. Passées les tentatives du type « grosse Bertha » de 1918, c’est bien par la voie aérienne que cette mort se transmet. Dans ce sens les villes deviennent une cible privilégiée, et ce quelque soit les camps et les théâtres d’opérations. L’une des réflexions les plus stimulantes a trait à la volonté de contrôler l’arrière des armées, parce que les civils sont parfois considérés comme une menace potentielle. Si ceci a pu être largement étudié sur le front de l’Est, à travers les agissements de la Wehrmacht, tout l’intérêt de la démonstration et de rappeler que l’on retrouve ce type d’approche de façon antérieure et sur différents théâtres d’opérations. On peut citer la guerre d’indépendance cubaine (1895-1898) à la suite des tactiques donc déployées durant la Guerre de sécession aux États-Unis (1860-1865), mais également l’écrasement de la révolte Hereros par les Allemands dans le sud-ouest africain (1904) sans occulter bien entendu les différentes exactions durant la Première guerre mondiale, en Serbie, au Monténégro etc. Une partie de ces agissements s’explique par la crainte de laisser sur ses arrières des civils, combattants en puissance, ce qui a particulièrement été le cas au sein des troupes allemandes. On comprendra également que ces derniers ne sont pas les seuls à être étudiés, à l’image des Japonais qui utiliseront jusqu’au bout des combats et civils comme bouclier humain. Ces pratiques conduisent petit à petit vers des logiques de destruction, alimentées par une volonté d’uniformisation nationale autant qu’une volonté de se débarrasser de certaines populations. Bien entendu, un long développement est accordé à la Shoah mais aussi au génocide des Arméniens entre 1915 et 1916. Un encart consacré au centre de mise à mort ou à la conférence de Wannsee permettent d’alimenter la réflexion et de combler les éventuelles failles historiographiques de toute chaque. De façon extrêmement saisissante l’historien conclut par une mise en perspective de l’héritage de la violence durant les conflits, à travers par exemple l’analyse du Ku Klux Klan, né dans le Sud des États-Unis, nourrit de violences héritées de la Guerre de sécession. Dans ce sens, les guerres ne sont pas perçues par l’historien comme de rupture mais des continuités, des moments au cours desquels la violence devient paroxysmique, libérée des chaînes du droit de temps de paix.
La violence de guerre, les acteurs et leurs interprétations
L’avant-dernier chapitre de l’ouvrage est coécrit par André Loez et Nicolas Mariot. Il s’agit avant tout d’une excellente mise au point scientifique historiographique sur la question de la violence. Bien entendu les violences de guerre ne sont pas nées avec les deux conflits mondiaux. Mais l’historien met en avant que ces violences du XXe siècle ont pour singularité de s’être développées au cours d’un siècle qui visait justement à encadrer plus que jamais la guerre. Ainsi trois périodes se détachent : la première court de 1945 aux années 80 et se focalise sur les crimes nazis et « la banalité du mal » définie par Anna Arendt. Les années 1990 marquent un tournant qui s’inscrit dans la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. La focale se resserre autour des hommes ordinaires, ses bourreaux bon père de famille, tout comme ces femmes qui participaient au fonctionnement des camps. Éclate enfin au grand jour les crimes de la Wehrmacht et des Einsatzgruppen pour le grand public, se développe toute une suite de travaux cherchant à mesurer les violences dans le temps long, mais aussi cherchant définir des cultures de guerre. Vers cette approche par exemple retrouve certains travaux autour de la violence supposée des Japonais qui seront inscrits dans la culture, ici largement remise en cause par les auteurs. C’est tout le champ de travaux qui continuent de foisonner depuis les années 2000, et d’un appel final des historiens une inventivité nouvelle pour poursuivre l’étude de ces questions.
Droit de la guerre, transgression et procès
Comme un écho à ces propositions, le dernier chapitre de Guillaume Mouralis est clairement plus technique et s’intéresse à la construction d’un droit international, la question des procès, par exemple se de Tokyo ou de grammaire, au jugement nécessairement partiel des vainqueurs. Suite au procès d’Eichmann, on retrouve une mise en perspective des procès français, ceux de Klaus Barbie en 1987, de Paul Touvier en 1994 encore de Maurice Papon entre 1997-1998. Toutes ces questions restent donc complètement dans l’actualité et il est intéressant, afin de lancer des pistes pour le dernier tome de cette collection, de mesurer combien le droit international de la guerre, qui s’est petit à petit structuré au XIXe siècle, a imposé des notions de crimes de guerre qui ne sont pas totalement acquises. Si le cas des États-Unis et de la guerre du Vietnam, entre autres, pose clairement question, voici une piste pour le dernier tome qui couvrira la période de 1945 à nos jours.
***
Il est difficile, en guise de conclusion, de rendre véritablement compte de l’immense richesse de ce livre. Si des choix ont été faits, écartant certaines problématiques, il n’en reste pas moins que cette somme est complètement indispensable pour qui désire comprendre le phénomène guerrier de la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle. Qu’il s’agisse d’une remise à niveau historiographique, il s’agisse d’exploiter la richesse iconographique, il s’agisse de mettre en perspective les théâtres d’opérations extrêmement variées, ce livre est une pure réussite, à tous les niveaux.
[1] Jean Lopez, Opération Bagration : La revanche de Staline (1944), Paris, Economica, 2014, 409 p.