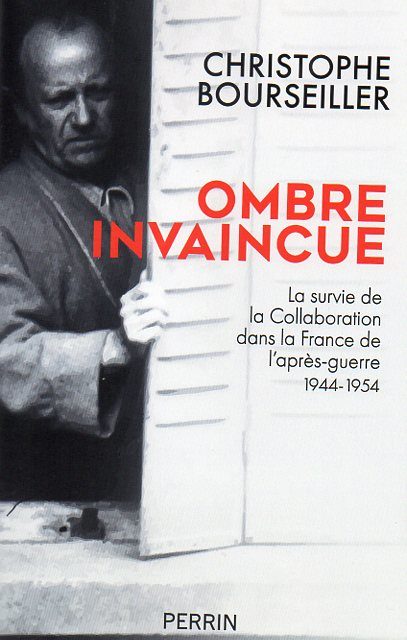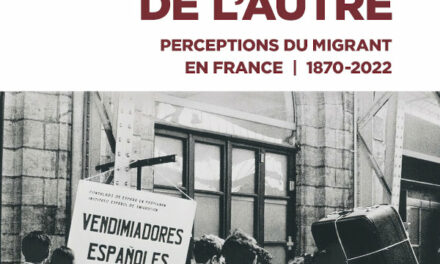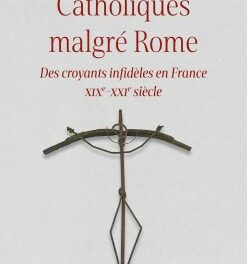Christophe Bourseiller est acteur de cinéma et de théâtre, journaliste, animateur et producteur à la radio et à la télévision, enseignant à l’Institut d’études politiques de Paris, écrivain (spécialiste notamment des mouvements minoritaires, des musiques industrielles et de la new wave des années 1980, des extrémismes politiques et des contre-cultures), historien. Il est l’auteur d’une cinquantaine de livres, dont Les Maoïstes, Vie et mort de Guy Debord, Nouvelle histoire de l’ultra-gauche, La Nouvelle extrême droite. Cet ouvrage est tiré de sa thèse de doctorat entreprise sous la direction de Pascal Ory, « Ombre invaincue. De la destruction du “collaborationnisme” à sa survie dans la France de l’après-guerre, 1944-1954 », soutenue en décembre 2019.
Les collaborationnistes, les hommes et leurs idées, ont-ils eu une influence sur la France de l’après-guerre ?
« Sol invinctus. » Soleil invaincu, est le titre du troisième tome des Mémoires de Georges Soulès, alias Raymond Abellio, socialiste dans les années 1930, devenu le chef du Mouvement social révolutionnaire (MSR), petit parti collaborationniste, raciste, antisémite, pronazi, issu des réseaux de la Cagoule des années 1930. L’expression fait référence au culte de Mithra dont elle est la devise. Soulès, qui ne renie en rien son engagement pronazi (condamné, amnistié, libéré, il est un citoyen libre quand il publie ce livre en 1980 et peut se permettre de ne rien cacher), insiste sur la continuité de son parcours qui perdure dans la France d’après-guerre. Tiendrait-il le collaborationnisme (l’engagement aux côtés de l’Allemagne nazie) pour « un soleil invaincu » ?
C’est la question que pose Christophe Bourseiller dans les premières lignes de son introduction, la précisant ainsi « La Collaboration et son héritage se résument-ils à un astre trompeur ? Comment évaluer l’impact des idéologies collaborationnistes et des réseaux ultras dans la France de l’après-guerre ? » Les collaborationnistes, partisans d’un alignement complet de la France sur les positions hitlériennes, dont beaucoup se sont engagés dans la SS et ont revêtu l’uniforme de la Wehrmacht, ont-ils eu une influence sur la France de la Libération et de la IVe République ?
Pour y répondre, Christophe Bourseiller a choisi l’étude, dans la décennie 1944-1954, de trois mouvances collaborationnistes : le Parti populaire français (PPF) de Jacques Doriot, le Rassemblement national populaire (RNP) de Marcel Déat, et la nébuleuse « cagoularde » qui donne naissance au Mouvement social révolutionnaire (MSR) d’Eugène Deloncle, puis à la Milice. Il est dommage que la 4e mouvance, celle du Francisme de Marcel Bucard, n’ait pas été étudiée, ce qui n’aurait pas semblé démesuré dans le cadre d’une thèse de doctorat, d’autant plus qu’une large partie de l’étude porte sur la période du collaborationnisme de guerre, déjà bien connue.
Les sources empruntent largement à des biographies, à des ouvrages d’anciens collaborationnistes et à des études historiques. S’y ajoutent des sources policières et judiciaires, et des documents de propagande (tracts, journaux, affiches (Christophe Bourseiller a constitué une exceptionnelle collection d’environ 500 boîtes d’archives).
L’ouvrage est structuré en trois parties chronologiques : « Avant la destruction » couvre la période de l’avant guerre à la fin de l’année 1943 ; la seconde partie « Pendant l’Apocalypse » traite en trois chapitres de la période qui va de janvier 1944 à mai 1945 ; la troisième partie, « Après l’Enfer » traite à elle seule du thème annoncé comme étant la problématique de l’ouvrage : le devenir des collaborationnistes et de leurs idées dans la France des dix premières années de l’après-guerre. Les cent dernières pages de l’ouvrage sont constituées par une chronologie, trois documents annexes, des notes, les sources et la bibliographie, et un index riche d’un millier de noms (l’auteur cite énormément de noms propres).
Des années 1930 à la fin de 1943
Jacques Doriot et le PPF
« Nationaliste, socialiste, impérialiste, antisémite, dominé par la figure inamovible d’un leader inamovible, Jacques Doriot, le PPF peut être décrit comme un parti fasciste à la française ». Créé en 1936, il se perçoit comme un mouvement de type nouveau, au contenu idéologique qui prétend ouvrir une troisième voie, populiste, entre le capitalisme et le communisme.
Il fonctionne sur le modèle léniniste du centralisme démocratique et beaucoup de ses membres fondateurs viennent du parti communiste ; les autres du socialisme et de l’extrême droite. Munichois en 1938, Doriot soutient Pétain en 1940, puis lance l’idée d’une Légion des volontaires français contre le bolchévisme (LVF), s’enrôle pour combattre sur le front russe et se place résolument dans l’orbite idéologique nazie. Financé par l’Allemagne, il devance ou répond à toutes ses exigences. Beugras, adjoint de Doriot est immatriculé au sein de l’Abwehr et participe activement à la chasse aux résistants.
Marcel Déat et le RNP
Normalien, Marcel Déat est au sein de la SFIO des années 1930, un socialiste pacifiste, anticommuniste et munichois. En 1940, il est proche de Laval et prône à Vichy la création d’un parti unique, qui serait un parti totalitaire à la française. Déçu par Pétain, il décide de créer son propre parti, soutenu par Abetz, « ambassadeur » du Reich à Paris, et Laval. Il rencontre le cagoulard Eugène Deloncle qui fait partie de l’équipe dirigeante alors qu’il a déjà fondé le MSR.
L’attentat de Paul Colette contre Laval et Déat, le 27 août 1941 est la cause profonde de la rupture entre Deloncle et Déat. Le RNP perd les deux tiers de ses membres qui rejoignent le MSR. Déat en fait un parti aligné totalement sur le Reich, ancré idéologiquement dans une gauche socialiste, soutien de Laval et de la collaboration d’Etat. Son second, Georges Albertini est un socialiste planiste, anticommuniste et pacifiste. Leur programme est de nazifier la France pétainiste et de collaborer totalement avec le Reich.
Eugène Deloncle et la Cagoule
Polytechnicien, ingénieur, administrateur de sociétés, Eugène Deloncle est un dissident de l’Action française. En juin 1936, il est l’un des créateurs d’une organisation terroriste clandestine, l’Organisation secrète d’action révolutionnaire nationale (OSARN), qui devient l’OSAR, mais est plus connue sous le nom de « Cagoule ». Ami de Deloncle, Eugène Schueller, fondateur de L’Oréal est le principal soutien financier de la Cagoule, sans toutefois apparaître dans l’organigramme.
L’organisation assassine (Filliol est un véritable tueur), infiltre (Henri Dupré s’infiltre dans les Brigades internationales), fait sauter le siège du patronat (pour en faire accuser les communistes) et fait du renseignement (Deloncle est en contact avec Loustaunau-Lacau, proche de Pétain. Parmi les jeunes gens qui gravitent autour de la Cagoule, figurent Pierre Guillain de Bénouville et François Mitterrand, dont les amis François Dalle et André Bettencourt sont des proches d’Eugène Schueller (Bettencourt épousera Liliane Schueller). Tout au long de l’ouvrage, le parcours de Mitterrand est l’objet d’une grande attention de l’auteur.
La Cagoule est démantelée, dissoute (dans la mesure du possible), et ses membres arrêtés. Mais beaucoup disparaissent. Sous l’Occupation, les cagoulards restent en contact et maintiennent des liens d’entraide. Or ils vont appartenir à trois camps opposés : les uns gagnent Londres et sont des acteurs majeurs du BCRA, service secret de la France libre (Maurice Duclos devient « Saint-Jacques », adjoint d’André Dewavrin (« Passy »), lui-même d’extrême droite, Pierre Fourcaud devient « Barbès » ; les autres sont à Vichy : Raphaël Alibert, Georges Groussard, Gabriel Jeantet (suivi par François Mitterrand) ; enfin les derniers suivent Deloncle au MSR et dans le collaborationnisme pronazi : Jacques Corrèze, Jean Filliol, Georges Soulès, Eugène Schueller. Ils s’engagent dans des attentats antisémites dont la logistique est nazie.
Du début de 1944 à mai 1945
Les trois chapitres de la seconde partie sont chronologiques : de janvier à juillet 1944, « L’espoir se désagrège » ; d’août à décembre 1944, « Le temps des repliés » ; de janvier à mai 1945, « La grande dispersion ». Au sein de chaque séquence chronologique, les trois mouvances sont étudiées successivement. Ce qui impose quelques redites, compte-tenu du fait que leurs actions se croisent, qu’ils rivalisent et participent à d’éphémères structures politiques communes.
Des groupuscules pronazis radicalisés
e PPF se transforme en un groupuscule paramilitaire qui combat la Résistance aux côtés des SS et de la Wehrmacht et sombre à l’occasion dans le banditisme. Le PPF crée un Comité des amis de la Waffen-SS française. Marcel Déat entre dans le gouvernement de Pierre Laval comme « ministre secrétaire d’Etat au Travail et à la Solidarité nationale », avec Georges Albertini comme directeur de cabinet. Son action majeure est de faciliter le départ des jeunes au STO. Quand a lieu le Débarquement allié en Normandie, il affirme sa solidarité avec l’Allemagne.
Les cagoulards s’investissent dans la Milice que dirige Joseph Darnand. Les chefs régionaux font régner la terreur, torture et sadisme sont de rigueur. Darnand revêt l’uniforme de la Waffen SS. Ce qui n’empêche pas le résistant Guillain de Bénouville d’accepter les contacts avec ses anciens amis cagoulards, en particulier Jehan de Castellane. Tandis qu’il crée à Genève la société L’Oréal, Eugène Schueller participe aux journées organisées par l’agence de presse pronazie Inter-France. Deloncle est tenté par le double jeu et rencontre le général Giraud. Il est arrêté, incarcéré et finalement assassiné sur ordre du SS Helmut Knochen.
Repli vers l’Allemagne et luttes intestines pour un pouvoir illusoire
A l’été 1944, l’objectif de Doriot est de devenir le Gauleiter d’une France hitlérienne. « Il joue une carte personnelle et sectaire ». Il est, et restera encore longtemps, persuadé de la victoire allemande à laquelle Deloncle a cessé de croire. Quand les Alliés approchent de Paris et que les Allemands ordonnent le repli, le PPF organise son exode vers l’Est. Un convoi est constitué par les militants, les familles, des journalistes, des écrivains (Lucien Rebatet). Nancy devient le point de ralliement de tout ce petit monde. Doriot fait étape à Donremy avant de s’installer sur le sol allemand, à Neustadt, chez son ami le Gauleiter SS Josef Bürckel.
Déat, Darnand, Doriot et de Brinon sont convoqués en août par Hitler qui les reçoit près de Rastenbourg, en présence de Ribbentrop. Il est décidé que De Brinon prendra la direction d’une « Délégation gouvernementale française chargée de la défense des intérêts nationaux ». Furieux, Doriot rencontre Himmler et obtient le droit de monter une agence de renseignement en liaison avec la SS. Ne pouvant demeurer à Neustadt après la mort de Bürckel, et refusant de gagner Sigmaringen, les hommes du PPF s’éparpillent et la direction centrale s’installe à Meinau, sur une ile du lac de Constance.
Doriot obtient une entrevue personnelle avec Hitler ; Alors que l’Armée rouge est à 80 km de Rastenbourg, il vient demander la garantie que la Lorraine restera française quand la Wehrmacht aura reconquis la France grâce aux armes nouvelles. Surréaliste ! Il s’efforce d’organiser une « résistance » PPF clandestine à « l’occupation judéo-bolchévique » de la France. Un premier parachutage d’agents PPF a lieu en région parisienne. Sitôt arrivés, ils sont arrêtés.
Marcel Déat s’absorbe dans ses occupations de ministre d’un gouvernement en exil et dans la rédaction de ses éditoriaux de L’Œuvre. « Il demeure fidèle à son rêve socialiste, européen et collaborationniste ». Après une tentative de mini-putsch contre Laval, il est démissionné par ce dernier de son ministère. En août, quand il faut partir, il panique. Le repli vers l’Est des membres du RNP est improvisé et désorganisé. Après la réunion chez le Führer, il intègre la Délégation gouvernementale et s’installe à Sigmaringen, avec les autres membres de la Délégation, ainsi que Pétain et Laval. L’auteur décrit ici une situation bien connue.
La Milice multiplie les exactions contre la Résistance, tortures, viols, assassinats. Mais les miliciens doivent aussi se replier : ils passent par Belfort, puis sont logés… au camp de concentration du Struthof, qui vient tout juste d’être vidé de ses occupants. En septembre, 6 000 miliciens et 4 000 femmes et enfants émigrent en Allemagne. Les SS imposent à une partie des hommes d’intégrer la division SS Charlemagne et de partir combattre en Poméranie, puis à Berlin. Ils sont « la chair à canon du nazisme mourant ».
Sauve qui peut !
En décembre 1944, Ribbentrop a demandé à Doriot de créer un « Comité de la libération française ». C’est un « édifice branlant », un agglomérat de groupuscules. Au début de l’année 1945, Doriot fonde Radio-Patrie et y prononce une allocution dans laquelle il affirme qu’il « rétablira la France dans son unité territoriale et impériale ». 95 hommes sont parachutés en France, 86 sont arrêtés. Le 25 février 1945, la voiture de Doriot est mitraillée par un avion ; il est tué sur le coup. C. Bourseiller fait le point sur les thèses relatives à l’origine de la mort de Doriot, pour se rallier à celle d’un avion allié en maraude. Les leaders du PPF se déchirent pour lui succéder. En avril 1945, il faut quitter Mainau, direction Lindau, Bregenz, puis Malles en Italie, où sont brûlés les archives et les drapeaux. Certains, dont Jean-Hérold Paquis, s’engagent dans la montagne pour gagner la frontière suisse.
Les autorités allemandes organisent l’évacuation groupée de la Délégation. Déat part avec Pétain, Laval et d’autres. Le couple Déat tente sa chance ensuite avec le couple Luchaire. Luchaire, trop sûr de lui est arrêté, remis aux autorités françaises, incarcéré, jugé et fusillé le 22 février 1946. Déat se montre plus avisé. Il prend la route de l’Italie où il va, lui, le socialiste laïc d’avant-guerre (il est vrai gagné par la foi en ces temps difficiles…), bénéficier du solide réseau du clergé catholique dans l’aide aux nazis et collaborationnistes. De presbytère en couvent, il gagne Turin où il s’installe avec son épouse. Il y mourra le 5 janvier 1955, sans que les autorités françaises n’aient fait beaucoup d’efforts pour le retrouver.
Quelques miliciens non intégrés dans l’armée allemande sont recrutés par Filliol au sein d’une « Organisation technique », forte de 80 hommes et de quelques femmes, qui doivent s’introduire en France pour y réaliser des sabotages. Qu’ils soient parachutés ou qu’ils s’introduisent par les frontières terrestres, ils sont tous arrêtés, stupéfaits de ne pas être accueillis à bras ouvert par un peuple qu’ils croyaient soumis à la terreur bolchévique ! Darnand compte lui aussi sur les réseaux catholiques ; mais il se fait prendre en compagnie d’un prêtre par un officier anglais qui le remet à la sécurité militaire française. Il est porteur d’un trésor estimé à 200 millions de francs qu’il entend remettre à l’Etat français. Il est incarcéré à Nice.
1945-1954 : L’influence des collaborationnistes et de leurs idées
Même si l’étude apporte peu de faits nouveaux et si elle est d’abord une synthèse, la troisième partie est la plus originale de l’ouvrage. Elle se compose de trois chapitres thématiques, traitant successivement de la survie des hommes et de leurs idées dans la France démocratique. Il est difficile de ne pas céder à l’écœurement en suivant les itinéraires de beaucoup d’hommes qui furent ouvertement engagés aux côtés des nazis, antisémites autant qu’eux, et de les voir réapparaitre dans une France démocratique, innocentés, faiblement condamnés, amnistiés, défendus, sans renier leurs idées, engagés dans la reconstruction de l’extrême droite et dans la propagation de leurs fantasmes racistes.
Mais l’intérêt de cette partie ne consiste pas seulement à mettre en évidence cet aspect des choses : l’auteur montre qu’il y a une filiation entre le PPF de Doriot et le populisme du Front national, de même qu’entre l’idéologie du RNP et du MSR et la construction européenne autour d’un axe franco-allemand.
On aurait attendu, dans le cadre d’une thèse de doctorat, une présentation moins datée et plus rigoureuse de l’épuration extra-judiciaire et judiciaire des collaborationnistes. Après les quelques pages qui lui sont consacrée, l’auteur présente brièvement les réseaux qui cachent, protègent et exfiltrent les collaborationnistes vers l’Italie, l’Espagne et l’Argentine. Le Comité international de la Croix-Rouge y figure en bonne place, ainsi que l’Eglise catholique et les services secrets américains.
« Du fascisme doriotiste à la refondation d’une extrême droite populiste »
Le chef est mort, de nombreux doriotistes sont exécutés dans le cadre de l’épuration extra-judiciaire ou après des procès légaux. Mais il en passe suffisamment entre les mailles du filet pour que se reconstitue un réseau post-PPF qui contribue à rebâtir l’extrême droite. Lucien Rebatet est condamné à mort ; soutenu par de nombreux intellectuels (dont Bernanos, Camus et Mauriac), il est gracié par le président Vincent Auriol et libéré dès 1952. Parmi ceux qui s’étaient enfuis en Amérique du Sud, plusieurs rentrent en France après les amnisties de 1951 et 1953, ou dans les années 1970 grâce à la prescription.
Ils créent des journaux et bulletins plus ou moins confidentiels pour relativiser leurs crimes et plaider leur cause. Dès 1947, Ecrits de Paris devient le pôle de ralliement des anciens collaborationnistes. René Binet, un ancien de la Waffen SS fonde un parti nommé Mouvement socialiste d’’unité française qui professe « un racisme absolu et défend un fascisme décomplexé ». Après son interdiction par Jules Moch, Binet se rapproche de Maurice Bardèche qui est « un homme neuf, issu de la littérature, qui symbolise le renouveau de l’extrême droite ». « Jeune Nation » rassemble d’anciens francistes (les frères Sidos), Tixier-Vignancour, d’anciens SS français et se réclame ouvertement du Francisme et du PPF.
Le congrès de Malmö, en mai 1951, inaugure la reconstruction d’une extrême droite européenne. L’ancien dirigeant du PPF, Victor Barthélémy, fait partie de la délégation française. Au retour, Bardèche lance la revue Défense de l’Occident, qui « joue un rôle considérable dans la reconstruction idéologique d’une extrême droite ouvertement néofasciste et nostalgique de la période nazie ». La même année 1951 le journal Rivarol, fondé par un ancien de la Waffen SS devient l’épicentre et la vitrine de la renaissance de l’extrême droite.
Les groupuscules prolifèrent qui contribuent à nourrir l’essor du populisme, défini par l’auteur comme un style politique « fondé sur le recours systématique à la rhétorique de l’appel au peuple et la mise en œuvre d’un mode de légitimation de type charismatique ». Doriot prétendait dépasser le clivage droite-gauche pour élaborer ce qu’il nommait un « populisme ». Plusieurs anciens responsables du PPF (dont Victor Barthélémy), anciens miliciens et anciens Waffen SS, se retrouvent en 1972 aux côtés de Jean-Marie Le Pen. « L’extrémisme de droite prend depuis la guerre le visage « grand public » d’un populisme largement élaboré dans la sphère idéologique doriotiste ».
Georges Albertini, fidèle à son passé collaborationniste fait carrière dans l’anticommunisme de guerre froide
Georges Albertini, le dauphin de Marcel Déat, est arrêté et incarcéré à Fresnes, puis traduit devant la Haute Cour de justice. Il est condamné à la peine bien légère de cinq ans de travaux forcés, interdiction de séjour, indignité nationale et confiscation de ses biens. Georges Albertini est libéré en mars 1948 à la suite d’une intervention d’Edouard Herriot. Il « connait beaucoup de monde, a su préserver des amitiés et des liens forgés avant la guerre avec des socialistes ou des radicaux, dont beaucoup sont francs-maçons » (ce qu’il n’est pas lui-même). Avec son ami Guy Lemonnier, ancien responsable du RNP, lui aussi condamné, libéré, amnistié, ils constituent dans la pénombre des réseaux anticommunistes.
Albertini s’emploie à « recoller les morceaux du collaborationnisme », se rapproche d’un ancien membre du cabinet de Goebbels, Werner Naumann, qui de son côté travaille à la fondation du néonazisme. Puis il s’éloigne de l’extrême droite européenne et se fait « entremetteur », gagnant sa vie comme conseiller à la banque Worms (Hippolyte Worms a été son codétenu à Fresnes). « Il s’inscrit dans une mouvance proaméricaine qui vise à lutter contre le communisme soviétique par l’unification européenne (…) Il se réinsère à grande vitesse dans le jeu politique sans jamais toutefois paraître au premier rang. » Il fréquente Guy Mollet, René Pleven, Henri Frenay, tous d’authentiques résistants qui n’ignorent pas qui il fut, et qui n’ignorent sans doute pas que son entourage proche est constitué d’anciens du RNP. Aux Etats-Unis, en 1951, il rencontre les dirigeants de la CIA et fonde un puissant think tank anticommuniste.
« Résumons-nous : autour de Georges Albertini gravitent des personnalités de toutes sortes : d’anciens communistes, d’anciens résistants, des socialistes, des radicaux, des libéraux, des gaullistes. Mais le noyau dur est constitué par les collaborationnistes. »
Recyclage des anciens cagoulards et autres collaborationnistes par l’atlantisme, l’anticommunisme et l’européisme
Beaucoup de miliciens furent victimes de l’épuration. Mais beaucoup aussi bénéficièrent des réseaux catholiques, Paul Touvier, qui figure sur la couverture du livre, en est l’exemple, et purent se réinsérer dans la société après avoir été amnistiés. D’autres furent accueillis dans l’armée et combattirent en Indochine puis en Afrique du Nord : « Pour nombre d’anciens nazis français, l’incorporation a permis au final de poursuivre, dans le cadre de la défense de la colonisation, un combat anticommuniste initié sur le front de l’Est. »
Nombre d’anciens cagoulards s’intéressent aux réseaux atlantistes et militent dans l’anticommunisme. Fidèles à leurs vieilles habitudes, ils s’essaient aussi à préparer un coup d’Etat anticommuniste en 1947, « le Plan bleu ». Parmi les conjurés, un cagoulard qui fut résistant, Loustaunau-Lacau, le créateur du réseau de résistance Alliance, déporté à Mauthausen. Dans le même esprit, toujours par anticommunisme, de nombreux collaborationnistes adhèrent au RPF fondé par De Gaulle. Même chose avec le Parti Républicain de la Liberté (PRL) qui rassemble nombrer d’anciens collaborationnistes autour de l’ancien résistant André Mutter, qui fait campagne pour l’amnistie des collaborateurs. Ou encore au Centre national des indépendants et paysans (CNIP) où se côtoient Antoine Pinay, André Bettencourt, Jacques Isorni et le jeune Jean-Marie Le Pen.
La solidarité des anciens cagoulards se retrouve avec une grande force autour de L’Oréal et d’Eugène Schueller. Celui-ci a financé la Cagoule, puis le MSR. L’Oréal, qu’il a fondé, a gagné beaucoup d’argent pendant la guerre. Son procès débute le 6 novembre 1946. Les témoins favorables se pressent à la barre, parmi eux le communiste Jacques Sadoul, le gaulliste Pierre Guillain de Bénouville, qui fréquenta la Cagoule avant guerre et fut pendant la guerre le responsable, au moins indirect, de l’arrestation e Jean Moulin alors qu’il était un responsable du mouvement Combat et un ami de son chef Henri Frenay. Il est désormais compagnon de la Libération et il vient affirmer à la barre que Schueller était en contact permanent avec les services gaullistes à Londres, où, rappelons-le se trouvaient d’anciens cagoulards. Schueller est relaxé le 27 juin 1947 !
Il utilise désormais L’Oréal pour « blanchir » les cagoulards en difficulté. Il embauche Jacques Corrèze, lui aussi réhabilité, qui développe la filiale ibérique de L’Oréal. Ce qui permet à cette société d’embaucher Jean Filliol, tueur de la Cagoule, tortionnaire milicien, compagnon de Darnand à Sigmaringen. Quand à Jean Azéma, ancien de Radio Paris et de la Waffen SS, il prend en charge la publicité du groupe L’Oréal. François Mitterrand, ami d’enfance de Bénouville, ami aussi de François Dalle et d’André Bettencourt, proches de Schueller, bénéficie lui aussi de la manne de l’industriel. Schueller lui confie la direction du magazine Votre beauté, qui n’a jamais cessé de paraître, et finance sa campagne électorale dans la Nièvre.
On trouve beaucoup d’anciens collaborationnistes, cagoulards mais pas seulement, dans le milieu des fédéralistes européens où ils font cause commune avec d’anciens résistants, Mitterrand, (puisqu’il en est aussi un), Henri Frenay, par exemple. « La Fédération », mouvement fondé en 1944 en faveur de l’intégration européenne, est animée par André Voisin, un proche d’Albertini. Le mouvement favorise hautement l’insertion des collaborationnistes dans les structures fédéralistes inspirées par Jean Monnet. « La Fédération s’impose rapidement comme l’épicentre français de l’européisme. » Pour ces anciens collaborationnistes, construire l’Europe continentale leur semble aller dans le sens de leur engagement politique des années 1940 à 1944.
L’auteur apporte cette réponse, sans doute un peu systématique, à sa problématique : « Pendant la guerre, ils poussent sans cesse au durcissement du régime et au renforcement des mesures antisémites. Ils s’arc-boutent sur un triple socle anti-communiste, européiste et national-socialiste. Au terme de leur défaite, alors que la France se reconstruit, ils demeurent fidèles à leur projet, en le faisant évoluer ; l’anticommunisme épouse désormais celui de la guerre froide ; l’européisme se fond dans celui de la construction européenne ; le nazisme à la française se transmue en populisme ».