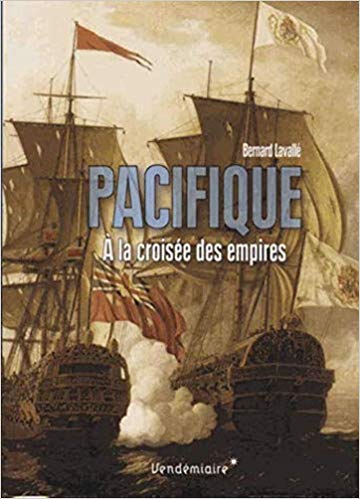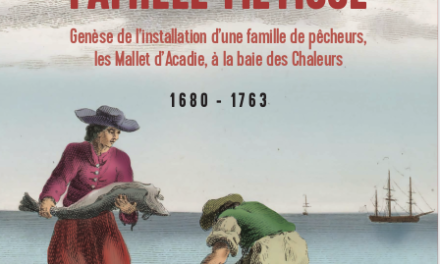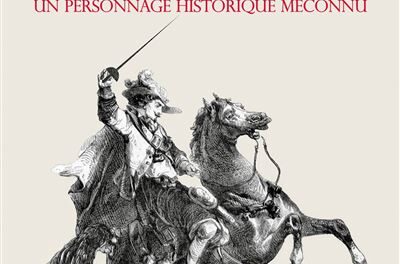Bernard Lavallé, professeur émérite de civilisation hispano-américaine et spécialiste de l’Amérique espagnole coloniale, publie assez régulièrement d’appréciables synthèses qui permettent de faire le point sur l’état de la recherche concernant un thème lié à l’Amérique hispanique des XVè-XIXè siècles. Le dernier ouvrage n’échappe pas à la règle.
C’est à une vaste fresque historique du Pacifique espagnol, du début du XVIè siècle à l’extrême fin du XIXe siècle, que nous convie l’auteur. Il ne peut être question dans le cadre de ce compte rendu de dévoiler toute la richesse des faits exposés dans les douze chapitres du livre. Les trois premiers vont de la « découverte » espagnole du Pacifique par le conquistador Vasco Nuñez de Balboa en 1513 jusqu’à la conquête du Nicaragua à partir de l’isthme de Panama, dans les années 1520, et à celle du Pérou, dans les années 1530, qui allait redynamiser les menées espagnoles dans le Pacifique, en passant par la fameuse circumnavigation entreprise par Magellan et achevée par Elcano. La recherche des épices des Moluques, raison essentielle de l’expédition, est alors au cœur de la rivalité hispano-portugaise.
Les expéditions de découverte et/ou d’appropriation de territoires du Pacifique du XVIe au XVIIIe siècle font l’objet de longs développements. Il est par exemple question des deux voyages mouvementés d’Alvaro de Mendaña vers les îles Salomon dans les années 1560 et 1570 mais aussi, bien plus tard, de celui d’Alessandro Malaspina, entre 1789 et 1794, équivalent des voyages contemporains de Lapérouse ou de Bougainville. Compte tenu du contexte international, les résultats de l’expédition, « malgré leur richesse et leur qualité, passèrent pour l’essentiel inaperçus » (p. 267).
L’histoire de ces expéditions s’entremêle inévitablement à celle des rivalités impériales, elles-mêmes liées aux intérêts économiques et commerciaux. L’aspect essentiellement scientifique des voyages cache mal en effet les visées expansionnistes des puissances européennes commanditaires. Ainsi, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, l’Espagne s’inquiète de voir les Anglais convoiter Tahiti. Les trois expéditions qui y sont envoyées ne parviennent toutefois pas à imposer la présence espagnole en Polynésie. Et quand le roi Charles III, à la même époque, fait mettre sur pied des dizaines de missions scientifiques à destination de presque toutes les régions de l’empire, il a bien en tête d’en tirer une meilleure connaissance « pour mieux défendre, mieux gouverner l’empire pour en tirer de nouveaux bénéfices » (p. 263).
Les rivalités impériales au cœur même de l’océan comme le long de ses contrées littorales d’Amérique mettent donc les intérêts espagnols aux prises avec de nombreux acteurs, les Portugais, bien entendu, mais aussi, aux diverses époques, les Hollandais, les Anglais, les Français, les Russes et les États-uniens. Aux XVIe et XVIIe siècles, il est beaucoup question de pirates et de corsaires : l’Anglais Francis Drake qui, après avoir franchi le détroit de Magellan, attaque Valparaiso et s’en prend, en 1579, à Callao, le port de Lima ; les actions de guerre contre des ports chiliens ou péruviens commis par des Hollandais soucieux d’ouvrir d’autres fronts contre l’Espagne en dehors des Flandres et d’ « établir les embryons d’un nouvel empire colonial » (p. 202). Bien plus tard, dans les années 1740 et 1750, on compte une vingtaine d’expéditions commerciales russes sur les côtes américaines. Les Espagnols établissent alors une base navale stratégique à San Blas, « presque en face de la pointe sud de la Basse-Californie » (p. 249), à partir de laquelle sont organisées des missions de reconnaissance et de colonisation de la Haute-Californie. San Blas voit bientôt sa population s’accroître notablement et devenir un centre économique non négligeable, autour du commerce des peaux de loutres, martres et hermines.
Malgré les menaces constantes que font peser sur les terres impériales les divers acteurs hostiles aux intérêts espagnols, Madrid ne se montre pas à la hauteur des exigences. Comme l’indique justement Bernard Lavallé : « L’Espagne payait bien mal en retour ses territoires américains dont le flux d’argent lui permettait de tenir tant bien que mal son rang en Europe où la défense de ses intérêts apparaissait comme une priorité supérieure à toute autre » (p. 206). Jamais, en effet, les Américains n’ont pu obtenir de la Couronne l’envoi d’une flotte permanente qui aurait sécurisé les routes et les ports du Pacifique sud notamment. Revient donc, de manière lancinante, la question de la défense problématique du dispositif impérial espagnol le long des côtes américaines et autour de l’archipel des Philippines, porte de l’Asie, relié au continent américain, jusqu’au port d’Acapulco, par le Galion de Manille, l’une des deux grandes routes commerciales au cœur de la mondialisation ibérique.
On assiste, à partir de la fin du XVIIIe siècle, au déclin inéluctable de cette ligne commerciale et à la perte par l’Espagne, à l’extrême fin du XIXe siècle, d’un archipel dont la conquête initiale au XVIe siècle avait été conçue comme un moyen pour les Espagnols de se lancer à l’assaut de la Chine. Si la route du Galion de Manille est longtemps essentielle, elle n’est bien entendu pas la seule. D’autres routes existent, d’importances plus régionales : entre le Pérou et le Chili pour le commerce du blé par exemple ; entre le Pérou et le Mexique, pour les produits issus du Galion de Manille alors que c’est officiellement interdit; entre le Pérou et le Mexique pour le mercure, indispensable à l’affinage de l’argent et inexistant au Mexique.
La lecture de ce très intéressant ouvrage nous convainc finalement que le Pacifique ne fut pas un « Spanish Lake », selon l’expression risquée en 1922 par l’historien nord-américain William Lytle Schurz, mais bien un espace « à la croisée des empires » comme l’indique le sous-titre, « un terrain de rivalités et luttes internationales sans merci dans les domaines commerciaux et souvent militaires » (p. 9).
L’excellente connaissance de la littérature, principalement anglo-saxonne et hispano-américaine, consacrée au sujet permet à Bernard Lavallé de nous présenter la plupart des enjeux historiographiques liés à la question. Sur le versant français de la connaissance historique de cet espace, on mesure grâce à Bernard Lavallé le chemin parcouru depuis les travaux de Pierre Chaunu, qui sont discutés ici pour être davantage nuancés que remis en cause. D’autres historiens, depuis, comme Clotilde Jacquelard sur les Espagnols à Manille ou Annie Baert sur les expéditions de Mendaña et Quiros au XVIe siècle, ont donné des travaux de grande qualité qu’il convient de lire.