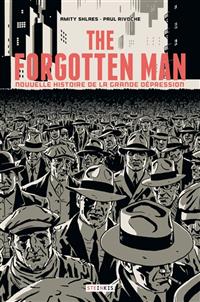Précisons tout de suite qu’Amity Shlaes a une formation d’économiste. Sa sensibilité la place du côté des libertariens, qui font de la liberté individuelle la valeur sur laquelle doit être fondée une société. En conséquence, l’État doit être réduit à sa plus simple expression. En résumant peut-être de façon excessive, on a là une forme de libéralisme exacerbée.
Amity Shlaes fait aussi partie de la Fondation présidentielle Calvin Coolidge (qui a précédé Franklin D. Roosevelt à la Maison blanche), ce qui est un autre élément important pour comprendre The Forgotten Man.
Il s’agit d’une adaptation graphique de l’ouvrage éponyme paru en juin 2007, traduit dans plusieurs langues. L’objectif est, comme le sous-titre le suggère fortement, de faire pièce à l’interprétation habituelle du New Deal. Faut-il le croire quand il prétend être une «nouvelle Histoire de la Grande Dépression» ? On sait que les avancées sociales et économiques obtenues à partir de 1933 ont été combattues dès cette époque, notamment par l’école de Chicago et Milton Friedman. Partisan de la politique de Roosevelt (et porte-parole du Trésor), il en est devenu l’un des contempteurs les plus virulents ; son ouvrage Capitalisme et liberté (paru en 1962) a fait date, et reste une référence essentielle. Ajoutons l’opposition de Friedrich Hayek au keynésianismeFr. Hayek, Droit, législation et liberté, PUF, coll. « Quadrige », 2007., qui a aspiré le New Deal. Bref, en matière de nouveauté, on ne voit pas bien ce qu’Amity Shlaes apporte. Cette impression est renforcée par le choix de l’illustrateur, Paul Rivoche. Ses dessins sont en noir, et le trait rappelle les comics des années quarante, notamment ceux qui traitaient des super-héros. Cela permet toutefois au lecteur d’être plongé dans un univers graphique qui ne lui est guère familier, un brin désuet.
L’histoire est menée par Wendell Willlkie, qui donne son interprétation des années trente à une éditrice qui est aussi une éditorialiste (au New York Times) en vue, Irita Bradford Van Doren, dont il est très proche. Démocrate, il soutient activement la candidature de Roosevelt. Devenu président d’une importante compagnie de production électrique en 1933, ses intérêts sont bousculés par la mise en œuvre de la Tennessee Valley Authority, société publique constituée par le gouvernement fédéral pour développer la production de la même énergie, mais à un prix de consommation moindre. Wendell Willkie devient alors opposant au New Deal, passe au parti républicain, à tel point qu’il est désigné pour le représenter lors des élections présidentielles de 1939.
Dès lors, on voit sur quels sentiments s’appuie son interprétation des faits. Il décrit la société américaine aux mains d’un État omniprésent, dont la puissance ne cesse de se renforcer. L’argument d’une soviétisation est évidemment amené, s’appuyant notamment sur le voyage en URSS de conseillers du nouveau président, en 1927 : Paul Douglas, Rexford Guy Tugwell, Start Chase. Willkie fait ainsi de la coopérative agricole Casa Grande (Arizona) le symbole de ce que les États-Unis sont en train de devenir, avec ses paysans dépossédés, sans ambition, travaillant à peine dans un cadre collectif inadapté. Cette dénonciation de l’omnipotence de l’État, insoucieux des conséquences de son administration calamiteuse, est à l’image de ce qu’on peut lire dans Atlas Shrugged Paru en 1957, l’ouvrage a été traduit en français sous le titre La Grève, 2011. L’auteur montre ce que devient un pays dominé par l’État, et ce qui se passerait si la meilleure partie de la société, à commencer par les patrons, en venait à quitter leurs fonctions., le roman d’une autre libertarienne, Ayn Rand.
Le récit est chronologique. Les auteurs ont pris soin de rappeler à chaque fois l’évolution du taux de chômage et de l’indice Dow Jones, pour bien marquer l’échec patent du New Deal. Ils font de cette politique une suite de mesures sans cohérence les unes par rapport, Roosevelt se laissant porter par ses conseillers et par ses lubies. Lui-même n’apparaît que comme une ombre, un fantôme malfaisant qui a fait main basse sur le pays. Au contraire, son prédécesseur républicain, Calvin Coolidge, est montré comme l’auteur des initiatives qui ont été ultérieurement couronnées de succès. En somme, la voie était déjà tracée par ce républicain qui n’a pas démérité, mais que l’électorat a délaissé au profit d’un démagogue qui a su trouver les mots pour l’emporter. Rien n’est dit, cependant, des réélections de Roosevelt jusqu’en 1944, alors que le titre du livre semble suggérer qu’il n’a rien fait pour ce Forgotten Man, expression vague désignant symbolisant les «obscurs et les sans-grade» chers à un populiste français, que les classes moyennes menacées de déclassement.
On voit clairement le parti pris idéologique de l’ouvrage. L’avant-propos indique qu’«il est enseigné dans les écoles et universités américaines» : on frémit à l’idée qu’il soit utilisé sans un solide appareil critique. Toutefois, si l’on doit accorder un mérite à ce livre, c’est effectivement d’apporter un contre-point à la version du New Deal. Il délaisse cependant des éléments importants de la politique de l’administration de Roosevelt, notamment le Social Security Act, l’extension des libertés syndicales, les initiatives visant à protéger les travailleurs et les agriculteurs, etc. Ces éléments doivent être réintroduits pour avoir une vision plus objectives des choses. On y ajoutera le travail de l’historien Howard Zinn pour faire bonne mesure.
Enfin, cette hésitation à en recommander la lecture à des élèves repose repose également sur le caractère très dense de l’histoire, qui requiert une bonne connaissance du contexte (ce qui permettra de conserver un indispensable recul critique). La multiplicité des personnages, que le dessin ne permet pas toujours de bien distinguer, vient renforcer ces préventions.