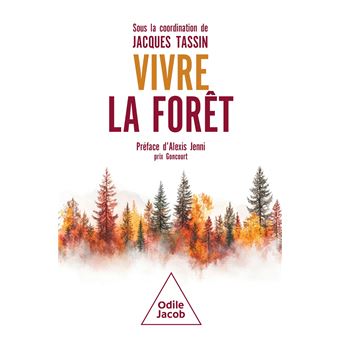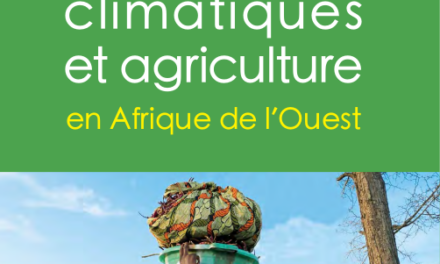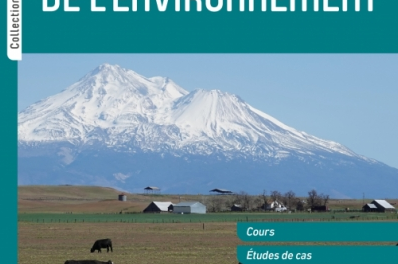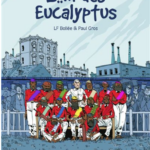Cet ouvrage est une approche de la complexité qui seule peut permettre d’appréhender les relations des hommes et des forêts. Jacques TassinChercheur en écologie végétale et ses co-auteurs, membres du CiradOrganisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. proposent une analyse réflexive et politique sur le rôle de la forêt à l’heure de l’urgence climatique.
Chaque forêt a une histoire, s’inscrit dans un environnement naturel mais aussi social. L’ouvrage est une invitation à réfléchir à la posture coloniale qui consiste à envisager la protection des forêts tropicales comme une solution, une réparation aux atteintes à l’environnement par les pays riches, sans prose en compte des populations qui y vivent.
Aux sources présumées incompatibilité entre l’humanité et la forêt
La lutte contre la déforestation : un combat légitime pour le Sud global
Malgré les C.O.P., la déforestation intertropicale s’accroît d’année en annéeMoins 4,7 millions d’hectares/an entre 2010 et 2020 avec un déplacement des espaces concernésPar rapport à la décennie précédente, de l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud vers l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.
La déforestation et la dégradation forestière sont liées au développement des espaces agricoles.
Depuis le Sommet de Rio, en 1992, la forêt est considérée comme pourvoyeuse des services environnementaux à l’échelle planétaire. La solution est-elle une « gestion durable » sans concertation avec les pays concernés qui sont favorables à une utilisation plus profitable des terres ? Deux visions opposent le capital naturel au capital humain.
Existe-t-il une déforestation utile que justifieraient les urgences économiques et sociales des pays du Sud ? La déforestation ne concourt pas obligatoirement à une économie d’exportation : En Asie du Sud-Est l’huile de palme est surtout vendue sur les marchés nationaux.
Distinguer déforestation et dégradation forestière
Les données statistiques masquent une diversité de situation. La définition elle-même de forêt n’est pas identique partoutDéfinition de la FAO : étendue d’au moins 0,5 hectare sont le couvert projeté au sol est au moins égal à 10 % de la surface et la hauteur minimum de 5 m..
La déforestation ; c’est-à-dire le passage à la non-forêt et la dégradation forestièreUn écart à une situation de référence sont difficiles à définir. L’approche qualitative est préférable à la seule quantification.
Les différentes causes sont présentées entre défrichement agricole et activités extractivistes. Dans les forêts tempérées, la sylviculture et les incendies de forêt sont dominants. Dans les régions intertropicales, la production agro-industrielle est majoritaire. La dégradation est un processus lent comme le montre l’exemple de Sumatra. Les causes sont multiples et souvent liées au commerce internationale.
Les temps de la terre, de l’arbre et de l’humain
Des temporalités différentes, à l’échelle du temps long les forêts évoluent alors que les hmmes les voient comme immuables.
Les forêt du monde couvrent 31 % des terres, 7 % sont des plantations. Si la déforestation est évaluée à 10 millions d’hectares par an, le reboisement et surtout l’expansion naturelle représentent 5 millions d’hectaresExtension des surfaces des forêts tempérées et boréales en lien avec le changement climatique.
La déforestation peut compromettre plus ou moins le reboisement, les méga-feux ont moins d’impact que le défrichement agricole.
La forêt a beaucoup évolué depuis l’apparition des végétaux sur terre. Les écosystèmes forestiers sont en constante évolution, quelle soit naturelle ou du fait des activités humaines. Les essences forestières ont été favorisées ou pas par les hommes.
La forêt primaire est un mythe, comme le montre les récentes découvertes archéologiquesGrâce à la télédétection, aux images Lidar comme le site de Barro Colorado au Panama.
Nous n’avons pas toujours regardé la forêt de la même manière en Occident
Les grands codes d’exploitation de l’époque moderneCode forestier Colbert 1669 ; code forestier de Pierre le Grand… montrent une forêt jardinée, durable alors même qu’ils ont été peu appliqués. Si la fonction nourricière de la forêt n’a pas totalement disparue de l’univers mental des Européens, elle reste très présente sous les tropiques. La perception de la forêt a été et est encore liée au mode de vie et à la démographie.L’urbanisation occidentale a fait de la forêt un espace fantasmé et la vision des forêts tropicales s’apparente encore souvent à un regard colonial.
Brève histoire de l’évolution de la foresterie
Après une rapide définition de la foresterie, le chapitre en retrace les grandes étapes depuis l’Antiquité.
La forêt apparaît d’abord en creux dans les textes et les représentations figuratives. L’archéologie permet de montrer un commerce du bois à longue distance, une sélection des espèces utiles, domestiquées sorties petit à petit des forêts.
Les grands défrichements européens commence à l’époque romaine, et sont poursuivis au Moyen Âge, notamment par les moines. La surexploitation à l’époque moderne (matière première et source d’énergie) amène les politiques à se mêler de la forêt.
Au XIXe siècle, des plantations monospécifiques répondent à la demande et aux services attendusPins dans les Landes, épicéas pour la restauration des terrains en montagne. Dans le monde tropical, une foresterie se développe durant la période coloniale avec la création d’arboretumMbalmayo au Cameroun, Butare au Rxanda… pour de futures plantations. Le commerce international de bois tropicaux se développe dans la seconde moitié du XXe siècle. À partir des années 1980, la volonté d’une gestion durable entraîne un développement de la recherche, en particulier sur la régénération naturelle.
Des forêt et des territoires
Cette seconde partie porte sur les dynamiques socio-politiques qui s’exercent sur la forêt.
Territoires forestiers : archipels de tourments
Aujourd’hui, les espaces forestiers sont des espaces de conflits d’usage et d’enjeux politiques.
L’Amazonie est l’emblème de ce phénomène. Il est intéressant d’analyser les champs sémantiques utilisés dans les débats. Les auteurs montrent que la vision qui fait des peuples autochtones des défenseurs de la forêt est trop réductrice comme le montrent deux exemples à Sumatra et au Pérou. Pour scolariser leurs enfants, certains autochtones de Sumatra acceptent des emplois dans les travaux de déboisement, le principe de réalité est plus fort que les valeurs traditionnelles.
La confiscation des terres, au Pérou, au profit de la protection de la forêt, dans le cadre des crédits REDD+, montre que la forêt est considérée comme un capital naturel à exploiter ou pour stocker le carbone, une politique qui s’apparente à un colonialisme vertLes auteurs citent l’ouvrage de Guillaume Blanc : L’invention du colonialisme vert – Pour en finir avec le mythe de l’éden africain, paru en 2020, chez Flammarion.
Réconcilier les communautés forestières et l’État
Ce chapitre propose une étude de cas sur la protection de la faune en Afrique centrale, une région où les écosystèmes forestiers sont en tension. L’étude montre que les droits coutumiers de chasse ne sont pas respectés par les États. Le modèle de conservation exclut le plus souvent les usages traditionnels de consommation des ressources forestières. Moins de 1 % des aires protégées sont entièrement gérées par les populations. Toutefois, on note une évolution des modes de conservation pour une meilleure efficacité, en associant les habitants, associés à des politiques de régulation des filières de commercialisation de la viande de brousse.
Communautés et communs – Une assimilation, souvent trompeuse
Le principe de cogestion des forêts tropicales permet la prise en compte de la notion de biens communs. Le droit coutumier n’est pas toujours égalitaire.
La reconnaissance des terres indigènes coutumières permet de réduire le rythme de déforestation, mais plutôt en zone faiblement peuplée. Un diagnostic dans chaque territoire s’impose.
La cartographie participative
Voilà un outil performant pour associer les populations à la gestion de leurs forêts. C ‘est un outil de partage d’informations entre les chercheurs, les aménageurs et une communauté. Ces cartes varient en fonction des objectifs visésPour quelques exemples : au Gabon, guide pratique, au Sénégal : Gestion durable des ressources forestières de Bignona et Diagnostic des filières forestières du département de Bignona.
Problèmes pernicieux et mise en jeu des territoires forestiers
Après une définition des « problèmes pernicieux »problème complexe + présence d’acteurs aux intérêts contradictoires, l’analyse porte sur la double problématique, dans les forêts tropicales : préserver la biodiversité et lutter contre la pauvreté des populations.
La démarche de résolution du conflit proposée repose sur le jeu. ? Le Cirad a élaboré en 2022 le jeu Climaterush à partir des rapports du GIEC. D’autres jeux existent comme AgriForEst qui visent à mieux appréhender les interactions entre les villageois et une forêt protégée. La présentation et l’analyse de ces jeux sérieux montrent leur intérêt.
Changements globaux – Regarder autrement les forêts
La troisième partie suppose de reconnaître l’asymétrie Nord/Sud et d’envisager des perspectives différentes face aux changements globaux.
D’une conservation prescriptive à une conservation valorisante
À côté des aires protégées, la préservation de la biodiversité peut s’intéresser à d’autres espaces. Après un rappel de la nature et de l’histoire des espaces protégés, il est question de formes plus communautaires de défense des espèces rares comme en Papouasie ou dans les forêts sacrées (Kenya, Éthiopie…).
Consentir à de nouveaux visages de la forêt
Les « forêts secondaires », majoritaires, sont intéressantes. Les services écosystémiques de la forêt primaire y sont en quelque sorte régénérés. Ce chapitre évoque les controverses à propos des plantations non monospécifiques. Ces plantations peuvent être des armes face au changement climatique.
Un exemple à Porto-Rico montre que ces néo-forêts avec des essences exotiques naturalisées présente un intérêt, notamment de stockage du carbone.
Composer avec les feux
Si les hommes ont depuis longtemps une connaissance et un usage raisonné du feu (écobuage, culture sur brûlis), d’autres usages existent. Le feu peut devenir un instrument d’accès au foncier par le défrichement. Aujourd’hui, des pratiques sont contrôlées, voire interdites.
Par contre, les mégafeux, incontrôlables, ne sont plus rares (Australie, Indonésie…) en lien avec la sécheresse. Les feux naturels, provoqués par la foudre sont l’exemption. Les activités humaines sont à la fois le déclencheur et ce qui favorise l’expansion des feux dans des espaces forestiers dégradés.
Autour des rapports entre science et forêt
Cette partie propose une réflexion sur les rapports entre la science et l’incertitude.
Gérer les forêts en considérant le connu et l’inconnu
Que peut dire la science face au changement climatique et aux enjeux sociaux de ce changement ?
Les auteurs partent des réflexions du philosophe Slavoj Žižek. Les pratiques forestières sont issues du « connu » de l’expérience et du savoir scientifique. Comment anticiper la réaction des forêts, la capacité d’adaptation devant des changements rapides ? La science a-t-elle des solutions à proposer pour une évolution des pratiques forestières ?
Les scientifiques doivent reconnaître l’« inconnu/connu », ce que l’on sait ne pas connaître et l’« inconnu/inconnu », d’autant plus insaisissable que les écosystèmes forestiers sont des univers complexes.
Les savoirs des peuples autochtones sont souvent empiriques, des « connus/inconnus » pour le savoir scientifique.
La forêt et l’étrangeté forestières au prisme des connaissances intimes
Ce chapitre aborde les perceptions de la forêt des peurs ancestrales occidentales à la nécessité d’apprivoiser l’étrangeté de la forêt et notamment les espèces mal connues ou inconnues de la forêt dense.
Les auteurs montrent, à partir de l’exemple du plateau de Somail, près de La Salvetat-sur-Agout, l’évolution d’une perception négative de la forêt synonyme d’exode rural à une perception positive quand les revenus des plantations raniment l’économie locale.
Envisager les non-humains comme des acteurs forestiers
Il s’agit de montrer les interdépendances dans tout écosystème et l’importance du complexe forêts/société, une continuité au fil des siècles. L’exemple développé est celui de l’arbre, des conséquences de son abatage.
La pensée moderne deviendrait-elle animiste ?
Face au dérèglement climatique, la tentation de la forêt exutoire
Ou le mirage de la forêt salvatrice. Dans ce chapitre, il est question d’adaptation, du pouvoir d’atténuation des forêts, moins efficaces dans le cas de forêts affaiblies.
Les auteurs dénoncent les plantations par les pays responsables des émissions de CO2, des programmes souvent contestables qui donnent bonne conscience malgré leur faible efficacité et leurs défauts.
Vers une science inclusive : la forêt au prisme de perspectives multiples
C’est un plaidoyer pour l’association des populations à la gestion forestière. Les scientifiques doivent accepter d’autres points de vue sur leur objet de recherche.
Conclusion
Un retour sur deux concepts fondamentaux : pluralité et complexité. Il est question de métissage entre les dynamiques forestières et les activités humaines.
Un ouvrage qui ouvre de véritables pistes de réflexion.