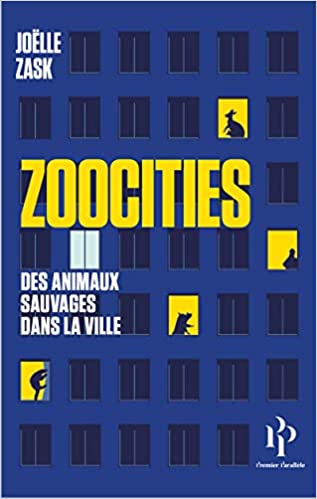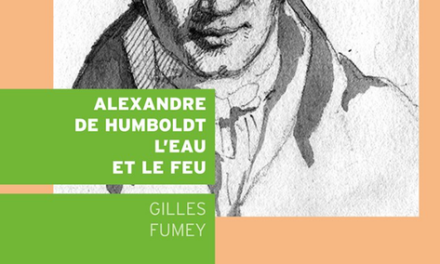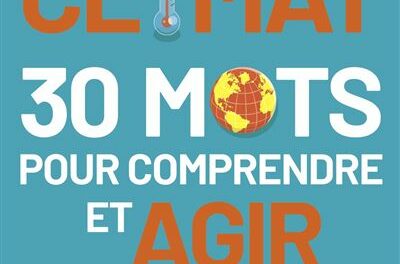« Et si les animaux sauvages s’installaient dans nos villes ? ». Inspirée par les images d’animaux ayant gagné nos espaces urbains lors du confinement du printemps 2020, la question est ici posée par Joëlle Zask, philosophe à l’université Aix-Marseille, dans cet essai riche de réflexions.
L’habitabilité des espaces constitue le point de départ de l’analyse. Le monde extérieur à la ville voit les espaces de vie des animaux sauvages se réduire (par la déforestation, les incendies…), leurs ressources en eau et en nourriture se raréfier, la pollution augmenter…alors que les espaces urbains offrent justement davantage de végétation (et d’ombre associée), des cours d’eaux dépollués, une réglementation sur certains produits (pesticides), une absence de chasse et de prédateurs, des abris chauds et moins d’obstacles à la circulation (clôtures, autoroutes…), autant d’aménités que certaines espèces ont bien saisi. Le problème, c’est qu’avec la tendance à l’étalement urbain, cette guerre des territoires n’ira pas en diminuant.
Notre relation à l’animalité est également questionnée dans l’ouvrage. Nous sommes dans une relation paradoxale entre émerveillement et crainte de la contamination, une tension entre l’animalité vue comme bestialité et l’humanité vue comme spiritualité…tension exacerbée en zone urbaine ou l’animal perd en symbolique, se dénature et devient un concurrent, un ennemi.
De là, surviennent bénéfices (pp 62-63 : cas des léopards d’Inde qui chassent les chiens enragés, tâche ne pouvant plus être dévolue aux vautours dont la population a été décimée) mais également gênes (pp 70-71 : cas des dromadaires australiens importés pour le transport et aujourd’hui coincés, à la recherche d’eau et pénétrant dans les villes avec brutalité pour en trouver ; pp 72 : cas des élans d’Alaska qui s’invitent dans les jardins pour déguster les citrouilles en période d’Halloween). Dans tous les cas, l’occasion de mesurer l’intelligence des espèces (cas des corbeaux du Japon qui laissent tomber leur butin de noix sur des ronds-points bondés afin que les voitures leur ôtent le travail de casse des coquilles ; cas des lions de mer de San Francisco qui pullulent et dont le requin, prédateur principal, est absent et qu’on a jugé bon de remplacer par un robot non seulement peu dissuasif et qui attirait des mâles tentant de s’accoupler avec lui !).
Un vide juridique et conceptuel enveloppe ces problématiques. Les « urban wildlife studies » n’ont qu’une dizaine d’années d’existence et ne traitent pour l’heure que de questions de gestion conflictuelle avec les hommes. Diverses sortes de « double discours » existent à l’image, p 82, de l’extermination possible et légale des ratons-laveurs par des sociétés spécialisées mais qui ne s’accompagne pas d’une obligation à retirer les croquettes du chat de la terrasse ou à ne sortir la poubelle qu’au dernier moment.
Le livre s’arrête efficacement sur l’idée de ne pas vouloir chercher à faire le bonheur de ces animaux malgré eux. C’est là négliger l’instinct de ces bêtes qui reviennent là où elles le veulent. Ainsi, il apparaît plus salutaire de penser en aval qu’en amont ; d’adapter, si possible, les zones où les animaux ont élu domicile…d’autant qu’il n’y a pas toujours nécessairement compétition avec l’homme pour les usages de l’espace (l’usage du sol peut être conservé normalement si des oiseaux empruntent des couloirs aériens aux mêmes endroits).
Diverses actions sont déjà envisageables : mettre des vitres opaques sur les immeubles aux façades de verre pour réduire les crashs d’oiseaux, trouver un certain équilibre entre niches et passages pour accompagner les déplacements (dont les migrations), ne pas nourrir les espèces sauvages pour ne pas leur générer des intolérances digestives mais surtout ne pas risquer de les voir revenir de manière plus rapide et plus insistante.
Là, il y a matière à réfléchir sur, non pas une « cohabitation » mais un « voisinage », ce concept qui permet la quête de la « bonne distance ».
Un ouvrage très intéressant, très bien écrit qui ouvre de nombreuses pistes pour l’étude de la nature en ville au programme de géographie du cycle 3 mais de manière plus générale, évidemment, pour poursuivre la réflexion sur l’avenir fortement bouleversé de nos sociétés. L’auteure rappelle que la diminution de la biodiversité augmente les risques de contamination du fait que l’agent pathogène n’est plus (suffisamment) dilué jusqu’à l’homme.