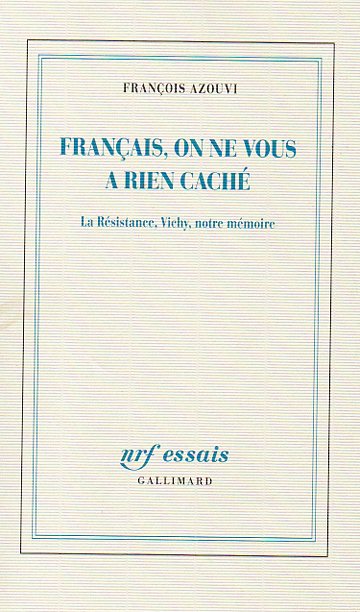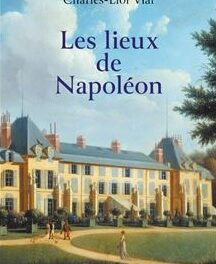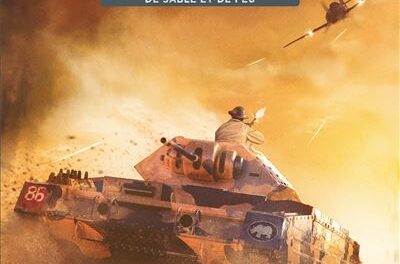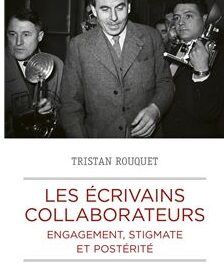Directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’EHESS, François Azouvi, est l’auteur d’un ouvrage sur Descartes et d’un autre sur Bergson. En 2012 il publie Le Mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire, un livre très dense, tout entier consacré à démontrer que l’oubli du génocide des Juifs au lendemain de la guerre est une « légende », un « mythe » ; que l’on n’a pas attendu 35 ans, pour en parler, en France ; que l’opinion publique en France a été très tôt instruite et sensibilisée au drame du génocide, par des études, des films, des récits, des témoignages. Cette thèse prenait le contre-pied de celle jusqu’alors admise et enseignée, fondée en grande partie sur les travaux d’Annette Wiewiorka, exposés dans son livre Déportation et génocide. Entre la mémoire et l’oubli (Plon, 1992), thèse qui affirmait que la spécificité du sort des Juifs n’avait pas été reconnue par la mémoire collective pendant plusieurs décennies.
Les Français n’ont jamais adhéré au résistancialisme
Le livre qu’il publie aujourd’hui est la continuation de cette démarche : il le présente comme « le second volet d’un travail sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale », un travail qui s’attache à démontrer que ce que l’historiographie des trente dernières années appelle le « mythe résistancialiste » est … une création des historiens, un mythe ! Rappelons que la notion de « résistancialisme » a été forgée par Henri Rousso dans un livre fondateur, Le syndrome de Vichy (Le Seuil, 1987, réédité en 1990). Sous ce terme, il désigne le « mythe » qui a effectué la « marginalisation de ce que fut le régime de Vichy », la construction de la « Résistance » comme objet de mémoire puis l’assimilation de cette Résistance à l’ensemble de la nation. Ce mythe aurait acquis son caractère dominant entre 1954 et 1971, date à laquelle il aurait volé en éclats pour diverses raisons, les plus connues étant la publication puis la traduction en 1973 de La France de Vichy par l’historien américain Robert Paxton et la sortie du film de Harris et Sédouy, Le Chagrin et la Pitié, en 1971. Cette notion « allait gagner une immense fortune », au point qu’elle d’intégrer les « Instructions officielles » à l’usage des professeurs d’histoire. Le « résistancialisme » y est présenté comme une notion qui permet de comprendre qu’une « mémoire collective » visant à présenter la France comme « une nation unanimement résistante » a été délibérément mise en place, que la collaboration et le pétainisme ont été minorés, voire effacés, que l’Etat a promu la mémoire de la Résistance et que l’opinion publique a adhéré massivement à cette vision positive. Les Français auraient donc cru à un mythe qui les rassurait, développé par les gaullistes et les communistes.
François Azouvi consacre 600 pages d’une étude approfondie à démontrer qu’il n’en fut absolument rien, que l’Etat en France n’a pas promu pendant 25 ans la mémoire de la Résistance, que le souvenir de Vichy et de ses réalités n’a jamais été effacé des mémoires et que l’opinion publique, beaucoup moins manipulable qu’on ne le dit, n’a pas adhéré massivement à l’idée d’une résistance généralisée. Tout le monde savait dès la Libération, affirme l’auteur, « ce que nos concitoyens ont cru découvrir dans la foulée du Chagrin et la Pitié ». « C’est seulement à partir des années 1970, sous le poids d’une culpabilité nouvellement apparue, que les Français se mettront à croire qu’ils avaient cru à toutes ces fables. » 460 pages de texte, un index de près de 1000 entrées, 65 pages de notes et 20 pages de bibliographie sont la manifestation d’une analyse quasi exhaustive du vaste domaine de la production culturelle française sur la Résistance, films, romans, articles de revues. La masse de la documentation analysée est tout à fait impressionnante. L’ouvrage est construit en trois parties d’inégale ampleur. La première partie (270 pages) comprend 7 chapitres, traite de la période 1944-1954 et a pour titre « Une mémoire sans tache ? Des mythes consolateurs ? » La seconde (deux chapitres et une centaine de pages), intitulée « Les deux mémoires de la Résistance », couvre les années 1954 à 1971. Les quatre chapitres de la troisième partie (80 pages) couvrent les années 1971 à 1995, avec pour titre « L’héroïsme suspect, le poids de la culpabilité ».
La double nature de l’expérience résistante : mystique et historique
Toute la démonstration suppose que soit connue et admise l’existence d’une double expérience résistante, qui se perpétue par une double mémoire : l’expérience et la mémoire mystique, l’expérience et la mémoire historique. L’auteur entend démonter dans son premier chapitre la dimension mystique de l’expérience résistante, « dans la mesure où il en allait pour eux d’une mort librement consentie au nom d’une valeur supérieure à leur existence ». Le renoncement au monde et à l’identité personnelle, l’affrontement consenti avec la mort, la fraternité relèvent de la mystique. Il entend démontrer qu’il y eut deux mémoires de la Résistance, que la mémoire historique est allée en s’amenuisant, mais que la mémoire qu’il qualifie de mystique ou « métahistorique », « peu sujette à l’usure du temps », a resurgi en fonction de l’évolution du contexte historique.
Mythologie gaulliste et mythologie communiste n’ont jamais régné seules
Dès la Libération sont apparus « une floraison de récits » qui n’ont absolument pas imposé une vision unique de la Résistance et de l’Occupation, y compris dans les récits destinés aux enfants, y compris dans les manuels scolaires : « Ni l’armistice, ni Vichy, ni la collaboration, ni Montoire, ne sont absents de ces manuels qui ne font pas non plus la part trop belle à la Résistance ». L’idée d’un récit « gaullo-communiste » est séduisante, mais c’est une « invention » (l’expression est de l’historien Jean-Marie Guillon). Le récit gaulliste est volontiers simplificateur, le récit communiste s’apparente à des « mensonges délibérés » et il est le seul à vouloir fabriquer une histoire officielle.
Aragon, Vercors, Mauriac, Eluard développent des visions plus mystiques, qui n’ont rien à voir avec le « résistancialisme ». Une analyse des thèmes montre que l’héroïsme n’est pas le seul associé à la Résistance, que Vichy et la collaboration (des individus mais aussi de l’Etat, de la police et de l’administration) sont souvent abordés, ni minorés, ni occultés, de même que le sort des Juifs : « Il est parfaitement inexact de prétendre que les Français de l’après-guerre ont pratiqué l’oubli délibéré de Vichy ; ou qu’ils ont méconnu le rôle actif joué par l’Etat français ». « Le récit résistancialiste n’occupe qu’une faible place dans la galaxie des récits des années noires. Loin d’être le tout, il ne constitue qu’une petite partie de ce qui s’est dit, montré, écrit dans les années qui ont suivi la fin du conflit. »
Les Français n’avaient pas besoin qu’on les rassure et les berce d’illusions
Les tenants du résitancialisme estiment que les Français avaient besoin de mythes consolateurs : humiliés par la défaite ils n’auraient pas pu supporter la cruelle vérité. F. Azouvi consacre un chapitre à identifier « les attentes des Français », en analysant les œuvres à succès de la période qui va de la Libération au milieu des années 1950. Il passe en revue films et romans et parvient à la conclusion que les Français « ont accueilli avec faveur des œuvres grinçantes, brossant de la France de l’Occupation un tableau qui n’a rien à envier à celui qu’on fera dans les années 1970 en ayant le sentiment d’innover (…) Les récits antirésistancialistes n’ont aucun mal à se frayer une place dans la production des années qui suivent immédiatement le conflit ».
Résistants désunis et anti-résistants offensifs
Le chapitre suivant veut montrer que la mémoire des résistants a été éclatée dès la Libération. Il existe un récit qu’on peut qualifier de résistancialiste, mais il en existe d’autres qui permettent de connaître ce que fut la réalité. « L’idée d’une chape de plomb et d’un mensonge généralisé, « organisé « , est une chimère ». Nombreux sont les récits « grinçants, ironiques, non conformistes », auxquels, de surcroît, le public fait bon accueil. De longs et minutieux développements sont consacrés à démontrer que « la mémoire résistante est éclatée, partagée entre d’irréconciliables options » ; démonstration qui passe par l’analyse des lois d’amnistie, les procès de René Hardy, la création du RPF, l’affaire Koestler, l’affaire Kravchenko, l’affaire Rousset.
Un autre chapitre, « Contre-récits et contre-mémoires » s’attache à montrer que les adversaires de la Résistance ont multiplié les publications, rendant de toute manière impossible l’édification et l’imposition d’un mythe résistancialiste : « Le « mensonge » résistancialiste n’avait pas besoin de ses dénonciateurs contemporains : tout était dit tout de suite par les adversaires de la Résistance ». L’auteur ne craint pas d’affirmer que ces récits « visent parfois juste » ; même si l’on peut ne pas être convaincu par les longs développements consacrés au débat sur la légalité et la légitimité du régime de Vichy. Des œuvres de fictions, films, et surtout romans, dont les auteurs sont idéologiquement proches des anciens vichystes et collaborationnistes, Marcel Aymé, Roger Nimier, Antoine Blondin, Paul Morand, André Cayatte, détruisent et ridiculisent les valeurs de la Résistance.
Une autre approche des années 1954-1971
Si l’on suit les analyses du Syndrome de Vichy, cette période est celle au cours de laquelle triomphent le refoulement de Vichy et le mythe résistancialiste. « Ma lecture de cette période est très différente » écrit F. Azouvi dans l’introduction de la seconde partie de son ouvrage. Il admet que De Gaulle, par une politique commémorative, et surtout après la fin de la guerre d’Algérie « tente d’imposer une doctrine officielle concernant la Résistance, les années de guerre et l’Occupation », mais il estime que là n’est pas l’essentiel. La tendance majeure est selon lui l’usure de l’esprit de la Résistance : « une irrépressible mélancolie affecte de plus en plus les résistants, bien incapable d’imposer aux Français une doctrine officielle concernant les années noires ». Affinant l’analyse, il montre que c’est la mémoire historique qui subit l’érosion du temps qui passe, alors que la mémoire mystique « resurgit intacte quand l’occasion l’appelle » ; et l’occasion c’est la guerre d’Algérie qui redonne toute sa vigueur à la Résistance, pas sous la forme du résistancialisme, « mais sous la forme d’une sorte de résurrection du passé ».
Les débats sur la Communauté européenne de défense (CED) réactivent la mémoire de la guerre et de la Résistance ; l’invocation de la Résistance est très forte chez les adversaires de la CED. Mais « ce n’est pourtant rien à côté de ce que va être l’utilisation de « l’esprit de la Résistance » dans le cadre de la guerre d’Algérie ». Ce n’est pas seulement la mémoire de la Résistance qui opère, « c’est d’une nouvelle résistance, en acte qu’il s’agit », de la part des partisans de l’Algérie française, de la part des partisans de l’indépendance, et de la part des Algériens : les mots parlent, ainsi le FLN rappelle le CFLN, le CNRA rappelle le CNR, le GPRA rappelle le GPRF, les mots « maquis », « terroristes », « résistance », « torture », « Gestapo », « clandestinité », « otages », « camps » refont surface dans l’actualité. Les souvenirs de la Résistance sont constamment mobilisés dans tous les camps, « la droite se souvient de Munich », « la gauche se souvient de la Gestapo ». La légitimité de la désobéissance est de nouveau source de débat et fonde des actions.
« Dans le même temps ou partisans et adversaires de l’Algérie française s’identifient aux combattants de 1940-1944, la mémoire de la Résistance s’étiole, se montre en proie à la mélancolie ou se réduit à un ritualisme commémoratif d’anciens combattants. » Un chapitre est consacré à démontrer ce fait, et à l’expliquer par la double nature de la Résistance. Comme événement « mystique » elle suscite une mémoire « sacrée », « étrangère au temps ». Comme événement historique, elle suscite une mémoire qui s’use au fil du temps, entrainant l’amertume des anciens résistants et la production de récits désenchantés. Parallèlement la mémoire du génocide monte en puissance ; le croisement des deux mémoires, l’une déclinante, l’autre ascendante, étant situé en Mai 1968.
Le modèle héroïque supplanté par le modèle victimaire (1971-1995)
C’est la démonstration de la troisième partie. « Cette mutation anthropologique capitale concerne doublement la mémoire de la Seconde Guerre mondiale : parce qu’elle destitue le héros résistant de sa place éminente et parce qu’elle institue la victime juive, devenue paradigmatique, à la place qu’occupait le héros. » On admire un héros, on a de la compassion et/ou on se sent coupable à l’égard d’une victime : « Appliqué à la mémoire française de la Seconde Guerre, cela donne le « syndrome de Vichy » naguère diagnostiqué par Henri Rousso ». Le tournant de 1971 subsiste dans la thèse de François Azouvi, mais sa signification change : ce n’est plus le moment où les Français découvrent qu’on les a bernés avec un mythe résistancialiste et où ils apprennent une réalité qu’ils connaissaient déjà, mais c’est le moment « où ils se mettent à croire qu’ils avaient cru » à ce mythe. Ils commencent de même à croire qu’ils avaient oublié le génocide des Juifs. Mais ce ne sont pas les mêmes Français : les seconds sont les enfants des premiers. Les baby-boomers prennent le pouvoir intellectuel et moral.
On assiste donc à la mise en place d’une nouvelle mythologie. La réception du film d’Ophuls est fondamentale. « Les Français sont emportés par la grande vague accusatrice ; le syndrome de Vichy les frappe soudain de plein fouet. » Le film reçoit de nombreuses critiques négatives, mais elles sont submergées par les thuriféraires du film. De nombreux films, articles, livres vont prétendre révéler ce qui aurait été caché ; c’est une déferlante que rien ne peut arrêter, quand bien même l’analyse de débats des Dossiers de l’écran montrerait que des témoins fiables affirment que l’Occupation n’était pas telle que le dépeint Le Chagrin et la Pitié. « La Résistance est la grande perdante de cette entreprise de démystification » ; son image se dégrade de film en film.
Avec la recherche, l’arrestation et le procès de criminels nazis et de leurs supplétifs vichystes et collaborationnistes (Touvier Barbie, Leguay, Papon) « les victimes remplacent les héros » (c’est le titre du chapitre XI du livre). C’est en effet la mémoire juive qui est motrice dans ces affaires et non la mémoire résistante. Parallèlement la mémoire résistante est « malmenée dans ces mêmes années 1990, au cours de quelques épisodes calamiteux pour elle ». Un chapitre montre que les résistants « et leurs historiens » sont « pris à contre-pied » au cours du procès Papon et des affaires Jean Moulin et Aubrac. Plusieurs grands résistants et Français libres prennent la défense de Maurice Papon pour ne pas désavouer De Gaulle qui en fit son ministre. La mémoire de Jean Moulin est prise à partie par les accusations d’Henri Frenay, fondateur de Combat, puis d’autres historiens ( ?) s’engouffrent dans la brèche ; or attaquer la mémoire de Jean Moulin, c’est attaquer la Résistance comme mythe. Voulant faire le point sur les actes et les déclarations des époux Aubrac, véritable incarnation vivante de la Résistance, des historiens semblent se transformer en tribunal. C’est désormais la dimension mystique de la Résistance qui est amoindrie.
Le dernier chapitre annonce « les signes d’un apaisement »., s’ouvrant sur cette affirmation : « Vichy ne nous hante plus au même degré qu’il y a vingt, trente ou quarante ans ». Productions cinématographiques et télévisuelles, bandes dessinées (leur part est croissante) racontent cette page de notre histoire de manière plus apaisée. Beaucoup donnent une large place à « l’ambiguïté des choix et à l’incertitude des destins » ; néanmoins « la dimension mystique de la mémoire de la Résistance, si elle a disparu de l’historiographie de la Résistance, continue de constituer un réservoir de grandeur dans lequel les auteurs de fictions peuvent puiser à leur gré ». On peu regretter à ce propos que la série Un village français, 72 épisodes de 52 minutes, ait été aussi peu prise en considération et aussi maltraitée : trois lignes pour ne presque rien dire des six premières saisons et une demi-page pour dire le plus grand mal de la septième saison ! Quand on voit l’importance accordée à certains films secondaires des années 1950 ou 1960, on ne semble pas loin du parti-pris.
Une thèse qui suscitera des discussions et ne peut laisser indifférents les professeurs d’histoire
D’où vient le fait que François Azouvi n’emporte cependant pas la conviction absolue ? Peut-être du fait que l’auteur parle d’autorité, que la thèse soutenue est réaffirmée des dizaines de fois au long de l’ouvrage et que la nuance n’y trouve que peu de place ? Peut-être aussi parce que la production culturelle prise en compte, n’est sans doute pas l’exact reflet de l’opinion publique et de la mémoire collective ? N’aurait-il pas fallu accorder une réelle place à l’analyse de la presse, nationale et locale, aux discours commémoratifs, à l’échelle nationale et locale ? Pourquoi avoir accordé tant de place aux réflexions de Sartre, de Camus, de Mauriac, et de quelques autres grands intellectuels, et ne pas avoir pris en compte toute la production historienne (l’Histoire de Vichy de Robert Aron, Fayard, 1954, n’apparait pas une seule fois dans l’ouvrage) ? On se prend aussi à penser qu’une démonstration plus concise aurait peut-être été plus convaincante. François Azouvi est sans doute conscient du fait que de telles questions se posent puisqu’il publie son ouvrage dans la collection « NRF essais », et que le directeur de la collection nous rappelle que « l’essai est une interrogation au sein de laquelle la question, par les déplacements qu’elle opère, importe plus que la réponse ». Dans la brève critique qu’il consacre à cet ouvrage dans Le Monde, André Loez écrit : « Malgré le ton définitif adopté par l’ouvrage, la lecture à la fois très fine et très personnelle des sources qu’il opère suscitera des discussions ». Elles ont sans doute commencé, car Henri Rousso, « principal interlocuteur de ce livre », est remercié par l’auteur pour avoir lu le livre « avec le souci (…) d’avancer dans la compréhension du passé sans se préoccuper prioritairement de savoir si cela conforte ou non sa propre interprétation. »
Une telle démonstration nécessite d’être portée à la connaissance des professeurs d’histoire et implique que soit posée la question du bien fondé de l’enseignement de la notion de « résistancialisme » comme d’une réalité historique incontestable. Pierre Laborie l’avait d’ailleurs déjà fortement égratignée dans Le Chagrin et le Venin, Occupation, Résistance, Idées reçues, publié en 2011.