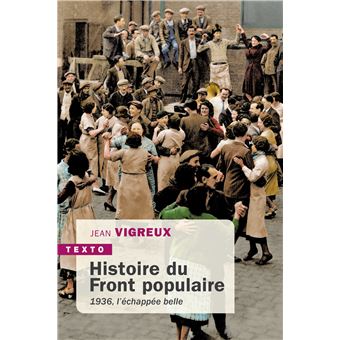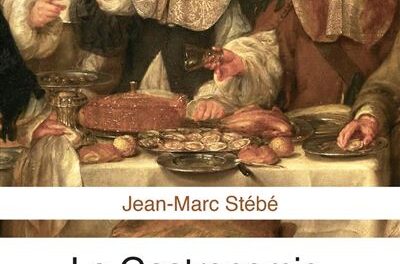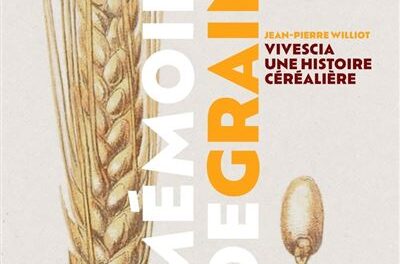Cet ouvrage est paru aux Editions Tallandier en 2016 et en voici une version actualisée dans la collection Texto. L’auteur, Jean Vigreux, est historien, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Bourgogne. Il s’intéresse notamment à l’histoire des gauches et il est l’auteur de Waldeck Rochet, une biographie politique (2000), Le Front populaire (Que sais-je, 2011), La faucille après le marteau, le communisme aux champs dans l’entre-deux-guerres (2012), Le Congrès de Tours (2020) ou Le Parti rouge. Une histoire du PCF (2020).
Avec ce livre, Jean Vigreux nous offre une vraie et belle synthèse du Front populaire, cette période devenue mythique inscrite aujourd’hui au « panthéon des gauches ». L’auteur livre une vision élargie de cette alliance des trois partis de gauche en soulignant avec beaucoup de justesse la diversité des enjeux, des territoires et des acteurs à prendre en compte afin de saisir pleinement le Front populaire et de « dépasser les images collectives » (p.10) qui y restent encore attachées.
Chapitre 1 –
Jean Vigreux revient, tout d’abord, sur les crises qui touchent la France en ce début des années 1930. Il souligne la singularité de la crise économique et sociale qui arrive tardivement en France, faisant ainsi naître des illusions chez certains, mais qui va durer : c’est « l’exception française » selon Jacques Marseille. L’auteur illustre cet optimisme de départ avec le centenaire de l’Algérie française et l’Exposition coloniale de 1831 dont l’imaginaire colonial doit rassurer la société et les politiques sur cette « Grande France » tenant bon face au marasme mondial. L’impuissance des politiques économiques traditionnelles (réflexe protectionniste, conservatisme des structures de production …), les scandales (Stavisky bien sûr) ou l’instabilité gouvernementale font naître des peurs ou des rancœurs et conduisent à un certain repli identitaire ainsi qu’à une véritable remise en cause du régime républicain par des tendances et mouvements nationalistes et fascistes.
Jean Vigreux insiste ensuite sur les premières mobilisations au travers des rassemblements Amsterdam-Pleyel (1932-1933) sous l’impulsion d’Henri Barbusse et des marches (Tremblay – 1932). Face à cela, un courant agrarien comme les Chemises vertes de Dorgères (dans le milieu rural) et les ligues au discours antisémite, xénophobe et antiparlementaire (dans les villes) se font entendre. La journée du 6 février 1934 faisant directement suite aux conséquences de l’affaire Stavisky, souligne cette bipolarisation du paysage politique : pour la droite et l’extrême droite il s’agit d’une manifestation légitime alors que pour la gauche c’est un coup de force fasciste digne de la marche sur Rome ou des violences nazies. Pour l’historien, il n’y a pas de véritable tentative de coup d’état ce jour là, mais plutôt une volonté de créer le désordre voire le chaos. Si cet évènement souligne l’atmosphère de guerre civile qui règne en France, il va être aussi « le catalyseur du rapprochement des forces de la gauche française » (p.40).
Chapitre 2-
Jean Vigreux s’intéresse ensuite aux années 1934-1935 et à la riposte qui s’organise au lendemain de la journée du 6 février. Dès le 9 février, le PCF et la CGTU lancent une manifestation qui sera durement réprimée. Cette « journée rouge » peut être qualifiée de « journée sans lendemain » qui clôt un cycle, celui de l’isolement du PCF. Le 12 février, c’est au tour de la SFIO et de la CGT de manifester. Lors de ces cortèges parisiens puis provinciaux, on assiste aux prémices de l’unité à venir avec des militants de deux bords qui se rejoignent aux cris de « Unité ! Unité ! ». Les intellectuels n’hésitent pas non plus à s’engager, c’est ce que souligne la création du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes autour du philosophe Alain, de Paul Rivet et de Paul Langevin. Les adhésions au CVIA se multiplient rapidement (6000 en 1934) et de nombreux comités locaux voient le jour. Une dynamique Paris-province voit alors le jour. C’est cette base qui impulse une dynamique de rapprochement et une « culture unitaire de l’antifascisme » autour de la dénonciation de la violence des ligues et de leur antiparlementarisme (p.45). C’est le 9 octobre que le PCF, à travers Marcel Cachin et Maurice Thorez, lance le mot d’ordre que la base attend : « Front populaire, pour le pain, la paix et la liberté ». C’est une invitation à l’unité pour tous les partis de gauche.
Pour l’auteur, le 14 juillet 1935 à Paris, en province et dans les colonies marque le « baptême » de ce Rassemblement populaire. A Paris, l’unité autour de la défense de la République est affichée (présence du CVIA, de la CGT, de la LDH, …) et proclamée par de grands orateurs : Henri Barbusse, Léon Jouhaux, Paul Rivet, … A la fin du parcours, on prête serment « à l’image des révolutionnaires de 1789 » (p.73). Il ne faut pas croire que la droite et les ligues n’agissent pas ce 14 juillet. L’auteur note la présence des Croix de Feu aux Champs-Elysées : « le Front national s’organise face au Front populaire » (p.74). A gauche, l’élan unitaire est transporté à Moscou lors du VIIe congrès de l’Internationale Communiste (juillet-août 1935) où Georges Dimitrov, M.Thorez, M.Cachin ou Waldeck-Rochet insistent sur les réussites de la nouvelle ligne. Ce « visage rassurant » du PCF pousse la parti radical a accepter définitivement le rassemblement en octobre. Cet élan pousse aussi à la réunification de la CGT et de la CGTU (définitive en mars 1936). A l’international, les évènements d’Ethiopie renforcent encore le clivage politique français. Aux intellectuels qui défendent l’Occident et l’intervention italienne (Bonnard, Gaxotte, Daudet, Gaxotte, Maurras, Drieu, …) répondent ceux qui luttent contre « l’affirmation de l’inégalité en droit des races humaines ».
Chapitre 3 –
Si en décembre 1935, une plate-forme programmatique commune SFIO-PCF est signée, il faut attendre le 11 janvier 1936 pour que le parti radical, désormais avec Edouard Daladier à sa tête, adopte un programme commun. Le programme est axé autour de ces trois mots d’ordre « Pour le Pain, la Paix et la Liberté ». La campagne est violente, verbalement et physiquement, comme le souligne l’agression de Léon Blum par un groupe de Camelots de roi le 13 février 1936. Bien sûr, les évènements internationaux s’invitent dans cette campagne : l’Espagne et son gouvernement de Front populaire, l’Abyssinie, la remilitarisation de la Rhénanie, … Le chômage, la pauvreté et la peur du déclassement social en lien avec les crises profondes qui traversent la France, guident aussi le choix de l’électorat.
La campagne électorale débute le 7 avril et, pour la première fois, elle utilisera les ondes radiophoniques ! Du côté du Front populaire, on y proclame la cohésion et on insiste sur la volonté de changer les choses. Dans son discours du 17 avril 1936 sur les ondes de Radio-Paris, Maurice Thorez propose la réconciliation et tend la main à ceux qui pourraient paraitre éloignés de la gauche (catholiques, Croix-de-Feu, paysans, …). Dans les différents discours du PCF comme celui de Renaud Jean qui s’adresse aux paysans, l’horizon révolutionnaire s’efface au profit de l’encage républicain. Pour les adversaires, comme Xavier Vallat, alors député de l’Ardèche, « la peur des rouges et le complot maçonnique teinté d’antisémitisme constituent la matrice d’un discours particulier au sein de la campagne » (p.90). Jean Vigreux revient aussi sur l’utilisation du cinéma et notamment le célèbre La vie est à nous de Jean Renoir, leçon très pédagogique qui propose les solutions (communistes) à la crise. Mais le premier média utilisé reste bien sûr la presse. On peut citer à droite L’Echo de Paris, à l’extrême droite Gringoire, Je suis partout ou Candide et à gauche L’Humanité (PCF), L’Œuvre (proche des radicaux) et Le Populaire (SFIO). Comme à la radio, la droite annonce le chaos si les « partageux » arrivaient au pouvoir en lien avec les évènements espagnols. Le Centre de propagande des républicains nationaux (CPRN) publie une brochure de propagande dont le titre veut tout dire Pour lutter contre le Front populaire. On y retrouve un argumentaire classique basé sur l’opposition ordre/anarchie et République/dictature du prolétariat. C’est pour cela que « tous les Français qui veulent sauver leurs libertés et la paix ont le devoir de s’unir pour barrer le chemin du pouvoir au Front populaire ».
Lors du 1er tour, conformément aux accords entre partis, chaque organisation présente ses candidats. Jean Vigreux souligne la bipolarisation de la vie politique mais réfute l’idée dune « vague de fond » à gauche, la droite réussissant à globalement se maintenir. Par contre, à gauche, le centre de gravité se déplace : pour la première fois les socialistes devancent les radicaux. Le PCF, en gagnant 700 000 voix, intègre le régime républicain. Pour le second tour, « la discipline républicaine joue très largement » (p.106) à gauche comme à droite. Le candidat arrivé en tête au premier tour se maintient et il est soutenu par ses alliés qui eux se désistent. Quelques « indisciplines » donnent lieu à des triangulaires dans certaines circonscriptions. Ici, l’historien détaille les résultats du scrutin qui globalement ne modifie pas la géographie électorale mais relève quelques particularités comme ces députés de droite élus dans des régions pourtant ouvrières : François Peugeot dans le Doubs et Antoine Pinay à Saint-Chamond. Certains territoires restent encrés à droite comme en Moselle ou sur 6 députés, 5 sont de droite (dont Robert Schuman). Au niveau national, la SFIO revendique la direction du gouvernement dès le lendemain des résultats du second tour mais attend la fin de la législature précédente.
Le 4 juin, Léon Blum constitue son gouvernement. Il n’y a pas de communistes, l’Internationale communiste ayant mis son veto, mais on y retrouve trois femmes dont Irène Joliot-Curie à la Recherche scientifique. Léon Blum compose avec un subtil dosage entre les familles politiques (SFIO, parti radical, USR), les courants internes et les régions. Le gouvernement est présenté le 6 juin 1936. Dans l’hémicycle, la journée est marquée par l’intervention de Xavier Vallat soulignant les tensions et l’aversion d’une certaine droite vis-à-vis du Front populaire. Face aux attaques antisémites, Blum inscrit son action dans la légalité républicaine. Il ne s’agit pas d’instaurer le socialisme mais « de respecter l’unité des forces progressistes et démocratiques dans le cadre du Front populaire ».
Chapitre 4 –
Dans ce chapitre, Jean Vigreux détaille les différentes phases du mouvement social qui suit l’élection du Front populaire. Des grèves isolées éclatent au Havre et à Toulouse suite aux licenciements des ouvriers qui s’étaient mis en grève le 1er mai. Entre le 25 mai et le 1er juin, une première vague de grèves éclate dans le secteur aéronautique mais aussi dans les usines automobiles de la région parisienne. Ce mouvement, relayé par la presse, se propage à la province et touche le commerce, les banques ou l’artisanat. A Billancourt, les ouvriers de Renault occupent leur usine à partir du 28 mai.
Léon Blum, une fois en place, propose à la CGT et à la CGPF (Confédération générale de la production française) de se rencontrer et de négocier. La rencontre a lieu le 7 juin, Léon Blum la préside en présence notamment de Roger Salengro (Intérieur) et de Jean-Baptiste Lebas (Travail). Dans la nuit, la rencontre débouche sur la signature des accords Matignon qui prévoient les congés payés, la semaine de 40h, les contrats collectifs et l’élection des délégués du personnel. Cet accord doit à la fois apaiser les esprits, trouver des solutions face à un mouvement de grève sans précédent et déboucher sur des avancées sociales importantes. Pour Jean Vigreux, avec cet accord, « le gouvernement et l’Etat ont un rôle régulateur lors d’un conflit social et non plus seulement celui du maintien de l’ordre : c’est un acte fondateur d’une culture de la négociation sociale » (p.123). En province, l’accord est un levier pour les grévistes afin d’obtenir auprès du patronat local les mêmes droits.
Malgré tout, le mouvement ne faiblit pas et atteint même son paroxysme dans la semaine du 8 au 12 juin ! Enfin, une dernière vague de grève commence à la mi-juin dans un contexte ou le patronat n’accepte pas forcément les décisions prises par la CGPF. Jean Vigreux n’hésite pas à illustrer ce mouvement social avec des exemples précis comme avec les houillères du Nord. Les grèves gagnent les colonies françaises comme l’Algérie, le Maroc l’Indochine ou la Réunion. On y retrouve les ouvriers indigènes aux côtés des ouvriers européens. Les déceptions liées à ce mouvement social vont nourrir le nationalisme et les mouvements indépendantistes. L’auteur n’oublie pas les campagnes. Au cours de l’été 1936 puis 1937, les ouvriers du monde rural se mettent aussi en grève. Ils demandent les mêmes droits que les ouvriers des villes. Ces grèves rencontrent l’hostilité des Chemises vertes de Dorgères qui mènent des actions afin de les faire cesser.
A propos du quotidien des grèves, si « la mémoire collective a retenu un moment d’euphorie et de dignité retrouvée » (p.140), l’historien retient aussi :
- la responsabilité ouvrière qui refuse les sabotages en protégeant l’outil de production et en évitant les affrontements avec les militants d’extrême droite.
- la violence partagée avec des violences symboliques (mannequins pendus) et des violences plus marquées comme la séquestration de patrons. La réaction des opposants ne se fait pas attendre : de Wendel qui fait couper le gaz à la population messine et la presse dénonce la violation de la propriété privée par les « salopards en casquette ».
Enfin, pour Jean Vigreux, si ce mouvement social n’est pas une révolution en marche, il « doit être lu comme une insubordination ouvrière liée aux violences de la société française » (p.157). Cette insubordination se caractérise par un mimétisme : on reproduit à l’échelle locale les évènements nationaux ou régionaux. La presse joue un rôle immense dans cette diffusion d’un idéal démocratique fort.
Chapitre 5 –
Dès juin 1936, il faut bien noter la volonté de Léon Blum « d’exercer le pouvoir ». Sa politique volontariste débouche sur le vote de trois réformes qui constituent une avancée sociale essentielle : les conventions collectives, les congés payés et la semaine de 40h. L’opposition patronale et des droites est farouche. L’Action française dénonce le « ministère de la Paresse » qui précipite le déclin français. Jean Vigreux n’oublie pas les autres droits en lien avec la popularisation de la culture, du sport et de l’éducation : les billets de congés payés (à 40% de réduction), les auberges de jeunesse, les tarifs réduits dans les musées, la construction de stades, le développement de l’éducation populaire, … L’élan éducatif doit aussi à Jean Zay et à Cécile Brunschvicg avec la scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans, l’enseignement de l’histoire dans une dimension sociale (et non plus seulement nationale), le développement de l’enseignement technique, l’ouverture de cantines scolaires, …
Brièvement, l’auteur revient sur les réformes économiques majeures :
- dans le domaine agricole, la création de l’Office National Interprofessionnel du Blé et la poursuite de la politique des appellations d’origine contrôlée
- dans le domaine industriel, la nationalisation des industries de guerre et d’armement
- les grands travaux pour 20 milliards de francs sur 4 ans
- la relance par la consommation
Mais les résultats ne semblent pas à la hauteur des attentes et doivent essuyer les critiques de l’opposition (Joseph Caillaux parle de « rooseveltisme lilliputien » à propos de l’interventionnisme de l’Etat). Jean Vigreux souligne justement les différentes limites de la politique du Front populaire :
- la fuite des capitaux vers des pays comme la Suisse à mettre en lien avec la politique parfois agressive visant à « faire payer les riches » et la dénonciation des « 200 familles » renforçant la peur des « rouges »
- le gouvernement, malgré ses engagements, recourt à la dévaluation en septembre 1936
- en termes de chômage, le cercle vertueux imaginé par le gouvernement à partir de la réduction du temps de travail, n’est pas au rendez-vous
- dans les colonies, on en reste au stade des « velléités réformatrices » (projet Blum-Viollette en Algérie), l’espoir fait place à la déception
A cela s’ajoute les évènements espagnols : le coup de force de l’armée dirigée par Franco (18 juillet 1936) et le début de la guerre civile. La France est « électrisée par l’évènement » (p.185) et le pouvoir en place est mis à l’épreuve. Si les radicaux continuent d’afficher leur pacifisme, le PCF souhaite une intervention. Blum est « tiraillé entre la neutralité et l’interventionnisme » (p.186). Si finalement, il ne souhaite pas prendre le risque d’une nouvelle guerre en Europe, il met en place une « non-intervention relâchée » aux frontières ce qui permet l’aide et le soutien aux républicains espagnols.
Le gouvernement de Blum, déjà fragilisé, doit aussi essuyer les attaques, les insultes et les calomnies de la presse d’opposition. Les journaux et les intellectuels d’extrême droite dénoncent un gouvernement judéo-bolchevique et propagent la haine, le racisme et l’antisémitisme. Les propos de Céline dans Bagatelles pour un massacre (1937) reflètent bien ce climat : « Je préférerais douze Hitler plutôt qu’un Blum omnipotent. (…) Les Boches au moins, c’est des blancs ». Les accusations mensongères initiée par l’Action française à l’encontre de Roger Salengro (désertion durant la Première Guerre) poussent ce dernier à se donner la mort. Le lendemain, l’Action française poursuit en écrivant que l’ancien ministre vient de « déserter une seconde fois ». Les partis d’extrême ne sont pas en reste avec le PSF du colonel de La Rocque (suite à la dissolution des Croix-de-Feu) et le PPF de Doriot.
Malgré les difficultés, ce gouvernement de Front populaire peut être vu comme un « nouveau régime politique qui modifie les usages du modèle parlementaire de la IIIe République » (p.193) :
- Blum ne prend aucun autre portefeuille ministériel
- il met en place une « équipe de choc » (ex : Jules Moch) afin de mieux coordonner l’exercice du pouvoir
- par respect pour la Parlement, il se refuse à recourir au décret-loi
- le chef du gouvernement devient un chef d’orchestre qui donne le tempo des réformes et les assume (ce qui accélère le rythme de travail des parlementaires). Face aux mécontentements, une pause est décidée en février 1937.
Afin de mener une politique de relance économique plus ambitieuse, Léon Blum demande les pleins pouvoirs en matière financière. Si les députés lui accordent, les sénateurs refusent à cause de la défection des radicaux. Le 21 juin 1937, le président du Conseil démissionne. Le président Lebrun demande au radical Camille Chautemps de former un nouveau gouvernement.
Chapitre 6 –
Dès le 22 juin 1937, Chautemps déclare constituer un « gouvernement de rassemblement républicain ». Pour Jean Vigreux, ce « glissement sémantique, éclipsant de fait le Rassemblement populaire, ne doit pas occulter que la coalition parlementaire est toujours réelle » (p.201). Chautemps va en fait s’employer à gérer puis à accentuer la pause entreprise dès février 1937. La composition du nouveau gouvernement reflète cette nouvelle politique plus modérée avec des radicaux qui reprennent le dessus sur la SFIO même si Blum est vice-président du Conseil. On assiste alors au délitement du Front populaire avec un parti radical toujours pivot de la vie politique mais qui va, sous la pression de sa base, gouverner avec la droite. Chautemps s’emploie à rassurer la famille radicale et ceux qui ont pris peur de l’ampleur des grèves et de la remise en cause du principe de la propriété par les « partageux ». L’union et l’euphorie de 1936 ne sont plus là, la SFIO et le PCF veulent l’application du programme commun. La seule grande réalisation reste sans doute la création de la SNCF, la plus vaste société d’économie mixte qui compte plus de 500 000 salariés. Malgré cette initiative, l’immobilisme et le glissement à droite des radicaux accentuent les critiques de la gauche et des ouvriers aussi bien au niveau national que provincial. A cause de la remise en cause des 40h, des grèves éclatent et la SFIO quitte le gouvernement le 13 janvier 1938. Le 15, Camille Chautemps donne sa démission mais après les échecs de constitution de gouvernement (Blum, Herriot, …), il reprend les rênes du pouvoir pour peu de temps. Il démissionne lorsque les socialistes lui refusent les pleins pouvoirs financiers (mars).
Le second gouvernement Blum, qui ne dure qu’un mois, reflète l’agonie du Front populaire. Si Blum propose un programme volontariste basé sur la relance économique (effort industriel basé sur le réarmement), le virement à droite des radicaux et donc leur manque de soutien, le pousse à démissionner dès le 7 avril 1938. Edouard Daladier forme le nouveau gouvernement dans lequel rentre des dirigeants de droite comme Paul Reynaud (Justice) ou Georges Mandel (Colonies). Daladier ne rompt pas complètement encore avec le Front populaire en choisissant des radicaux de gauche comme Jean Zay ou Pierre Cot. Même les communistes investissent ce gouvernement ! A trois moments, Daladier remet en cause la logique du Front populaire et annonce la fin de celui-ci :
- la multiplication des décrets-lois (182 en deux mois) et l’assouplissement de la loi des 40h. A ce sujet, les tensions au sein du gouvernement se multiplient et causent la démission de Frossard et Ramadier (USR). Paul Raynaud assume vouloir obéir aux lois capitalistes : le profit, le risque individuel et la liberté des marchés.
- la signature des accords de Munich le 29 septembre 1938. Peu après, les radicaux quittent le Comité national du Rassemblement populaire.
- la répression des grèves de novembre-décembre en région parisienne et dans le Nord (intervention des gardes mobiles, licenciements, …)
Au fur et à mesure, les députés socialistes et communistes sont rejetés dans l’opposition, Daladier les accusant de saper l’autorité de l’Etat. Celui-ci s’appuie désormais sur une majorité allant des radicaux à la droite … c’est bien la fin du Front populaire. Pour Jean Vigreux, « ce virage est aussi révélateur d’une crise de la SFIO qui, depuis 1937, doit gérer ses propres contradictions, et souligne aussi la surenchère communiste » (p.221).
Chapitre 7 –
Dans ce chapitre, Jean Vigreux revient sur le processus de politisation et d’acculturation républicaine du peuple. L’historien répertorie et explicite les différents moyens à l’origine de cette intense mobilisation et politisation faisant du Front populaire un moment spécifique de l’entrée en politique « des masses » :
- l’engagement dans le milieu associatif avec le rôle joué par le Secours populaire, la LDH (Ligue des Droits de l’Homme), la LICA (Ligue Internationale Contre l’Antisémitisme), les comités locaux de Rassemblement populaire, … Cet engagement pluriel, qui dépasse les formations politiques, insuffle l’unité « dans une dynamique plurielle » (p.234).
- les syndicats qui connaissent à la fois un moment d’unité (réunification de la CGT) et de renforcement avec les grèves. On passe « d’un syndicalisme d’avant-garde à un syndicalisme de masse » (p.234). Pour la CGT, cette période est celle de l’apogée, pour la CTFC c’est une embellie. Parce que les adhésions se multiplient, il faut former et cela passe notamment par les loisirs (les clubs sportifs, le tourisme, …).
- l’engagement des brigadistes qui intègrent les Brigades internationales. Jean Vigreux estime à 10000 les combattants français dont 2500 à 3000 sont tués lors des combats. La guerre d’Espagne mobilise aussi des volontaires nationalistes et fascistes. Ils sont estimés à environ 1000.
- les partis ou organisations de masse. Le parti radical-socialiste, pourtant pilier du modèle républicain, ne profite pas vraiment de l’élan unitaire du rassemblement à gauche à part ses « jeunes-turcs » comme Pierre Cot, Jean Zay ou Pierre Mendès France. La SFIO voit ses effectifs gonfler au bénéfice de la victoire électorale. Le parti acquiert surtout un encrage électoral aussi bien au niveau national que local et même jusqu’au cœur des usines. Le PCF voit aussi son implantation se renforcer en passant d’une « implantation en archipel à une implantation nationale » (p.241). Le parti se forge aussi une identité autour de l’image de l’ouvrier incarné par Maurice Thorez, l’ouvrier devenu cadre du parti. Dans les partis, les jeunes aussi se mobilisent au sein des Jeunesses socialistes ou des Jeunesses communistes. L’historien n’oublie pas les partis de droite qui échoue à faire gagner le Front national mais se réinventent suite à la dissolution des ligues et se radicalisent (le PSF, le PPF). Ils s’appuient sur un maillage de presse important aussi bien au niveau national qu’en province et aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu rural.
La période du Front populaire est aussi un moment ou les rites, les rituels et leurs symboles politiques s’affirment. Les manifestations, les gestes (le poing levé ou le bras tendu), les chansons, les drapeaux, les insignes, parfois les uniformes soulignent parfaitement cette bipolarisation de la vie politique française.
Chapitre 8 –
Dans ce dernier chapitre, Jean Vigreux s’intéresse à la manière dont chacun a pu vivre l’expérience du Front populaire en fonction des groupes sociaux ou des classes sociales. Il passe en revue :
- les élites intellectuelles et notamment l’extrême prudence du milieu universitaire.
- l’Eglise avec une grande différence entre le sommet de la hiérarchie et la base. Au sein même de celle-ci, rien à voir entre les catholiques les plus conservateurs et les chrétiens-démocrates. Pour l’historien, si la période du Front populaire confirme l’attachement de nombreux catholiques aux partis de droite, elle brise aussi « l’assimilation automatique » (p.275).
- le patronat s’organise au sein du CGPF en organisation de combat qui doit lutter voire se venger. Il y a, après les accords Matignon, la volonté de replacer l’autorité au centre des relations entre patrons et ouvriers. La période a contribué à accentuer la bipolarisation de ces relations entre un « bloc patronal » et un « bloc ouvrier ».
- les forces de l’ordre et l’appareil d’Etat où il n’y a pas non plus d’uniformité. Avec le front populaire, certains espèrent d’autres craignent et donc surveillent et répriment.
- les femmes qui elles aussi oscillent entre espoir et déception. Les 40h, les congés payés ou la participation à la vie syndicale leur profitent aussi mais c’est en termes d’égalité salariale et politique que la désillusion est grande. Comme l’a dit Louise Weiss : « trois hirondelles ne font pas le printemps ».
- les sociétés coloniales souvent déçues comme le mouvement de Messali Hadj qui quitte le Rassemblement populaire en 1937 afin de devenir le Parti du Peuple Algérien (PPA).
Pour conclure, Jean Vigreux restitue dans cet ouvrage de référence le « petit goût de révolution » (Ernest Labrousse) qui accompagne le Front populaire de sa création jusqu’à sa dissolution. Ce moment historique a marqué durablement notre vie politique et sociale aussi bien pour ses admirateurs que ses détracteurs. L’historien, lui, retrace le bref parcours du Front populaire en s’intéressant aux évènements, aux acteurs et aux dynamiques du local au national, de la métropole aux colonies en n’oubliant jamais de les replacer dans un contexte géopolitique complexe car « c’est sans doute là une des clefs de compréhension du Front populaire qui a su mobiliser et jouer sur un jeu d’échelles sans précédent, inscrivant cette lutte de type nouveau dans des dynamiques multiples et entrecroisées, du village à la nation et de la nation aux enjeux internationaux » (p.44).