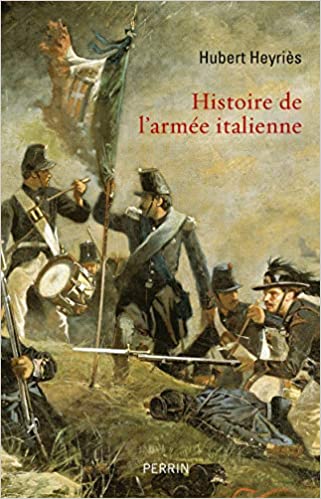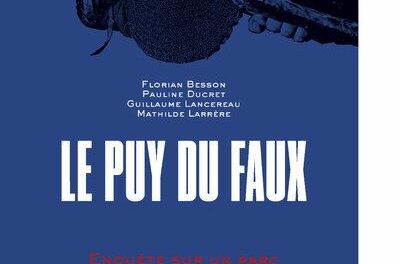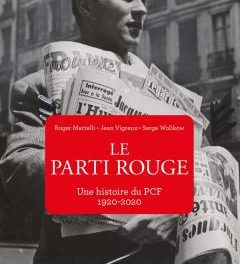Saluons d’emblée la parution de cette belle synthèse sur l’histoire d’une armée italienne à l’image traditionnellement peu flatteuse. On a beaucoup glosé par exemple sur les « trahisons » constantes de l’armée du duc de Savoie sous l’Ancien Régime, commençant la guerre dans un camp, la terminant dans un autre, ou sur l’entrée en guerre de l’Italie en 1915 contre ses anciens alliés de la Triplice. On s’est moqué de ses nombreuses défaites, dont celle, emblématique, de Caporetto, en 1917. Les soldats italiens n’ont pas meilleure presse, assez souvent présentés comme de mauvais combattants ou des lâches.
Hubert Heyriès, qui vient de décéder, était professeur d’histoire contemporaine de l’Italie à l’université Paul-Valéry-Montpellier III et réputé pour ses nombreux ouvrages consacrés à Garibaldi, aux Garibaldiens et aux questions militaires de l’Italie, du Risorgimento à la Seconde Guerre mondiale. Dans cet opus, qui est, malheureusement, le dernier d’une riche série, Hubert Heyriès n’entendait pas s’engager dans une vaine entreprise de réhabilitation mais offrir une image équilibrée d’une armée qui ne mérite pas l’image globalement négative qui, pour telle ou telle raison, lui colle à la peau. Il y est parvenu et c’est avec beaucoup d’émotion et une immense considération pour son oeuvre que nous livrons ce compte rendu.
L’armée italienne proprement dite voit le jour le 4 mai 1861, soit très peu de temps après la proclamation du royaume d’Italie. L’histoire à venir de cette armée est fort riche mais très méconnue en France. Si l’histoire militaire est « reléguée au second plan » (p. 10) en Italie, elle est tout de même marquée par une grande vitalité et un renouvellement non négligeable des problématiques.
L’un des intérêts marquants de l’ouvrage d’Hubert Heyriès est qu’il s’appuie sur des sources italiennes de première main ainsi que sur les travaux d’historiens transalpins éminents comme Giorgio Rochat ou Nicola Labanca qui ont, notamment, beaucoup écrit sur les guerres coloniales de l’Italie. L’appareil critique comme la riche bibliographie qui terminent le livre témoignent du travail colossal de l’auteur qui lui a permis de mettre à notre portée les derniers acquis de la recherche dans le domaine. Comme les champs de recherche et les questions sont nombreux, il lui a fallu faire des choix, dont certains peuvent finalement paraître frustrants. Mais le livre est organisé autour d’un fil conducteur stimulant : dans quelle mesure l’armée italienne a-t-elle partie liée au processus de construction de la nation, la « nation building » dont nous parle constamment l’auteur ?
La nationalisation de l’armée royale d’Italie (années 1860-années 1900)
Quand l’armée italienne voit officiellement le jour en 1861, on ne peut nullement voir en elle une armée nationale. La nation et le sentiment associé restent à forger. Il lui faut composer avec des traditions militaires locales fortes et un sentiment de supériorité qui anime les cadres des armées piémontaise et napolitaine, les deux meilleures armées de la péninsule ou, du moins, qui jouissent de la meilleure image. Cependant, elle ne sont pas sur un pied d’égalité : l’armée piémontaise, refondée sur le modèle français dans les années 1850 sous l’égide du général Della Marmora, ministre de la guerre, est l’outil majeur de la conquête ; l’armée napolitaine, elle, est vaincue en 1860…
Le rôle central du Piémont dans le processus de conquête et d’unification de la péninsule et le complexe de supériorité de ses officiers expliquent la « piémontisation » forcée de la nouvelle armée, marquée notamment par l’adoption de tous les règlements de l’armée piémontaise et de son uniforme, l’extension à partir de 1862 de la conscription à l’ensemble de la péninsule et l’écrasante domination des Piémontais aux postes les plus élevés. Cette piémontisation suscite parfois de fortes résistances, concrétisées en particulier par le rejet de la conscription, qui s’élève par exemple à 40 % dans les grandes villes du Mezzogiorno et à 30 % en Italie centrale.
Quoi qu’il en soit, la nouvelle armée doit relever, dans l’immédiat, trois défis : réprimer ce que les Piémontais appellent le « brigandage postunitaire » dans l’ancien royaume des Deux-Siciles ; réussir la IIIè Guerre d’indépendance, contre l’Autriche (c’est chose faite en 1866, malgré de lourdes défaites militaires, avec l’intégration de la Vénétie) ; prendre Rome (il faut attendre octobre 1870 pour l’annexion) et en faire la capitale du royaume d’Italie (1er juillet 1871).
Dans le Sud, l’armée royale est confrontée à une résistance qui ne peut être réduite au « brigandage » dont on l’affuble abusivement : entre 1861 et 1866, chaque régiment passe en moyenne vingt-neuf mois dans ce Mezzogiorno où se déroule une guerre « longue et terrible des deux côtés, alternant terreur et contre-terreur, guérilla et contre-guérilla, embuscades et attentats, villages incendiés, massacre des populations civiles, enlèvements, tortures » (p. 57).
En ses débuts, la Défense nationale est choyée : le budget conséquent qui lui est allouée permet de moderniser l’armement et de mieux former les cadres, mais également de soutenir une politique d’expansion qui conduit, pour la première fois, l’Italie à projeter son armée nationale hors du territoire.
En Europe, l’adhésion à la Triplice (1882), essentiellement tournée contre la France, et la convention militaire signée avec l’Allemagne (1888) l’obligent à envoyer en Allemagne du Sud des corps d’armée et des divisions de cavalerie. Toutefois, cette adhésion ne permet pas une protection complète de l’Italie car les marines allemande et autrichienne n’entendent pas protéger ses littoraux d’une éventuelle agression française.
En Afrique de l’Est, l’achat (1882) du territoire de la baie d’Assab constitue un préalable à la conquête de l’Erythrée et à la création consécutive de la première colonie africaine de l’Italie en 1890 (après que le roi d’Ethiopie Ménélik II, vaincu, a signé en 1889 le traité d’Uccialli). Mais l’« amère débâcle » (p. 102) face à l’armée du Négus à Adoua (1896) provoque un choc en Italie qui bloque pour quelques décennies l’expansion italienne en Afrique orientale…
L’armée italienne est une armée de masse (service obligatoire et universel, même si le tirage au sort n’est supprimé qu’en 1911) au service court (trois ans à partir de 1875). Elle est devenue progressivement le ciment de la nation : le régiment est le lieu de brassage de recrues venues de toute la péninsule et le lieu de diffusion de la langue italienne que les soldats sont contraints de parler et de comprendre pendant les longs mois du service militaire.
Par ailleurs, des vecteurs tels que l’école ou la littérature patriotique (avec, au premier plan, le « Cuore » d’Edmondo De Amicis) diffusent une pédagogie militaire et nationale censée produire des « soldats prêts à défendre l’Italie libérale et laïque, monarchique et constitutionnelle » (p. 91) contre les ennemis de l’intérieur (les « classes dangereuses » travaillées par l’anarchisme et le socialisme) comme de l’extérieur. D’ailleurs, l’armée italienne a « confirmé sa capacité à maintenir l’ordre, montrant dans la répression discipline et loyalisme » (p. 110).
Grâce à un effort financier non négligeable, mais qui n’est toutefois pas à la hauteur de celui des grandes puissances continentales, et à une meilleure articulation entre pouvoir civil et autorité militaire, l’armée italienne est devenue, à la veille du premier conflit mondial, une armée de masse capable, avec des moyens modernes, de défendre le pays en cas de conflit, sur terre comme sur mer. Avec deux pays dans la ligne de mire : la France, bien sûr, mais aussi l’Autriche-Hongrie (malgré la Triplice). D’où la nécessité de verrouiller les Alpes, d’Est en Ouest.
L’épreuve de la Grande Guerre et ses suites (1914-1921)
En août 1914, l’Italie affiche sa neutralité sans pour autant dénoncer le traité d’alliance avec les Empires centraux. Moins d’un an plus tard, l’Italie change d’alliance et déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie en mai 1915 (mais à l’Allemagne seulement en août 1916). La conduite des opérations est tout entière entre les mains du général Luigi Cadorna, chef d’état-major général puis du « Comando Supremo » (GQG) de juillet 1914 à octobre 1917 : « Aucun autre commandant en chef n’eut autant de pouvoirs, au point de nourrir des critiques dénonçant sa dictature » (p. 157). Il met du temps à mobiliser le nombre d’hommes nécessaires à la confrontation contre l’Autriche-Hongrie, ce qui permet à cette dernière de se préparer et de résister aux offensives de Cadorna.
Ce dernier, tenant d’une guerre agressive, n’hésite pas à sacrifier de nombreux soldats dans des assauts meurtriers qui ne parviennent pas à rompre le front. Il en rend responsables les soldats auxquels il impose dès lors une discipline de fer : il fait tout son possible pour limiter les permissions, pour réprimer, parfois aveuglément Ainsi, le 28 novembre 1915, le général commandant de la IIe armée ordonne aux carabiniers de tirer au moindre signe d’ « hésitation dans l’attaque ». Cadorna lui-même ordonne la sentence de la décimation le 1er novembre 1916, consistant, en cas de « délits collectifs », à tirer au sort parmi les suspects quelques militaires, exécutés sur-le-champ!, les désertions, réelles ou supposées. Les soldats, qui chantent les misères de la tranchée et de la guerre, n’épargnent ni Cadorna ni le roi.
Pour percer le front italien, Vienne sollicite l’appui de Berlin. La confrontation, à laquelle Cadorna ne s’attendait pas, a lieu dans l’actuelle Slovénie, à Caporetto (Kobarid) du 24 octobre au 9 novembre 1917. C’est « sans doute la pire défaite de toute l’histoire de l’armée italienne » (p. 181) : Cadorna en rejette, comme à son habitude, toute la responsabilité sur les combattants de la IIè armée qui ont pourtant fait tout leur possible.
Dans l’immédiat, le Frioul et une partie de la Vénétie sont envahis et le front se stabilise sur le Piave qui devient « la Marne des Italiens » (p. 197). La guerre prend dès lors pour les Italiens une tournure nettement défensive. Cadorna est alors remplacé par le général Armando Diaz qui améliore les conditions de vie des soldats sans toutefois assouplir significativement la discipline.
La guerre a été l’occasion de tester, malgré les faiblesses du commandement, l’efficacité du soldat italien sur un théâtre conflictuel aux dimensions et à la nature inédites. Malgré un lourd bilan humain, l’armée italienne a réussi à surmonter sa première grande épreuve collective et les soldats n’ont pas démérité.
On peut comprendre, dès lors, que le fascisme ait, globalement, placé cette armée nationale au coeur de son idéologie et de sa rhétorique nationaliste et qu’il ait, en particulier, valorisé la figure de l’ardito Il est reconnaissable à son uniforme (cravate noire, fez noir avec un pompon noir), son cri de reconnaissance, ‘A noi !’ (‘A nous !’) et à son hymne, « Giovinezza » (futur chant officiel du régime fasciste) , incarnation du « combattant obéissant, ‘sachant vaincre ou mourir’, tenace dans la défensive et audacieux dans les coups de main, totalement dévoué à la patrie et méprisant le danger » (p. 198).
Le contexte très troublé des années 1918-1921 favorise la montée du fascisme et son accession au pouvoir. L’armée apparaît alors comme le seul organe susceptible de défendre le régime libéral vacillant. En 1922, lors de la « marche sur Rome », le roi renonce à l’état de siège, au grand soulagement des fascistes… et des forces armées qui, dans l’ensemble et dans les mois qui précèdent, ont fait preuve de « passivité complaisante » (p. 233) face aux menées fascistes.
Le gouvernement de coalition que dirige Mussolini reflète dès lors une sorte d’alliance entre trois des piliers de l’Italie post-guerre : la monarchie, à laquelle l’armée reste fidèle envers et contre tout ; l’armée, qui se satisfait de voir deux de ses hauts cadres nommés à des postes-clés ; les fascistes, qui ne peuvent manoeuvrer sans l’appui du roi et de son armée.
L’armée et le fascisme : une alliance et ses limites (années 1920-années 1930)
Au cours du « Ventennio » (1922-1943), Mussolini est le chef des forces armées : à plusieurs reprises, il concentre sous son autorité les trois ministères de la Guerre, de la Marine et de l’Aéronautique, même si son pouvoir en la matière est délégué à des ministres, à des sous-secrétaires et à des chefs d’état-major qu’il choisit lui-même et qu’il change régulièrement « pour se prémunir de toute coterie clanique » (p. 236) qui menacerait son autorité.
Malgré la création en 1923 d’une Milice volontaire pour la Sécurité nationale La MVSN, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. On reconnaît ses membres à leur uniforme, la chemise noire. Elle est méprisée par la hiérarchie militaire en raison du « comportement violent, arbitraire, voire grotesque » (p. 241) de ses chefs. Son recrutement se fait sur une base uniquement volontaire., bientôt intégrée à l’armée, sans pour autant s’y fondre, le régime fasciste échoue à imposer une direction politico-militaire : cela garantit donc, d’une certaine manière, l’indépendance des forces armées et facilite leur soutien au régime. Notons tout de même que les premiers à se rallier au régime sont les hauts cadres militaires, comme Cadorna, Diaz ou Badoglio. La troupe, elle, n’a, globalement, jamais adhéré à la propagande fasciste.
Pour servir les objectifs de conquête de Mussolini Mussolini déclare en 1934 : ‘Il ne faut pas être prêt à la guerre demain, mais aujourd’hui’ (cité p. 248), la nation italienne subit un processus de militarisation marqué notamment par une instruction prémilitaire dès l’âge de six ans, obligatoire à partir de 1930. N’étant pas parvenu à créer une armée « fasciste », le régime essaie toutefois d’y imprimer sa marque : si l’adhésion obligatoire (1934) des cadres militaires au Parti national faciste (PNF) ne pose guère de problèmes, en revanche d’autres mesures passent difficilement, comme l’adoption du « pas de l’oie » (de l’armée nazie) rebaptisé « pas romain »… ou l’obligation de chanter « Giovinezza », hymne fasciste.
S’il ne rechigne pas à rabaisser occasionnellement la fonction monarchique Ainsi, en 1938, une loi attribue le titre honorifique de premier maréchal de l’Empire au Duce et à Victor-Emmanuel III, manière pour Mussolini, sujet du roi, de se considérer comme l’égal de ce dernier…, Mussolini sait qu’il convient de ne pas aller trop loin, tant le peuple italien comme son armée se montrent très attachés à la monarchie. L’armée prête d’ailleurs un serment de fidélité au roi que Mussolini n’ose abolir.
L’armée du « Ventennio » : des guerres coloniales à la guerre mondiale
Le 4 mai 1936, Mussolini annonce : ‘L’Italie a enfin son empire […]. [Saluez], après quinze siècles, la réapparition de l’Empire […] romain.’ cité p. 261 La constitution d’un empire colonial italien trouve ses origines à la fin du XIXè siècle mais elle est pleinement réalisée au cours des années 1920 et 1930, sous l’égide notamment du maréchal Graziani : en Afrique du Nord, (re)conquête et unification (1934) des territoires libyens de Tripolitaine et de Cyrénaïque ; en Afrique orientale, (re)conquête de la Somalie (1925-1929) puis conquête de l’Ethiopie (1935-1936) sur le territoire de laquelle est menée « une guerre fasciste totale, d’anéantissement, de masse et de race » (p. 268).
La victoire rapide face à l’ennemi éthiopien (sous-équipé) soulève une vague d’enthousiasme populaire dans la péninsule. Mais l’affaire est un gouffre financier (20% des dépenses publiques) et un désastre moral (le pays est mis au ban de la communauté internationale pour avoir utilisé massivement, comme en Libye précédemment, l’arme chimique).
Par ailleurs, Mussolini considère la Méditerranée comme la chasse gardée et la sphère naturelle de l’Italie, depuis l’Antiquité… Il vient donc en aide aux nationalistes espagnols : Majorque est alors transformée en base aérienne et navale italienne jusqu’en 1939 et 50 000 volontaires du CTV (Corpo truppe volontarie) sont envoyés combattre sur le théâtre espagnol. En 1939, les troupes italiennes envahissent l’Albanie, opération conçue comme un préalable à l’expansion éventuelle vers la Yougoslavie et la Grèce.
Cet appétit de conquêtes, lié à l’obsession impériale fasciste en Méditerranée et en Afrique, conduit logiquement Mussolini à se lancer en 1940, aux côtés des Allemands, dans « une guerre ‘parallèle’ » (p. 288) risquée compte tenu à la fois du contexte géopolitique et des fragilités de l’armée, affaiblie par deux décennies d’engagement coûteux hors du territoire péninsulaire et par une modernisation insuffisante. En 1939, l’armée italienne est dans l’incapacité d’affronter un conflit mondial de longue durée. Mussolini décrète ainsi l’état de non-belligérance le 1er septembre 1939.
Mais les généraux italiens sont consternés d’apprendre (par la radio!) que Mussolini déclare la guerre à la France et au Royaume-Uni le 10 juin 1940. L’ambassadeur de France à Rome, André François-Poncet, s’adresse de manière cinglante à Ciano : ‘Vous avez attendu que nous fussions à terre pour nous donner un coup de poignard dans le dos. A votre place, je n’en serais pas fier.’ in André François-Poncet, Au Palais Farnèse. Souvenirs d’une ambassade à Rome, 1938-1940, Fayard, 1961, cité p. 301. L’attaque italienne, le 21 juin, a lieu dans une impréparation totale et aboutit à un bien maigre résultat : « 800 km² conquis et 28 000 habitants occupés, dont 21 700 Mentonnais ! » (p. 305)
En 1941, l’Italie essuie défaite sur défaite : débâcle en Egypte, « un Caporetto africain » (p. 314) ; perte de la Cyrénaïque puis de l’Ethiopie… « En définitive, fin mars 1941, les Italiens avaient perdu l’initiative sur tous les théâtres d’opérations et éprouvé un sentiment d’humiliation et d’impuissance lié aux défaites militaires en Afrique et en Méditerranée et aux victoire imméritées en France et en Grèce » (p. 316).
Désormais contrainte de suivre les directives de son allié allemand, l’Italie perd toute initiative et mène, en Afrique du Nord, en URSS, dans les Balkans et en Méditerranée une « guerre subalterne » (Chapitre 12), entre mars 1941 et septembre 1943 (armistice de Cassibile avec les Alliés). Les Allemands, « par une sorte de racisme antilatin » (p. 330), taisent ou minimisent systématiquement les rares succès remportés par les soldats italiens, comme en Afrique du Nord où l’on a retenu les « exploits » de la Deutsches Afrika Korps de Rommel et quelque peu oublié le courage et le sacrifice des troupes italiennes.
Les errements de l’armée italienne tiennent dans une large mesure au manque de cohérence du haut commandement et de ses objectifs stratégiques. Ainsi, Mussolini ne mesure pas « l’effet désastreux de la dispersion des forces sur des théâtres d’opérations trop éloignés les uns des autres » (pp. 325-326). L’option du Duce de ne pas déclarer la mobilisation générale a fortement amoindri la capacité opérationnelle de l’armée, privée des effectifs nécessaires à une projection efficace sur les différents théâtres d’opération. H. Heyriès estime en effet qu’à peine un million de soldats italiens ont alors connu les souffrances de la guerre contre plus de quatre millions au cours de la Grande Guerre.
Les événements de l’été 1943 en Sicile (débarquement anglo-américain et débâcle des troupes italiennes) conduisent le Grand Conseil fasciste à mettre Mussolini en minorité et à le remplacer par le maréchal Badoglio qui ne remet en cause ni la guerre ni l’alliance avec l’Allemagne.
Néanmoins, très rapidement, l’armistice du 3 septembre 1943 avec les Anglais, les Etats-Uniens et les Soviétiques, conduit le pays à cesser toute activité militaire aux côtés des Allemands et à accepter l’occupation alliée. L’armistice n’est annoncé à la population que le 8 septembre ; le lendemain, Badoglio, le gouvernement et le roi quittent Rome pour Pescara et Rimini afin de rejoindre les Alliés et de former le « Royaume du Sud ». La population se sent trahie. Les Allemands font alors 650 000 prisonniers et s’emparent d’un formidable arsenal.
Mussolini, qui a été libéré par un commando SS, prend la tête d’une République sociale italienne (RSI), « Etat fantoche sous contrôle des nazis » (p. 346) qui s’étend au nord et au centre de la péninsule jusqu’à Naples. La péninsule est alors le théâtre d’un conflit entre des forces armées déchirées, celles de la Résistance (désunies jusqu’à la création du Corps des Volontaires de la Liberté Le CVL, Corpo Volontari della Libertà qui, lors de l’Insurrection générale du 25 avril 1945, aligne des forces considérables ; l’ « armée » de la RSI (en son sein, les brigades noires, créées en juin 1944, mènent une guerre impitoyable contre les résistants) ; une armée du Sud, largement contrôlée par les Alliés, par le biais de la MMIA La « Military Mission to Italian Army » exerce un contrôle si tatillon sur l’activité du commandement que les Italiens la surnomment ‘Mamma Mia’…..
Après la guerre : les défis d’une armée désormais républicaine
Si, au lendemain de la guerre, l’armée est largement épargnée par l’épuration, « l’état-major pratiqua[nt] l’autoabsolution sans jamais être contesté » (p. 376), la compromission du roi avec le fascisme signe l’arrêt de mort de la monarchie : le référendum du 2 juin 1946 donne une courte majorité aux partisans de la République. L’Italie est désormais républicaine.
Les chefs des trois armes respectent le verdict et l’adoption en 1947 du nouveau drapeau républicain privé de la croix de Savoie ne provoque aucune difficulté. L’armée italienne entend continuer à jouer son rôle de garante des institutions, fussent-elles républicaines. Même si la Constitution de 1948 rejette la guerre « comme instrument portant offense à la liberté des autres peuples et comme moyen de règlement des controverses internationales » (article 11), la défense du pays reste un « devoir sacré » (article 52) : l’armée de masse est donc maintenue, avec un service militaire obligatoire de douze mois, puis de dix-huit mois à compter de 1951.
Si le traité de Paris (1947) confirme le statut de l’Italie comme pays vaincu, la normalisation intervient très rapidement : le statut d’occupation prend fin la même année, avec le départ des forces anglo-américaines ; le pays adhère à l’Otan dès sa création (1949) sous l’égide d’un gouvernement démocrate-chrétien, atlantiste et anticommuniste, et devient, dès lors, dans le contexte de guerre froide, un « pays de frontière » avec le bloc de l’Est, exposé à une guerre nucléaire avec l’URSS et à une guerre conventionnelle avec la Yougoslavie titiste. En outre, lorsque la France se retire du commandement intégré de l’Otan, le collège de défense est transféré de Paris à Rome.
Par ailleurs, dans le cadre de l’Otan, l’Italie devient une terre nucléarisée : elle ne dispose pas de sa propre arme atomique mais elle a la possibilité, en cas de crise, de donner son accord sur l’utilisation des armes nucléaires qui sont installées sur son sol. La signature (1968) puis la ratification (1975) du Traité de non-prolifération lui interdit de se doter de l’arme atomique, ce qui, d’une certaine manière, signe sa relégation au second rang des puissances militaires.
L’Italie joue néanmoins un rôle important au sein de l’Alliance atlantique et de l’ONU en prenant part à des opérations extérieures : l’auteur indique ainsi que, des années 1960 aux années 1990, l’Italie a participé à près d’une centaine de missions dans des dizaines de pays. Les militaires italiens ont fini par acquérir l’image, fort sympathique aux yeux de l’opinion internationale, d’ « angeli della pace » « anges de la paix » et le « savoir-faire italien de peace-keeping (‘maintien de la paix’) » (p. 425) est largement reconnu.
Les années 1970 et 1980 constituent une période difficile pour les forces armées. Beaucoup de cadres de l’armée jugent alors disproportionnées les missions à remplir en comparaison des capacités limitées de l’outil militaire, surtout compte tenu de la crise économique qui freine la modernisation. Par ailleurs, les « années de plomb » ternissent quelque peu l’image de l’armée : marquée par de nombreux attentats, assassinats et enlèvements, la période témoigne des compromissions de certains secteurs de l’armée et du renseignement avec l’extrême-droite.
Par exemple, le chef des services secrets (SID) est impliqué dans le coup d’Etat, piteusement raté, de l’officier (retraité) néo-fasciste Junio Valerio Borghese en décembre 1970. Cela conduit à la refondation des services de renseignement et à l’interdiction (1978) pour les militaires de participer à des manifestations politiques, en uniforme ou durant le service, et de faire de la propagande. L’auteur relativise toutefois les dangers réels de cette tentative « golpiste » « putschiste ». Si des menaces ont pu exister, « l’Italie ne fut jamais la Grèce ou le Chili » (p. 416) et le corps des officiers s’est toujours distingué, globalement, par son apolitisme.
Dans les années 1970, l’armée est la cible de manifestations en faveur de la reconnaissance de l’objection de conscience (actée en 1977) et d’une forme d’antimilitarisme qui, à la suite de l’incorporation des étudiants sursitaires de 1968, se manifeste par la reproduction dans les casernes de « la lutte des classes opposant les conscrits-prolétaires aux officiers-bourgeois » (p. 418). L’Etat, d’une certaine manière, accompagne le mouvement de défiance : après avoir considéré (1964) que l’obéissance au sein de l’armée ne devait plus être « absolue », mais « sans hésitation », il estime (1978) que les gradés, à rebours d’une longue tradition, doivent se montrer respectueux à l’égard du soldat-citoyen.
La fin de la guerre froide conduit à forger un nouveau modèle de défense : « désormais régionaux, asymétriques et de dimensions réduites, les futurs conflits se situeraient dans une aire proche (euro-atlantique et euro-méditerranéenne) ou lointaine (à des milliers de kilomètres) et exigeraient en conséquence mobilité, réactivité, capacité de projection, haute technicité des personnels » (p. 429). Cela conduit donc l’Italie, à l’instar de nombreux pays, à abandonner la conscription obligatoire (2005) au profit d’une armée de métier. L’armée italienne devient donc une armée de volontaires professionnels.
Elle est même réorganisée en 2002 à la suite du constat accablant (qui pourrait d’ailleurs, sur bien des points, valoir pour de nombreuses périodes de l’histoire de l’armée italienne) dressé par le livre blanc de la Défense de 2001 : « états-majors pléthoriques, 30 000 hommes à peine opérationnels, manque d’interopérabilité avec les forces d’autres puissances et manque de culture interarmes, sous-équipement des unités, dépenses en personnel excessives par rapport aux dépenses d’armement » (pp. 439-440).
Dès lors, « la structure modulaire devi[e]nt la règle pour constituer des ‘groupes opérationnels’ formés d’unités complémentaires interarmes disposant d’une logistique propre » (p. 444) tandis que la marine a la capacité de mener différents types d’opérations, à proximité ou très loin des côtes italiennes. En 2015, le livre blanc de la Défense pointe d’autres faiblesses, notamment l’éloignement du citoyen de tout ce qui a trait à la Défense en raison de la professionnalisation des forces armées…
Grâce ce travail, tout à la fois minutieux et synthétique, l’auteur dresse le portrait nuancé d’une armée italienne engagée sur de nombreux terrains au fil d’une histoire mouvementée et marquée par de nombreuses tragédies. Les soldats italiens, souvent entraînés dans des guerres dont ils ne saisissaient guère les enjeux, ont joué leur rôle et ne méritent sûrement pas l’image dépréciative qui leur a longtemps collée à la peau. L‘auteur est également parvenu à montrer que les forces armées ont toujours accompagné le processus de construction de l’Etat-nation et qu’au cours de l’histoire du royaume d’Italie puis de la République italienne s’est forgé, malgré bien des vicissitudes et les évolutions récentes, « un lien indissoluble de la nation à son armée et de l’armée à la nation » (p. 460).