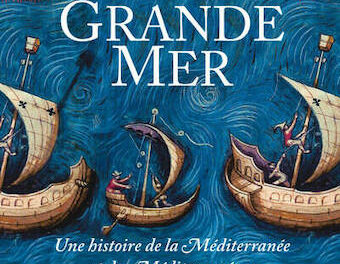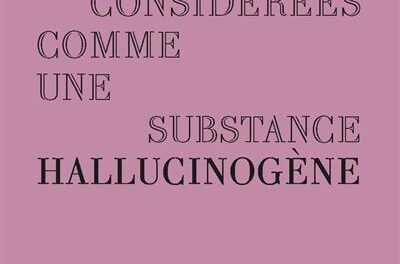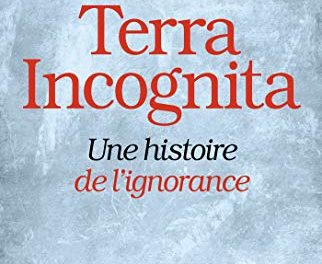Encombrement des espaces, netteté de la peau, intimité sensible, les critères anciens du propre et du sale ne sont plus ceux d’aujourd’hui.
Des faits apparemment identiques ne déclenchent au fil du temps ni les mêmes appréciations ni les mêmes réactions : la transpiration collant à la peau, le cheveu supportant la vermine, l’odeur émanant des corps. La propreté de nos pères, celle de l’Europe classique par exemple, n’était pas la nôtre : elle pouvait exister sans le recours à l’eau, en favorisant quasi exclusivement l’apparence extérieure, l’habit. L’histoire du propre et du sale est ainsi celle d’un lent raffinement. Elle montre comment se fabriquent les seuils du goût et du dégoût. Leurs différences avec les nôtres réveillent la conscience de notre propre sensibilité.
Cette histoire est aussi davantage. Elle montre encore comment s’enracinent au plus près des repères corporels, des différences marquantes entre les groupes sociaux. La dentelle blanche de l’aristocrate du Grand Siècle n’a aucun rapport avec le chanvre écru du laboureur. Non que cette différence soit celle de l’ustensile ou de l’accessoire. Elle est d’abord celle du corps. Elle révèle combien la distance sociale, devenue abîme, tient au sentiment de ne pas avoir le même corps.
Compte rendu réalisé par Eléonore de Toytot, étudiante en hypokhâgne (2022-2023) au lycée Claude Monet de Paris dans le cadre d’une initiation à la réflexion et à la recherche en histoire.
Qui est l’auteur ?
Georges Vigarello est un historien français, né en 1941 et spécialiste des pratiques corporelles. Diplômé en éducation physique et agrégé de philosophie, il est maintenant directeur d’études à l’EHESS où il possède une chaire en histoire des pratiques corporelles. Ses travaux se préoccupent du corps, de ses normes et pratiques destinées à l’entretenir et à l’embellir (Histoire de la beauté : Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours, 2004). Il s’intéresse aux pratiques physiques (Passion sport : Histoire d’une culture, 1999), corporelles (Le Corps redressé, 1978), mais surtout aux représentations auxquelles elles donnent lieu (Les Métamorphoses du gras : histoire de l’obésité du Moyen Âge au XXe siècle, 2010). G. Vigarello est considéré comme le spécialiste de l’histoire de l’hygiène et de la santé. Son travail s’attache à rendre compte des évolutions des imaginaires et des représentations qui s’illustrent dans les pratiques corporelles. Dans Le Sentiment de soi. Histoire de la perception du corps. XVIe-XXe siècles (2014), il établit une histoire unique de la conscience corporelle. Le corps est un objet d’expériences individuelles mais qui relève de pratiques influencées et normées par la collectivité. Ainsi, l’étude des pratiques liées au corps est un angle d’attaque pertinent pour mettre en perspective les grands changements culturels et sociétaux de l’histoire, ce qu’il fait ressortir dans son Histoire de la fatigue : du Moyen-Âge à nos jours, publiée en 2020.
Ses publications en collection poche lui permettent d’être apprécié par un public large et pas uniquement spécialiste des questions qu’il aborde. Ainsi, Le propre et le sale est un petit ouvrage de 250 pages publié par les éditions du Seuil, racontant une histoire culturelle française étirée sur un demi-millénaire. Des paysans aux courtisans, il raconte la manière dont la propreté s’est imposée, puis dont l’hygiène est née. Il fait une véritable histoire sociale de la relation des Français à leur intimité corporelle. Il s’agit aussi et surtout dans cet ouvrage de mettre en évidence l’histoire complexe de l’hygiène en montrant qu’il n’y a rien de linéaire, qu’elle passe principalement par des déplacements d’exigences et de normes sociales. Structuré en quatre parties articulées chronologiquement autour du rapport des corps à l’eau et encadrées par une brève introduction et une conclusion en guise de synthèse, cette histoire de l’hygiène du corps est jalonnée d’intertitres facilitant la lecture. Aucun document n’accompagne le propos, pas même une bibliographie, seulement les notes en fin d’ouvrage indiquent les sources de l’auteur. Ses sources sont variées et leur mention apparaît le plus souvent dans le corps du texte, il utilise essentiellement des sources écrites de première main.
L’intérêt est de montrer comment les pratiques d’antan ressemblent et divergent à la fois des nôtres. L’histoire de l’hygiène est une histoire de nos comportements les plus quotidiens. Les normes et les imaginaires sont tellement ancrés dans les individus qu’on ne se pose plus la question de leurs origines. Se questionner sur leurs constructions, c’est donc d’abord donner une histoire à nos pratiques et les reconsidérer. L’auteur dit lui-même que pour écrire cette histoire il faut « faire taire nos propres points de repères » et qu’« il faut bouleverser la hiérarchie des catégories de références » afin de mettre en lumière des pratiques et critères oubliés aujourd’hui mais qui étaient bien réfléchis et légitimés pour l’époque : un procédé qu’il est essentiel de travailler en histoire
Résumé
La première partie de l’ouvrage s’appuie principalement sur l’analyse des étuves durant les XVe et XVIe siècles pour raconter le rapport des hommes à l’entretien de leur corps. Au Moyen-Âge, l’eau est perçue comme un liquide dont il faut se méfier car il assouplit les pores de la peau en rendant ainsi le corps vulnérable vis-à-vis de l’extérieur. La peau et l’enveloppe corporelle en général sont fragiles, on les frotte et on les essuie pour les nettoyer. On évite les immersions dans des bains par exemple. Mais ceux-ci sont tout de même utilisés à la cour pour des usages médicaux. Dans les bains publics qui existent tout de même, l’eau diffusée en vapeur ne met pas en danger les corps, elle permet de transpirer, la visée des établissements de bain est uniquement thérapeutique, il ne s’agit en aucun cas d’une question de propreté. Anciennement, les bains (ou étuves) étaient des lieux de plaisir et d’excès. L’eau fut dans un premier temps festive, la promiscuité fut permise et même recherchée, l’eau était associée à la jouissance. Mais ces lieux étant souvent devenus lieux de désordre et parfois de violences, ils ont été de moins en moins tolérés à cause des turbulences et corruptions qu’ils généraient, les dernières étuves disparaissent en France au milieu du XVIe siècle. Ce fut au même moment que la Peste venue d’Espagne préoccupa les populations : la peur de la contagion fut alors poussée à un degré jamais connu, on chercha à supprimer au maximum les communications de toutes sortes.
En changeant d’objet d’étude, dans une seconde partie, G. Vigarello s’efforce de mettre en évidence l’importance du linge dans les exigences de propreté à partir du XVIe siècle. Le linge a changé de statut, il est la marque de la propreté : on ne lave pas le corps mais il faut laver le linge. Le linge par ailleurs doit, pour avoir de la valeur, être décent plus que précieux, sa blancheur en est une marque. Le rôle des vêtements est de suggérer ce qui ne se voit pas. La propreté est surtout affaire de spectacle, elle n’est pas intime de soi à soi. Montrer des apparences, c’est aussi dissimuler. L’auteur établit ici une histoire précieuse et rare de la sociabilité des apparences. Au XVIIe siècle, grand siècle des perruques et poudres, les attentions se déplacent et, avec elles, l’illusion prend place : le fard travaille les traits du visage, la poudre permet de nettoyer les cheveux et d’entretenir leur souplesse, la perruque représente alors le point ultime du caractère factice de l’apparence. Les seuils de sensibilité se sont déplacés et ce sont eux qui dictent les normes en termes de goûts. L’illusion se lit aussi dans la diversification des linges repérée dans les inventaires d’époque. En restituant l’analyse de la source, comme par exemple des inventaires après décès, l’auteur rend l’élaboration de sa connaissance plus vivante et nous inclut dans sa recherche, ce qui facilite la transmission. Les linges se veulent souples, évocateurs, ils mettent en valeur les corps par les dentelles, les broderies et les étoffes plus légères. Les surfaces lavées du corps, quant à elles, sont restreintes mais le visage et les mains (parties apparentes) doivent être nettoyés un minimum, sans abuser de la quantité d’eau car on a peur qu’elle ne s’infiltre dans le corps. On voit très bien cette préoccupation dans les règlements intérieurs des collèges et communautés religieuses par exemple, Ce sont des sources précieuses pour rendre compte des normes et opinions d’une époque. On ne se préoccupe pas de ce qui est caché par le vêtement, l’attention au corps est portée sur l’enveloppe qui l’entoure. Seul l’habit est signe de netteté et de savoir vivre, il s’agit d’un véritable jeu social. La propreté existe par le linge et par le regard des autres. Pour lutter contre les vermines et autres micro-parasites par exemple l’épouillage est courant mais l’important est surtout de changer de linge. On ne fait pas de lien entre vermines et propreté corporelle. Au XVIe et XVIIe siècles, c’est une propreté sèche du corps qui est pratiquée par les français : on maquille la peau, on la frotte et on la couvre.
La troisième partie, portant principalement sur le XVIIIe siècle, montre comment la pratique de l’eau va se modifier, influencée par un imaginaire collectif changeant. Le bain change de statut au milieu du XVIIIe siècle après que les craintes à l’égard des maladies soient tombées et qu’il soit devenu une pratique ostentatoire à la cour du Roi. L’eau acquiert dans les représentations une utilité par l’effet mécanique qu’elle produit sur les corps, on dit que sa chaleur apaise les nervosités. La sensibilité est universalisée. L’eau est là pour renforcer le corps, pas pour le laver. Le bain a un effet thérapeutique, quasi moral puisqu’il agit sur les humeurs. Le bain froid, quant à lui, renforce et revigore. Tout un imaginaire des fonctionnements corporels se construit. L’auteur est en effet très attentif aux déplacements des seuils de sensibilité qui structurent notre rapport au corps. La natation, qui apparaît aussi à la fin du XVIIIe siècle, est promue comme un lieu de tonification des corps. Les livres de santé insistent de plus en plus sur les vertus du froid plutôt que sur les régimes alimentaires, ils commencent tout juste à unir l’eau avec la logique de propreté. A l’inverse du bain froid, le bain chaud devient synonyme de paresse et de mollesse aristocratique. Les valeurs se déplacent et, à l’extrême-fin du XVIIIe siècle, le bain commence à s’installer doucement dans les pratiques privées quotidiennes des élites. L’apparition de nouveaux meubles de propreté dans les plans d’aménagements des logements et des hôtels permet de rendre compte d’innovations de plus en plus utilisées. Ainsi, en comparant les constructions architecturales du XVIIIe avec de plus anciennes, nous nous rendons compte des évolutions des objets d’attention. A partir de 1730 s’opère un changement au niveau de l’intimité dans les grands hôtels parisiens, les chambres d’apparats se distinguent des chambres privées car l’objectif nouveau est d’échapper aux regards pour entretenir une intimité avec soi-même. Une complexification des pratiques de propreté a lieu. On commence à insister sur la propreté des corps féminins. De nouveaux espaces sont imaginés et aménagés. Des meubles apparaissent comme le bidet chez les bourgeois qui devient courant à partir des années 1780 et la cuvette qui devient un instrument de propreté assez répandu à la fin du siècle. Du côté des artifices, une distance s’installe avec eux, la poudre devient symbole de mollesse, la respiration des pores du visage est préférée pour favoriser leur propreté. Le parfum qui autrefois avait la capacité de laver et de purger les odeurs, est désormais perçut comme un masque trompeur des odeurs nauséabondes. La propreté n’est ainsi plus faite seulement pour les regards, elle renforce les corps en les décrassant. Dans le dernier tiers du XVIIIe siècle par ailleurs, une politique d’organisation sanitaire des collectifs est doucement entamée : on veut supprimer l’insalubre des centres urbains. Les cimetières devenus intolérables sont déplacés en périphérie. L’objectif est d’aérer les villes pour les rendre plus saines, et d’abord Paris. L’espace urbain parisien est alors remodelé dans les années 1780. Une réforme des hôpitaux est menée, elle est dominée par des principes d’aération, de lavage des linges, d’individualisation des lits et d’évacuation des déchets. La consommation d’eau devient une question de stratégie collective, il faut créer des réseaux pour irriguer la ville car l’eau est censée laver et nettoyer des odeurs par son simple mouvement.
Enfin la quatrième partie de l’ouvrage met en évidence le récent changement de statut de l’eau qui s’opère au XIXe siècle : l’eau devient protectrice. La ville de paris est unifiée par les flux souterrains des constructions haussmanniennes et sa gestion en réseau relève de l’affaire publique. Vers le milieu du XIXe siècle, l’eau est perçue comme garante d’un ordre moral et la propreté avec, elle est un gage d’ordre et de décence. C’est un exemple concret des enjeux sociaux rattachés au développement de l’hygiène. Dans les écoles primaires, on s’attache à combattre les grossièretés des élèves en obligeant le lavage régulier des mains et du visage. Une fracture se crée dans les imaginaires entre l’hygiène des villes et la rusticité paysanne, cette dernière est dénoncée par les urbains car elle est associée aux mauvaises mœurs. Une réelle rupture s’envisage avec les découvertes pastoriennes au sujet de l’univers bactériologique. Les représentations sont transformées par une science en questionnement. L’eau efface les microbes, le travail sur l’invisible devient l’objectif principal du lavage. Les repères sont bouleversés car la perception ne peut plus à elle seule détecter les saletés. A partir de ces prises de consciences, les exigences vont s’accroitre très rapidement et ne pas trouver vraiment de limites. Les découvertes pastoriennes diffusent une véritable force émotionnelle. Devenue une condition au maintien de la santé, la propreté assure un double rôle : éloigner les microbes et renforcer les résistances à leur égard. L’hygiène est d’ailleurs devenue une nécessité dans les consciences, les discours médicaux alarment et exagèrent pour convaincre les masses d’adhérer aux nouvelles normes hygiénistes. A la fin du XIXe siècle, l’intimité franchie un seuil qui la rapproche grandement de son statut actuel. A cette image les cabinets de toilette sont devenus des espaces rigoureusement privés. La propreté commence à être fortement associée à cet espace, les objets inédits rendent encore plus spécial ce lieu. Ainsi, des objets fonctionnels sont inventés pour individualiser la toilette et ne plus dépendre des domestiques. Les objets se répondent et se complètent pour faciliter les étapes de la toilette. Les innovations techniques sont alors la preuve d’un déplacement des exigences et des points d’attention. L’emplacement cellulaire des douches est un exemple de ces innovations : il se développe à la même période à l’origine dans les prisons et les locaux des armées pour répondre à un besoin d’ordre et d’efficacité, il va bientôt se généraliser. Les temps de douches sont rationalisés et la position du corps relevé plutôt qu’allongé facilite le lavage car elle empêche les rêveries. Il montre ici comment les évolutions des pratiques du lavage révèlent dans leurs trajets historiques les changements majeurs culturels de nos sociétés.
Appréciation
Le récit que nous livre Georges Vigarello est très intéressant du point de vue du renouvellement des objets d’étude. En effet, au côté d’historiens comme Alain Corbin par exemple, l’auteur a poursuivi le renouvellement des champs historiographiques en s’intéressant à des objets jusque-là peu étudiés. Il a quitté les sentiers battus de l’historiographie traditionnelle en s’intéressant aux hommes, mais surtout à leurs mœurs et à leurs sensibilités. Il écrit une histoire ciblée remplie d’anecdotes qui se préoccupe en premier du rapport des corps à l’eau, au détriment parfois d’autres aspects de la propreté. Ce récit permet de se rendre compte de l’importance d’une classe influente dans les mœurs et dans leur codification : la noblesse de la cour puis, à partir du XIXe siècle, la bourgeoisie émergente. L’historien étudie les transformations des imaginaires de l’hygiène principalement à travers le point de vue de ces populations car ce sont elles qui reflètent les tendances globales, elles les initient et les généralisent. Mais il ne s’agit jamais d’une histoire personnifiée, ni même très datée puisqu‘il s’agit de pratiques globales et étendues sur un temps long. On se rend compte dans la même idée que le chercheur parle beaucoup de Paris alors qu’il prétend restituer une histoire des Français. On prend alors conscience que la centralisation est forte, pas seulement dans les domaines politique et économique, mais aussi dans le champ des pratiques culturelles : les Parisiens suffisent à rendre compte des pratiques du pays. Il ne s’agit pas pour autant d’une histoire par le haut, mais malgré lui, l’historien doit travailler avec des sources portant le point de vue des élites, par manque de sources révélant une vision plus populaire. Seuls les inventaires après décès et les recensements qu’il analyse parfois peuvent rendre compte des pratiques d’un public plus large. Il manquerait peut être pour donner plus de critique et de recul à son propos des parallèles avec des pratiques dans d’autres régions du monde au même moment. Il s’agit en effet exclusivement des Français, jamais nous ne parlons même des voisins européens. Il y aurait pourtant peut être des influences extérieures à mentionner ou bien des traces d’influence des pratiques françaises dans d’autres cultures. L’approche chronologique choisie par l’auteur, quant à elle, bien que discrète, est assez agréable puisqu’on se rapproche au fur et à mesure de nos pratiques contemporaines. On compare sans cesse les anciennes sensibilités et comportements aux nôtres et, pour cela, G. Vigarello ne nous guide pas, il nous laisse établir les rapports et nous faire nous-mêmes les historiens. D’ailleurs son choix de n’accompagner son écrit d’aucun document, ni cartes, ni chiffres, ni lexique se comprend aisément puisqu’il s’agit d’un objet d’étude assez proche du quotidien des lecteurs, un objet familier qui ne demande pas vraiment de mise à niveau. C’est en cela une histoire accessible à tous, précise et encore en construction. Cet ouvrage nous permet de nous rendre compte que nos pratiques corporelles qui nous apparaissent comme innées ou issues d’une tradition éternelle, ne sont que les fruits d’une longue construction qui ne fut jamais évidente.