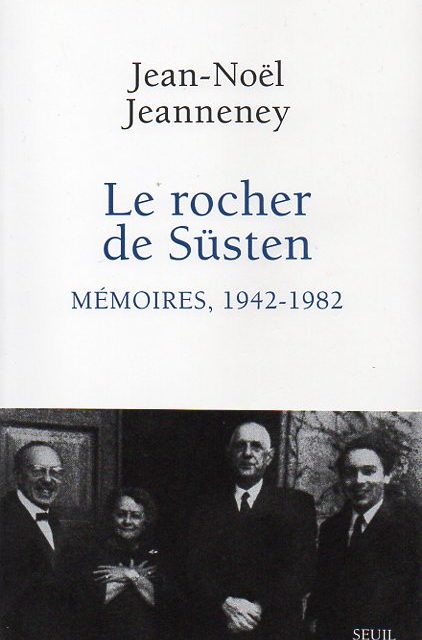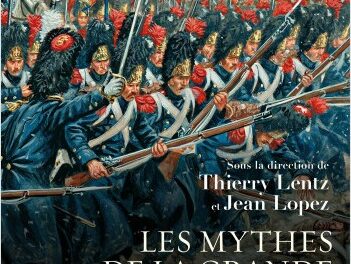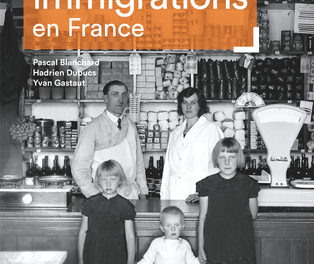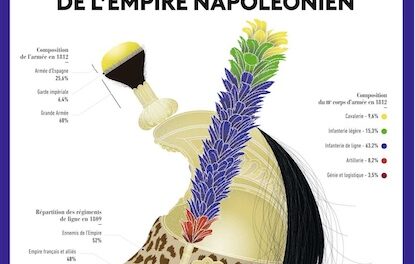Professeur émérite à Sciences Po, historien engagé et homme politique, Jean-Noël Jeanneney est assez connu et reconnu pour que sa présentation puisse se limiter aux quelques lignes de la 4e de couverture. Il a été président de Radio France et de Radio France internationale, maître d’œuvre du Bicentenaire de la Révolution française, membre de deux gouvernements de François Mitterrand, président de la Bibliothèque nationale de France. Il préside le conseil scientifique des Rendez-vous de l’histoire de Blois et il produit chaque samedi sur France Culture l’émission « Concordance des temps ».
Il publie aujourd’hui au Seuil (qui édita son premier ouvrage en 1969) le premier tome de ses Mémoires, consacré aux quarante premières années de sa vie, celles de la formation, de la fréquentation des cercles du pouvoir dans lesquels l’introduit son père, de la découverte du monde et de nombre de ceux qui font ou ont fait l’histoire, du choix de devenir historien et d’enseigner l’histoire, mais aussi de celui de s’engager dans une carrière publique et d’influer sur le cours de l’histoire.
13 chapitres, qui suivent la chronologie mais ont tous un thème central, structurent les 400 pages d’un texte qui aspire de toute évidence à la littérature. L’auteur a pris des notes tout au long de sa vie, ce qui lui évite les pièges et les facilités de la reconstruction ainsi que les distorsions de la mémoire, et lui permet des descriptions d’une étonnante précision. Une impressionnante galerie de portraits se découvre au fil des chapitres, révélant un réel talent littéraire pour ce type d’exercice.
De la contingence dans le destin des hommes
Il ne s’agit pas d’un ouvrage sur les Alpes suisses mais bien des Mémoires de J.-N. Jeanneney. Curieux (mais joli) titre pour des Mémoires. De retour d’un voyage en Grèce avec des amis (« initiation opportune pour les jeunes gens favorisés par le sort »), J.-N. Jeanneney et deux amis descendaient dans une 2CV les pentes du col du Süsten un soir pluvieux d’août 1960, quand un pan de la montagne s’effondra, écrasant la voiture qui roulait quelques mètres devant eux, tuant une famille de cinq personnes. Il s’en était fallu de quelques secondes que ce fut la leur.
Nous avions souligné dans le compte-rendu d’un de ses précédents ouvrages Un attentat : Petit-Clamart, 22 août 1962 l’intérêt de l’auteur pour une réflexion sur « la part de la contingence dans le destin des hommes ». Si cette réflexion est naturelle à l’historien, il estime qu’« elle vaut aussi bien pour son propre itinéraire ». Il raconte donc dès la première page comment il frôla la mort le soir du 7 août 1960 et annonce qu’il va montrer en rédigeant ses Mémoires que « les choix de liberté » ont largement leur place face au déterminisme dans ce qu’il fit de sa vie, même s’il reconnait d’emblée les « atouts hérités », la « protection et la stimulation d’un milieu ».
Ces « choix de liberté » seront ceux des classes préparatoires et non de la Faculté de Droit, de Normale Sup et non de l’ENA, de l’Histoire et non de la philosophie, de Sciences Po et non de la seule Université, de l’engagement mais sans encartement, du gaullisme mais pas du pompidolisme ni du giscardisme, de François Mitterrand, de la recherche de très hautes responsabilités quand de plus modestes eussent été apparemment plus sûres (nous sommes alors à la toute fin de l’ouvrage dans les arcanes du processus de décision qui conduit à sa nomination à la tête de Radio France).
La protection et la stimulation d’un milieu
Dans l’ascendance de J.-N. Jeanneney, on trouve les Monod du côté maternel, présents « dans les professions médicales et juridiques, et plus encore dans les temples huguenots ». Du côté paternel la famille s’inscrit dans « la tradition d’une bourgeoisie passionnément républicaine ». Le grand-père, Jules Jeanneney, « fruit de la méritocratie républicaine », fut avocat, député élu contre un nationaliste au temps du Bloc des gauches, puis président du Sénat de 1932 à 1940. Le père, Jean-Marcel Jeanneney (1910-2010), qui enseignait depuis 1937 l’économie politique à la faculté de droit de Grenoble, fut nommé à Paris en 1952, faisant de Jean-Noël un Parisien, amoureux de sa ville et du quartier latin plus particulièrement.
En 1944 De Gaulle fit entrer Jules Jeanneney dans son gouvernement comme ministre d’Etat, numéro deux, symbole de la transition républicaine. Jean-Marcel devient alors son directeur de cabinet. Avec le retour du général de Gaulle au pouvoir, il entra au gouvernement. Il fut ministre dans les gouvernements Debré et Pompidou, d’abord de l’Industrie et du Commerce de 1959 à 1962, puis des Affaires sociales de 1966 à 1969.
« Enfant tardif d’un père prestigieux », Jean-Marcel Jeanneney « avait eu avec celui-ci une relation de dépendance morale et affective. Il organisa au contraire entre son fils et lui « un système précieux, celui de la différence ». « Mon père associa souvent se enfants, et son fils aîné (Jean-Noël a cinq sœurs et un frère) au premier chef, aux rencontres qu’il organisait ». Jean-Noël Jeanneney accède donc très tôt aux cercles du pouvoir et fréquente quasi quotidiennement les milieux gouvernementaux. Il appréhende très jeune « le poids précoce de la politique : comme curiosité, comme atout, comme séduction, comme leçon ».
Jean-Noël Jeanneney, un observateur au cœur du pouvoir
Ce milieu familial, profondément politique, permit à l’auteur d’être très tôt situé à un poste d’observation exceptionnel, au cœur du pouvoir, et d’avoir un accès facilité à nombre de personnalités, à divers réseaux dans lesquels il était naturellement inscrit. Alors qu’il choisit de devenir historien, il est depuis son enfance en position d’observer l’histoire en train de se faire.
Il a 16 ans en 1958 et prend déjà des notes sur les événements qui vont permettre le retour du général de Gaulle au pouvoir. Deux mois avant le 13 mai il écrit « J’espère ardemment le retour au pouvoir du général de Gaulle ». L’atmosphère familiale est empreinte d’une « double fidélité, à la gauche républicaine et à la personne du Général ». Durant les dix ans pendant lesquels son père est ministre, il suit de près son action, assiste souvent aux réunions de travail au ministère de l’Industrie, alors que Raymond Barre est le chef de cabinet du ministre. Il vit de l’intérieur le putsch des généraux en 1961 alors que son père se trouve en Algérie et que, pendant quelques heures, on le croit prisonnier.
Peu après l’indépendance de l’Algérie, Jean-Marcel Jeanneney est nommé par de Gaulle premier ambassadeur de France dans l’Algérie nouvelle. Son fils le rejoint à deux reprises entre septembre et décembre 1962. Il est autorisé à assister, au fond de la salle, aux réunions de l’équipe qui entoure l’ambassadeur. Il assiste à l’investiture de Ben Bella le 29 septembre 1962 et nous en livre un récit vivant et précis. Il assiste encore au déjeuner donné par le président Ben Bella, en présence du colonel Boumediene. Il engage la conversation avec Ben Bella, l’interroge sur Kennedy et sur Castro.
C’est encore le réseau des amitiés familiales qui lui permet de passer six semaines à Rome, lors des deux dernières sessions du concile Vatican II, « dans un poste d’observation rare, l’ambassade de France auprès du Saint-Siège ». Il consacre à cette expérience son 5ème chapitre, « Un mécréant au concile ». Il a 23 ans, n’est ni chrétien ni croyant, et porte sur le clergé catholique un regard sans concession (quand il observe par exemple que les prélats français « ni intellectuels, ni théologiens (…) ont un prestige intellectuel, dans l’ensemble, limité », non dénué d’humour quand il analyse par exemple les diverses façons de porter la soutane.
En 1966, il apprend que la Fondation Singer-Polignac accorde à quatre « jeunes gens, notamment issus des grandes écoles », une bourse généreuse permettant de faire un tour du monde en un an. « Je me portai candidat et fut agréé sans concurrence. ». Il part pour cinq mois en Asie : Japon, Chine en pleine révolution culturelle, Indonésie où Sukarno vient de prendre le pouvoir, Vietnam où les Américains s’engagent profondément dans la guerre, Laos, Cambodge.
Partout, avec l’appui logistique du personnel des ambassades françaises, il voyage, découvre, interroge, rencontre de nombreux hauts responsables de divers milieux sociaux et politiques. C’est ensuite le départ pour les Etats-Unis, qu’il traverse en voiture avec un ami, de Boston à Los-Angeles, en passant par La Nouvelle-Orléans, le Texas et Santa Fe. Il est frappé par l’hostilité générale à De Gaulle, suite au discours de Phnom Penh et au retrait des troupes françaises de l’OTAN.
Il vit Mai 1968 alors qu’il effectue son service militaire (à Paris dans un Centre de prospective et d’évaluation). Autorisé à circuler en civil, c’est en observateur qu’il se rend au quartier latin insurgé. C’est en observateur aussi qu’il vit la crise du pouvoir gaulliste, à proximité de son père, ministre des Affaires sociales. « Ces informations immédiates me donnèrent le sentiment de vivre ces événements en partie double, entre le climat de la rue et l’ambiance, presque aussi heurtée, des cercles gouvernementaux. »
Le 14 mai il est à l’Assemblée pour y écouter le discours « clair mais plat » de Pompidou, et deux jours plus tard pour suivre le débat de la motion de censure où le discours de Pisani « fut impressionnant » Il ne parvient pas à se glisser dans la salle où se discutent les Accord de Grenelle, mais il « recueille à chaud les impressions de (son) père lors des deux déjeuners suivants ». Il observe encore la manifestation du 30 mai après le discours de De Gaulle et en livre une description sans complaisance : « Trop de manteaux de loden et de foulards Hermès. Des îlots de mondanité incongrue (…) Certains cris de haine envers la gauche soulevaient le cœur ».
Jean-Marcel Jeanneney a refusé d’entrer dans un gouvernement sous la présidence de Pompidou. Il restera à distance du giscardisme et appellera à voter Mitterrand. Il sera « sherpa » de Mitterrand pour le premier sommet du G7. Il fut est l’un des quatre ministres que De Gaulle invita à La Boisserie après qu’il ait quitté le pouvoir, signe de l’affection qu’il lui portait. Le 30 décembre 1969, Jean-Noël accompagne ses parents à Colombey, où ils passent la journée entière. Le chapitre 9 qui raconte cette journée est un des sommets du livre. Les descriptions sont d’une étonnante précision, le récit attachant. Laissons au lecteur le soin de le découvrir. L’auteur éprouve la mort du général de Gaulle « comme une douleur personnelle ». Il était à Colombey le 12 novembre.
Jeanneney, le choix de l’histoire
Jean-Noël Jeanneney consacre deux chapitres à sa formation et à ses études, et deux autres au renouveau de l’histoire politique dans lequel s’inscrivent ses recherches pour la réalisation de sa thèse, ainsi que sa nomination à l’université de Nanterre et à Sciences Po. Après une scolarité secondaire de bon élève au lycée Louis-le-Grand, il entre en classe préparatoire littéraire. « J’aimai l’hypokhâgne et la khâgne. Dès que je fus sur ces bancs, je ne doutai pas de l’opportunité de ma décision. Une certitude s’imposait à moi désormais : je me voulais universitaire, assuré que jamais ma liberté de réflexion et de refus, quelles que dussent être les échappées que je ferai au dehors, ne serait soumise à aucune hiérarchie, à aucune dépendance ».
Admis à l’Ecole normale supérieure, il hésite peu de temps sur le choix de la filière : ce sera l’histoire et non la philosophie. Parallèlement, il s’inscrit à Sciences Po. Ce sont cinq années de bonheur, quatre jusqu’au succès à l’agrégation, une année supplémentaire offerte. Il apprécie « la miraculeuse liberté » que procure la situation de normalien, qui cependant ne le détourne pas de « travailler beaucoup ». Diplômé de Sciences Po dans la section dite du « service public », il est « résolu à ne pas entrer à l’ENA ».
C’est en rédigeant son mémoire de maîtrise qu’il découvre le plaisir de la recherche. Sous la direction de Pierre Renouvin, il étudie l’opinion durant la Grande guerre à travers l’analyse des archives des commissions du contrôle postal. Les grandes porte de la carrière lui sont ouvertes très vite : dès la rentrée 1968, avant même la fin de son service militaire, il obtient -par l’intervention de René Rémond- qu’une conférence lui soit confiée à Sciences Po, en « année préparatoire ». Un an plus tard René Rémond appuie sa nomination comme assistant à Nanterre : il a 27 ans.
Nanterre, qui n’est pas un havre de paix, et Sciences Po sont alors dominées par la personnalité de René Rémond. Ce qui fut parfois appelé la « rémondie », rassemble alors bon nombre d’historiens, Jean-Noël Jeanneney, René Girault, Philippe Vigier, Jean-Jacques Becker, Serge Berstein, Jean-Pierre Rioux, Jean-Pierre Azéma, Pierre Milza, Jean-François Sirinelli, Michel Winock , Antoine Prost, qui sont acteurs d’un renouveau de l’histoire politique et de la biographie. C’est René Rémond qui dirige la « thèse de troisième cycle » de Jean-Noël Jeanneney, consacrée à une édition critique du Journal politique de Jules Jeanneney entre 1939 et 1942 et soutenue en 1970.
« Au cœur d’une histoire politique renouvelée je voulais braquer mon attention sur les forces qui pesaient du dehors sur les décisions dans le monde politique : au premier rang de ces puissances, l’argent des affaires d’un côté et de l’autre le monde multiforme des médias. » Intervient alors le hasard qui lui fait apprendre l’existence du Journal alors inconnu, tenu par le maître de forges François de Wendel. Travailler sur un tel sujet serait « au centre du champ que je souhaitais explorer ». Il parvient à convaincre la fille aînée du maitre de forges qui lui confie le journal dont « l’intérêt me parut éclatant ». Travaillant à sa thèse de doctorat d’Etat, il apprécie « le bonheur brut de la recherche historique » et affirme qu’il existe « une sorte d’ébriété de la liberté dans le traitement d’un sujet d’histoire ».
La soutenance a lieu à Nanterre en 1975. « Je démontrais que l’action de Wendel s’était organisée autour de deux objectifs constants : au-dedans la conservation d’un ordre social et d’une rigueur financière, au-dehors une politique de fermeté et de méfiance indéfectible envers l’Allemagne. » Il fait la part des mythes et des représentations et démontre l’influence réelle de Wendel, aussi régent de la Banque de France, contre le Cartel des gauches. Il précisera ce rôle dans un livre publié deux ans plus tard au Seuil, La faillite du Cartel 1924-1926, sous-titré Leçon d’histoire pour une gauche au pouvoir, réédité en 1982, après que la gauche soit revenue au pouvoir après 23 ans d’opposition.
Galerie de portraits
Il reste à dire que le lecteur traversera, au long des 400 pages de l’ouvrage, une longue galerie de portraits. On aura compris que les occasions furent nombreuses pour l’auteur de rencontrer des hommes politiques, des dirigeants en activité ou en ayant cessé de l’être. Souvent il les a sollicités et a fait l’effort de rencontres inattendues. Chaque portrait est l’objet d’une grande attention, à la fois dans la description du personnage et dans le contenu des échanges, mais aussi dans la recherche qui préside à l’écriture.
L’empathie est bien souvent présente, mais les coups de griffe ne sont pas absents. Attendez- vous donc à rencontrer, sans vouloir être exhaustif : Edgar Faure, Raymond Barre, André Malraux, Edgar Pisani, Charles et Yvonne de Gaulle, François Mitterrand, Michel Rocard, Edmond Maire, Jacques Chérèque, mais aussi Hubert Beuve-Méry, Raymond Aron, Jean Daniélou, Jean Guitton, Paul Morand, Emmanuel Berl, Bertrand de Jouvenel, Alexis Leger, plus étonnant peut-être Georges Albertini, David Ben Gourion ou Alexandre Kerenski.