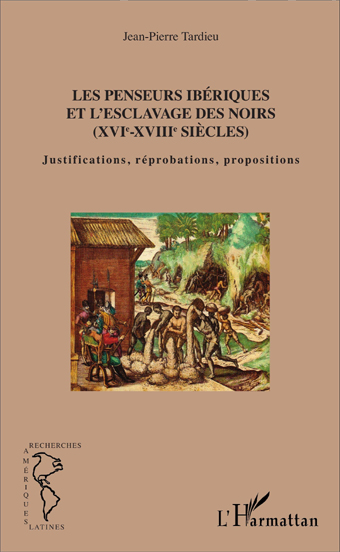
Parmi ces penseurs, les membres du clergé se taillent bien entendu la part du lion. La lecture de leurs ouvrages permet d’établir une gamme de réflexions qui vont de la justification religieuse et économique de l’esclavage à sa condamnation pure et simple. Ceux qui le justifient puisent une grande partie de leur argumentation dans les écrits d’Aristote, d’Augustin d’Hippone ou et du thomisme : ainsi, « inférieur de nature pour Aristote, l’esclave le devient sous l’empire du péché pour le chrétien » (p. 19). On s’appuie aussi sur les Siete Partidas codifiées au XIIIè siècle sous le règne d’Alphonse X, un texte fondamental, hérité des pratiques de l’Antiquité romaine, qui régit les relations entre maîtres et esclaves en Castille, mais aussi, au prix d’aménagements favorables aux maîtres, dans les possessions ultramarines de celle-ci. D’après cette législation, si l’esclavage est le résultat de conventions sociales, car la nature n’établit pas de distinction entre esclave et homme libre, il n’en réduit pas pour autant la victime à l’état d’objet : de ce fait, un propriétaire n’a théoriquement pas le droit de mettre son esclave à mort ni de s’opposer à son mariage.
C’est dans l’aire lusitanienne, très logiquement, qu’on trouve, entre le milieu du XVe (Eanes Gomes de Zurara) et le milieu du XVIè siècle (João de Barros) les premières justifications religieuses de l’esclavage des Noirs d’Afrique, par la mobilisation de la doctrine de la guerre juste et du motif de la nécessaire évangélisation. Le propos est repris par des auteurs hispaniques : l’un des plus caricaturaux est le fait de Francisco de Auncibay, auditeur auprès de l’Audience royale de Quito, qui, en 1592, présente l’esclavage comme un bien dans la mesure où il propose le salut à ses victimes. D’autres, tout en admettant parfois la licéité des traites, sont plus critiques sur la justification par l’évangélisation : ainsi, en 1562, Domingo de Soto, professeur à Salamanque, considère, en bonne théologie chrétienne, que la conversion d’un esclave n’est pas valide si ce dernier n’a pas librement accepté l’enseignement chrétien ; quant à Bartolomé Frias de Albornoz, ancien professeur à l’université de Mexico, il se demande en 1573 pourquoi on n’évangéliserait pas les populations sur place au lieu de leur infliger le passage par l’esclavage. Cet aspect sera théorisé en 1686 par la mission des capucins de Guinée dans un long mémoire adressé au roi du Portugal.
La question de l’évangélisation des esclaves est en effet très présente dans les écrits : Alonso de Sandoval, qui, en 1627, met en forme la pastorale des Noirs (« ministerio de negros ») dans le port de Carthagène des Indes, ne condamne pas la traite de façon globale et considère fondamentalement que l’esclave, devenu chrétien, doit respecter son maître, même s’il est mauvais : « En rétribution de leurs tourments, ils […] seront récompensés du bien qu’ils auront fait, car Dieu ne les oubliera pas […] » (p. 151). Cette théologie de la résignation est reprise au Brésil, dans la seconde moitié du XVIIè siècle, par le père Vieira pour qui l’esclavage, malgré le fait qu’il soit un mal, permet néanmoins aux Noirs de mériter leur salut : « La liberté de l’âme ne vaut-elle pas l’esclavage du corps ? » (p. 157).
Si certains jugent la traite et l’esclavage moralement condamnables, ils ne les estiment pas moins, comme le jésuite Diego de Avendaño, justifiés d’un point de vue économique : en effet, « les esclaves sont nécessaires à l’existence même des Indes » (p. 131). Cette argumentation est récurrente : un propriétaire cubain du XIXè siècle n’affirme-t-il pas que l’esclavage est un système détestable : « Mais comment le supprimer sans ruiner le pays ? » (p. 231).
Ces positions « pragmatistes » ou « réalistes » ne sont au contraire pas partagées par des personnalités, relativement isolées, comme l’archevêque de Mexico Alonso de Montufar qui, en 1560, dans une lettre adressée au roi Philippe II estime que l’esclavage des Noirs n’est pas plus justifié que celui des Indiens, ou le jésuite du Brésil Gonçalo Leite qui, en 1586, dénonce si violemment la connivence de son ordre avec le système esclavagiste qu’il est rappelé au Portugal.
Ce sont sans doute les capucins qui sont allés le plus loin dans la dénonciation du système : dans les années 1680, les frères Francisco José de Jaca et Epifanio de Moirans, en mission à Cuba, somment les propriétaires de libérer leurs esclaves car leur condition n’est pas légale à leurs yeux et de restituer le fruit de leur travail, sous peine d’être privés de l’absolution. Représentant une menace pour l’ordre établi, ils sont renvoyés en Espagne et enfermés dans un couvent à Cadix. Là, ils publient de violentes charges contre l’esclavage (la liberté de l’homme n’a pas de prix) et ceux qui soutiennent et profitent de l’institution, à commencer par de nombreux religieux, dont les jésuites.
La charge du capucin Jaca en particulier émeut le roi d’Espagne Charles II qui, dès 1681, s’est préoccupé du problème de la licéité de l’esclavage. Souhaitant « tranquilliser sa conscience » (p. 189), il consulte le Conseil des Indes : celui-ci, cela n’étonnera personne, met alors en garde le roi contre ces capucins qu’il faut dissuader de retourner aux Indes et contre une éventuelle suppression de l’esclavage qui causerait la ruine économique de l’empire ; mais il rassure le roi sur sa licéité, « prouvée » selon lui par maints penseurs, et lui rappelle combien l’esclavage contribue à faire progresser la foi catholique.
Ultérieurement, après l’abolition en 1817 de la traite par l’Espagne, le roi Ferdinand VII reprend les poncifs de la justification religieuse et économique jusqu’à considérer l’esclavage comme un « incomparable bénéfice » pour ses victimes…
Au cours de l’ouvrage, Jean-Pierre Tardieu en vient à évoquer la position de Bartolomé de Las Casas et celle de la papauté. Un chapitre très copieux est consacré à Las Casas : l’auteur, à la suite de nombreux historiens, nuance, sans la nier, la responsabilité de Las Casas dans le développement de la traite des Noirs et pointe son repentir, tardif, et son constat, amer, selon lequel « la déportation de cent mille Africains aux îles ne changea rien au sort des Indiens » (p. 83). Il s’attache ensuite à rappeler que si Las Casas finit par condamner la traite, il ne remet pas en cause l’esclavage traditionnel, car il l’estime être le « châtiment du péché », fidèle en cela à l’héritage aristotélicien du thomisme. Par ailleurs, si Las Casas est considéré comme « l’apôtre des Indiens », il est excessif, au prétexte de sa condamnation tardive de l’esclavage des Noirs, de voir en lui « l’apôtre des Noirs ».
Quant à la position de la papauté sur la traite et l’esclavage, Jean-Pierre Tardieu, après un examen minutieux de quelques bulles et brefs pontificaux, considère, à rebours de certaines analyses historiennes jugées trop iréniques, qu’ « il ne fut jamais question pour l’Eglise de condamner la traite des Noirs » (p. 201). Le bref Pastor bonus de Pie II (1462) « ne condamne pas l’esclavage mais […] se limite à imposer des peines canoniques à ceux qui réduisent en esclavage les noirs convertis ou sur le point de se convertir » (p. 55). Quant à Paul III, après avoir publié un bref condamnant la pratique de l’esclavage des Indiens et menaçant d’excommunication en cas d’infraction, il étend, par sa bulle Veritas ipsa
(1537), la condamnation à l’esclavage de tous les hommes. Malgré ces avancées, en théorie, les textes ne pouvaient guère, selon Jean-Pierre Tardieu, avoir de portée pratique dans le contexte de l’époque.
Ce bref passage en revue laisse deviner la richesse d’un ouvrage qui donne accès à de nombreuses analyses souvent méconnues. On appréciera particulièrement que l’auteur donne de larges extraits dans le texte (latin, portugais, espagnol) accompagnés de leur traduction. L’ouvrage comble une lacune en contribuant largement à vulgariser un champ de recherches d’ordinaire peu accessible au lectorat francophone.
Compte rendu par Philippe Retailleau, La Réunion













