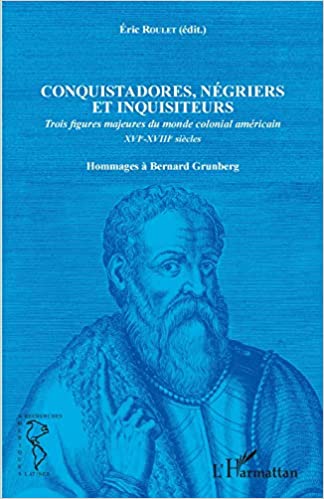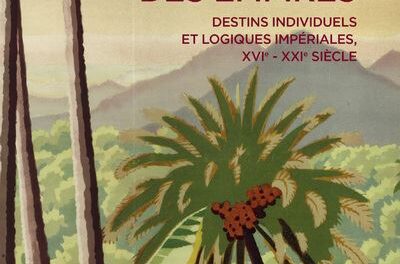Eminent spécialiste du monde colonial américain, en particulier de la conquête du Mexique et des premières décennies de la vice-royauté de Nouvelle-Espagne, le professeur Bernard Grunberg a pris sa retraite de l’université de Reims-Champagne-Ardenne (URCA) en 2016. Comme le veut la tradition, ses amis, collègues et anciens étudiants lui ont offert ce volume de mélanges dont l’édition a été confiée à Eric Roulet, excellent historien du Mexique et des Antilles à l’époque moderne, dont on a pu lire récemment une copieuse, mais remarquable, histoire de la Compagnie des Iles de l’Amérique. Des trois grandes figures collectives qui scandent l’oeuvre de Bernard Grunberg émerge celle des conquistadores qui ont donné lieu à deux livres devenus des références, L’Univers des conquistadores. Les hommes et leur conquête dans le Mexique du XVIe siècle et le Dictionnaire des conquistadores de Mexico, édités chez L’Harmattan, respectivement en 1993 et 2001. Bernard Grunberg a également animé pendant de nombreuses années un fameux Séminaire d’histoire de l’Amérique coloniale qui s’est intéressé à divers sujets, comme les villes, l’esclavage ou les élites en Amérique coloniale, et il chapeaute en ce moment un projet d’édition du Corpus antillais, collection de sources sur les Indiens caraïbes (dont nous avons recensé l’un des volumes consacrés aux missionnaires dominicains).
L’ouvrage dont il est question ici est formé de 28 contributions distribuées en quatre parties : les trois premières sont consacrées aux figures collectives qui donnent leur titre au volume (les conquistadores, les négriers et les inquisiteurs), la dernière s’intéresse aux « écritures et réécritures de l’histoire de l’Amérique ».
Evoquons d’emblée la quatrième partie du livre pour nous concentrer ensuite sur les trois premières, qui déplient chacune des figures du titre. Dans cette section finale, assez hétéroclite, trois études ont retenu notre attention : celle de Guy Rozat Dupeyron qui exprime la nécessité d’une nouvelle approche de l’histoire de la Conquête du Mexique (pp. 369-382); la première traduction en français (pp. 327-341), par les soins de l’éminent Jean-Paul Duviols, du témoignage du Ligure Michele da Cuneo, un voyageur curieux et indépendant qui a accompagné Christophe Colomb lors de son second voyage et ne manque pas de montrer l’autoritarisme de l’Amiral et son absence de pitié…; enfin l’étude (sur laquelle nous reviendrons) de Pierre Ragon analysant « les lectures françaises de Bartolomé de Las Casas, de Jacques de Miggrode à l’abbé Grégoire » (pp. 353-368).
La première partie du livre, intitulée « Les conquistadores et leurs univers », se penche sur une figure collective particulièrement scrutée par Bernard Grunberg. Hernan Cortés est bien entendu évoqué, mais de manière originale, grâce à l’article de Nadine Béligand (pp. 89-105) qui rappelle que dans son testament, rédigé à Séville en 1547, Cortés avait indiqué son intention d’être enterré à Coyoacan, au Mexique. Placés après sa mort dans le mausolée des ducs de Medina Sidonia, à San Isidro del Campo, ses ossements furent confiés en 1566 à un homme de confiance qui fut chargé de les transférer au Mexique : arrivé dans un Mexique pris dans la tourmente de la conjuration de Martin Cortés, le fils du conquistador, l’homme fut arrêté et les restes de Cortés furent cachés au monastère de San Francisco de Tezcoco jusqu’à leur réapparition en 1629, lors des funérailles de Pedro Cortés, le petit-fils. Transférés en 1794 à l’église de l’Hospital de Jesus de Mexico, dans le monument funéraire alors édifié en son honneur, les restes du conquistador furent de nouveau mis à l’abri au moment de l’indépendance du Mexique pour éviter toute tentative de profanation. Ce n’est qu’en 1946 que fut dévoilé le lieu où on les avait entreposés. Lors du quatrième centenaire de la mort de Cortés, en 1947, aucune célébration ne fut toutefois organisée pour ne pas froisser le « parti indianophile » soutenant la figure concurrente de Cuauhtémoc, le dernier empereur mexicain dont on avait localisé le squelette à Ichcateopan, dans l’Etat du Guerrero… D’autres figures, souvent bien moins connues, de la conquête et de la colonisation sont abordées : on pointera ici l’étude de Jérôme Jue sur le protestant français Guillaume de Caën (pp. 53-64), tout à la fois armateur-négociant, capitaine de marine, devenu général de la flotte de la Nouvelle-France, titulaire du monopole de la traite en Nouvelle-France, puis seigneur-propriétaire aux Antilles au cours du premier XVIIè siècle. Quand Richelieu évince les protestants de la Nouvelle-France, Guillaume de Caën tombe et, malgré de nombreux procès, ne parvient pas à se relever financièrement.
Reconnaissance, considération, récompenses, compensations, financières ou autres : c’est ce à quoi aspirent bon nombre des praticiens de la conquête du Mexique. Beaucoup estiment en effet qu’ils n’ont pas été récompensés par la Couronne à la hauteur de leur participation et de leur exploit final; ils réclament en particulier des Indiens en encomiendas. Certains, comme le montre l’historienne mexicaine Maria del Carmen Martinez Martinez (pp. 65-74), sont prêts à traverser l’Atlantique pour produire et défendre leurs revendications devant la Cour, en Castille même.
L’institution de l’encomienda, qui constitue la toile de fond de nombreuses études portant sur la Nouvelle-Espagne du XVIè siècle, est en particulier abordée par Karine Lefebvre, dans le cadre de la région d’Acambaro (pp. 75-88). Elle montre notamment que « de nombreuses familles de conquistadores sont parvenues à constituer de véritables empires agropastoraux, dès la fin du XVIè siècle et au début du XVIIè siècle » (p. 87) dont la plupart sont à l’origine des premières haciendas. Toutefois, « un siècle après leur mise en place, la majeure partie des encomiendas est revenue à la couronne, et de nombreuses familles perdirent leur statut, à la fois politico-administratif et économique au profit d’une nouvelle classe ascendante, les commerçants. (p. 88)
Nous avons particulièrement apprécié la deuxième partie du livre, consacrée à la figure du négrier (« les négriers et l’économie atlantique ») que, pourtant, Bernard Grunberg n’a guère fouillée. On la rencontre au détour d’un fameux article que l’auteur avait consacré en 2004 à la révolte des « pièces d’Inde » transportées sur le navire L’Affricain en 1738. C’est d’ailleurs Sylvie Colfort qui, dans son article sur « la traite négrière à travers le regard de deux officiers nantais [Adam Joulin et Charles Le Breton] de la première moitié du XVIIIè siècle » (pp. 147-158), nous invite à faire la distinction entre la « pièce d’Inde » (capturée sur les côtes d’Afrique) et l’esclave (la « pièce d’Inde » acquérant la condition d’esclave une fois touché le sol du Nouveau Monde). Son article est un excellent poste d’observation des traites négrières à l’époque envisagée et une bonne mise au point sur les révoltes à bord des navires négriers.
Une étude n’honore pas complètement la promesse contenue dans son titre. Ainsi, Pieter Emmer (« The sailor as capitalist. The buccaneers and the investments in the first sugar plantations in the non-spanish Caribbean », pp. 135-146), après de longues pages sur le système de l’engagement, sur les pirates et les esclaves marrons, ne questionne les premiers investissements dans l’agriculture de plantation, qui auraient pu être le fait de boucaniers entre 1660 et 1700, que dans les quatre dernières pages…. L’auteur note alors que des recherches récentes semblent indiquer « that probably the buccaneers had invested a substantial part of their money in sugar plantations » (p. 144), à la Jamaïque notamment, passée en 1655 sous la coupe des Britanniques. On aurait aimé qu’il profite de cet article pour sortir du conditionnel et nous fournir, dès le début, une argumentation étayée par des exemples concrets.
Les contributions de Norma Angélica Castillo Palma (pp. 159-171) et d’Olivier Grenouilleau (pp. 173-185) permettent d’explorer la question sur son versant hispanique, en général assez méconnu. Dans son excellente étude du « vocabulaire de la traite négrière et de la contrebande d’esclaves en Nouvelle-Espagne aux XVIIè et XVIIIè siècles », Norma Angélica Castillo Palma fait ressortir le caractère assez massif de la contrebande. Pour compenser la mortalité attendue pendant la traversée vers les ports américains, en l’espèce Carthagène et Veracruz, seuls ports de Nouvelle-Espagne habilités au débarquement des « pièces d’Inde », la Couronne accordait une « demasia », c’est-à-dire un pourcentage (40%) de surcharge. Mais, en réalité, la surcharge des bateaux était souvent supérieure au double. Et la majeure partie de cette surcharge était constituée de bambos (les bébés d’à peine quelques mois qui dépendaient de leur mère pour leur survie et devaient être vendus avec leur mère) et de muleques (âgés de moins de 15 ou 16 ans, ils pouvaient être seuls ou séparés de leur mère). Jusqu’à ce qu’on décide de prendre en compte la taille, et non l’âge, pour fixer les droits dont ils devaient s’acquitter, les négriers étaient exemptés de taxe pour les muleques (et a fortiori les bambos). Quant à Olivier Grenouilleau, il note qu’en matière de traite, d’esclavage et d’abolition, l’Espagne se distingue des autres nations par trois traits : la faiblesse d’une traite spécifiquement espagnole; des débats assez précoces sur la légitimité de la traite et de l’esclavage; des contestations de la traite et de l’esclavage parmi les plus nettes et les plus précoces (l’auteur s’appuie en grande partie sur les travaux de Jean-Pierre Tardieu), mais également une abolition tardive (permise par la loi Moret de 1870 qui amorce un processus d’abolition graduelle de l’esclavage).
On peut mettre en relation l’article d’Olivier Grenouilleau avec celui de Pierre Ragon (voir supra) qui fait de la traduction en 1579 par Jacques de Miggrode de la Brevisima relacion de la destruccion de las Indias de Las Casas le point de départ d’une féconde tradition favorable à l’évêque du Chiapas, tradition dans laquelle s’inscrit l’oeuvre de Grégoire. Son Apologie de Barthélémy de Las Casas, évêque de Chiappa constitue un jalon important dans l’histoire de l’émancipation des Noirs. L’abbé Grégoire entend notamment démontrer que Las Casas n’était pas l’instigateur du commerce des Noirs à destination du Nouveau Monde et qu’il n’avait jamais proposé l’importation d’esclaves noirs en Amérique. Si la première proposition est facilement démontrée, la seconde est plus hasardeuse compte tenu des sources alors à sa disposition. On sait aujourd’hui que la présence d’esclaves noirs dans les Caraïbes était attestée plusieurs années avant que Las Casas ne fasse la proposition de les importer plus massivement et qu’il a longuement hésité à ce sujet. Or, à la fin du XVIIIè siècle, bien des écrits du dominicain n’avaient pas été publiés. La démonstration de Grégoire s’avérait donc à ce sujet assez périlleuse. In fine :
Faisant le pari difficile de défendre, dans un même texte, la cause des Lumières chrétiennes et celle des droits de l’homme, [Grégoire] crut trouver en Las Casas la figure idéale qui les rassemblait. Sans doute était-ce aller un peu vite en besogne. Las Casas, que l’on connaissait fort mal, évoluait dans un univers intellectuel qui était étranger aux hommes du XVIIIè siècle. Arc-bouté sur l’Evangile et la théorie juridique de la guerre juste, il était très loin de pouvoir concevoir celle des droits de l’homme. Enfin, militant plus que philosophe, il n’avait pas laissé un système achevé, mais les traces parfois contradictoires d’une pensée en perpétuelle évolution dont on ne connut bien longtemps que de rares épaves. Dans ces conditions, il était, avouons-le, bien difficile de s’y retrouver. (p. 368)
La deuxième partie s’achève sur un article très riche, fondé sur une récente enquête archivistique, rédigé par Mickaël Augeron et consacré à « un esclavage méconnu : les Amérindiens en France au XVIIIe siècle » (pp. 209-229). Avant le XVIIIè siècle, la présence d’Amérindiens sur le sol français est attestée, notamment pour le XVIè siècle : entre 1505 et 1615, on en dénombre 187 qui se concentrent essentiellement en Normandie et viennent majoritairement du Brésil. Mickaël Augeron a prolongé l’enquête pour prouver que le phénomène a perduré au-delà. Son travail nous semble bien plus original que celui qu’Eric Taladoire consacre, dans la troisième partie (curieusement…!), aux « Amérindiennes en Europe (1493-1616) » (pp. 307-317), qui arpente un terrain relativement bien défriché par les historiens, émet parfois des constats un peu trop généraux et ne mentionne quasiment que des personnalités assez connues comme la princesse péruvienne Francisca Pizarro Yupanqui, fille de F. Pizarro et d’Inès Huaylas (Quispe Cusi, fille de Huayna Capac) ou, surtout, la fameuse Pocahontas, fille du puissant chef Powhatan de Virginie, qui arrive à Londres en 1616 avec son époux John Rolfe…
Mickaël Augeron indique qu’il n’est pas toujours aisé d’identifier les Amérindiens dans les archives, car on les y qualifie en général de ‘Sauvage’ ou ‘Sauvagesse’ et parfois d’‘Indien’, de ‘Nègre’ ou ‘Négresse’. La centaine, au bas mot, d’Amérindiens identifiés à ce jour pour la période 1660-fin du XVIIIè siècle, est surtout constituée de domestiques, ayant pour la plupart un statut d’esclaves. La grande majorité de ces domestiques sont des prises de guerre, réalisées principalement en Amérique du Nord. L’édit de 1315 stipulant que tout esclave qui posait son pied sur le sol français devait être aussitôt affranchi n’est pas appliqué; il est même amendé par l’édit de 1716 qui autorise, sous certaines conditions, le séjour des esclaves en France. Les Amérindiens sont assimilés aux ‘Noirs, mulâtres et autres gens de couleur’ : on ne connaît donc d’eux que leur prénom et presque tous sont baptisés « catholiques ». Les maîtres ont l’obligation de déclarer leur départ des colonies comme leur arrivée en métropole, mais ils n’en font en général rien, si bien que la majorité d’entre eux entrent illégalement sur le sol français. Le gros, originaire aux trois-quarts de la Nouvelle-France (un afflux notable s’observe à la suite des défaites françaises en 1758-1760 qui voient les Anglais prendre respectivement les villes de Louisbourg, Québec puis Montréal), se concentre dans les anciennes provinces d’Aunis et Saintonge, principalement à La Rochelle. Suivent Rochefort et, dans une mesure bien moindre, Bordeaux. Quant à Nantes, elle accueille très peu d’esclaves amérindiens car la ville n’est guère impliquée dans le grand commerce canadien, privilégiant au contraire la traite des noirs et le commerce en droiture avec les Antilles. L’étude de M. Augeron constate en outre que la plupart des Amérindiens arrivés en France sont des enfants ou des adolescents, ce qui explique les espérances de vie globalement faibles, et que les unions mixtes sont très rares (une déclaration royale de 1738 interdit d’ailleurs le mariage des esclaves en métropole).
La figure de l‘inquisiteur est censée structurer la troisième partie (« les inquisiteurs face au monde indigène »). En fait, elle regroupe une série de contributions qui traitent surtout des religions indigènes au Mexique sous le regard des conquérants et des évangélisateurs : ces derniers méconnaissent la complexité de l’organisation sacerdotale de l’ancien Mexique (pp. 233-251); ils évoquent souvent les croyances et les rituels des populations du Mexique dans ce qu’ils ont de plus étonnant, voire d’étrange, comme le culte du dieu Tlalloc (pp. 253-264); ils traquent enfin l’idolâtrie. Eric Roulet (pp. 285-292) évoque ainsi un procès pour idolâtrie et concubinage intenté en 1540 par l’Inquisition apostolique mexicaine contre des villageois de Totolapa, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Mexico, révélateur à bien des égards de la vitalité de traditions indigènes réfractaires aux préceptes de la vie chrétienne. Analysant la Relacion du bachelier Juan de Balsalobre sur les pratiques réputées idolâtriques d’Indiens de l’Oaxaca au XVIIè siècle (pp. 293-306), Jacqueline de Durand-Forest constate tout à la fois le zèle et l’échec des premiers missionnaires à éradiquer les pratiques religieuses d’avant la conquête qui survivent à travers un « syncrétisme » qui rend souvent difficile et incertain le travail d’évangélisation. La figure de l’inquisiteur est sans doute plus sûrement traitée par Patrick Johansson dans son étude consacrée à « Hernando Ruiz de Alarcon, inquisiteur, humaniste et poète » (pp. 265-284), encore que le personnage, un curé réputé pour son zèle à poursuivre et châtier les Indiens « idolâtres », ne soit pas officiellement investi comme inquisiteur. L’originalité et l’intérêt de l’article de Patrick Johansson tiennent à ce que ce dernier entend prouver que sous l’ « inquisiteur » se cache un humaniste, ethnologue avant la lettre à sa manière :
En l’absence d’informations précises concernant la vie d’Hernando Ruiz de Alarcon, il est difficile de discerner les motivations profondes qui l’ont conduit à exercer avec zèle la fonction (usurpée) d’inquisiteur, à entreprendre une véritable croisade contre l’idolâtrie, à mener à bien un travail de connaissance de l’Autre, et à rédiger son Traité des superstitions. L’humanisme manifeste de l’approche du chercheur ainsi que la teneur anthropologique de l’œuvre semblent contredire le harcèlement tenace de l’inquisiteur. S’agit-il d’un machiavélisme cynique dont la fin religieuse aurait justifié des moyens culturels qui consistaient à faire revivre l’idolâtrie dans toute sa splendeur pour mieux la fustiger, la combattre, et la détruire? Ou est-ce l’oeuvre d’un homme qui se sentait attiré, pour ne pas dire séduit, par les mystères d’une grande civilisation et par des textes ésotériques dont il appréciait le langage exquis, les belles métaphores, et la grande valeur littéraire? (pp. 283-284)
Au total, ce volume est donc d’une grande richesse. Il permet d’aborder différentes dimensions de l’histoire des Amériques entre la fin du XVe et la fin du XVIIIe siècle et comporte quelques études qui peuvent avantageusement nourrir nos enseignements de collège et de lycée.