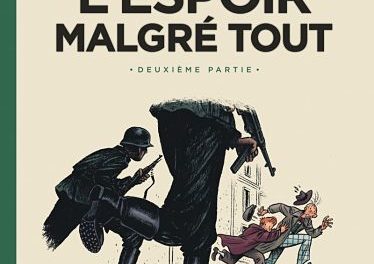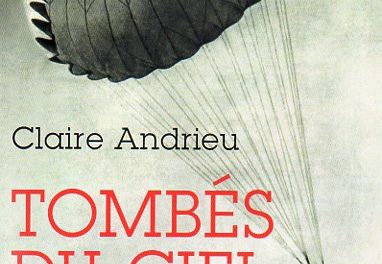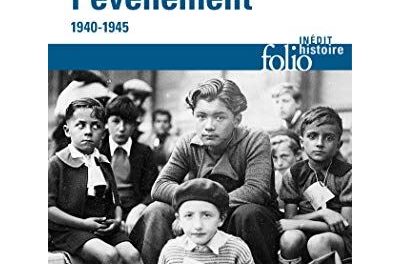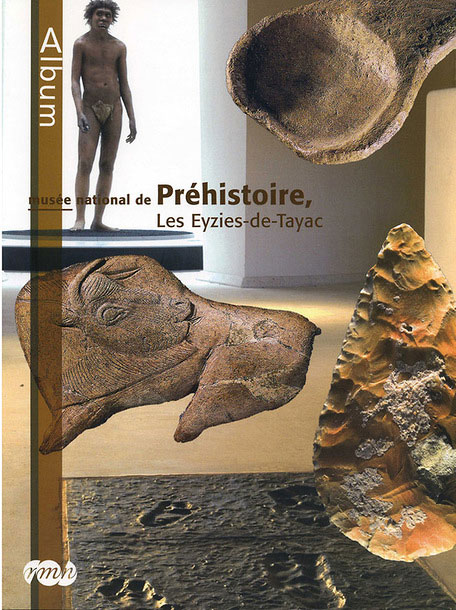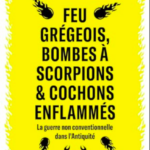L’idée d’un livre rapide sur les collaborateurs européens du nazisme n’est pas mauvaise, mais sa réalisation est ici entachée d’un grave défaut : les différents cas sont vus de façon superficielle, en condensant des sources inégales qui ne sont, de surcroît, pas indiquées. Dans le choix des détails, le pittoresque semble être le critère principal. Quant au nazisme, il est réduit comme trop souvent à une violence brute, dépourvue de toute finesse manœuvrière ; ce serait pourtant un beau sujet, encore largement vierge, que l’inventaire des attentes de Hitler, ou de ses fondés de pouvoir, vis-à-vis de ses collaborateurs étrangers, et le recensement de ses méthodes pour les faire agir dans le sens de ses desseins, qui ne sont pas toujours les leurs.
Le premier chapitre, sur le couple Windsor, est largement inspiré de la vision de Martin Allen, le plus bizarre des historiens : point sot, capable de faire avancer certaines questions, mais convaincu d’usage de faux en de nombreux endroits de ses trois livres. Non seulement Edouard VIII est un agent nazi de toujours (dans un grand flou chronologique) mais son ami américain Charles Bedaux, un technocrate cosmopolite des plus intéressants et encore peu étudié, est lui aussi un simple espion allemand. Le chapitre suivant, sur le Grand Mufti de Jérusalem, est banal, comme le troisième, sur les bourreaux lettons des Juifs ; tous deux sont emblématiques d’un manque de curiosité sur la façon dont les dirigeants SS de la Solution finale intègrent ces collaborateurs dans leur jeu.
Vient ensuite, de façon inattendue, un morceau de roi : l’interview par Jacques de Launay dans sa prison de Budapest, en mars 1946, de Ferenc Szalasi, le leader des Croix-fléchées hongroises, quelques jours avant son procès et son exécution. Le Führer hongrois, au pouvoir sous l’occupation allemande d’octobre 1944 à mars 1945, sur un territoire réduit sans cesse par l’avance soviétique, est conscient du sort qui l’attend et prend la pose devant l’histoire. Il prétend n’avoir été ni fasciste ni nazi mais «hongarien», et avoir défendu pied à pied les intérêts de son pays devant Hitler ; au sujet des massacres de Juifs dont il fut l’un des auxiliaires non allemands les plus efficaces, il déploie une stratégie de défense exemplaire, c’est le cas de le dire : elle annonce déjà Bardèche, Rassinier et Faurisson. Il ne savait pas tout ce que faisaient ses subordonnés mais doute de ce qu’on en dit et exige des « preuves juridiques » tout en prétendant qu’elles n’existent pas ; il avait entendu parler de Dachau mais pas d’Auschwitz …
Le chapitre suivant porte sur Ante Pavelitch et son Etat croate sous protectorat italien puis allemand. Il y est surtout question de la persécution des Tsiganes dans la région de Jasenovac, sujet classique ici agrémenté de témoignages effrayants, dont la provenance n’est pas indiquée. De Pavelitch lui-même il n’est guère question… mais on le retrouve au chapitre suivant, censé parler du Vatican et consacré surtout à la fuite des collaborateurs vers l’Amérique latine via l’Italie, souvent par l’entremise de filières catholiques. On dévie alors sur le cas de l’archevêque de Zagreb, Mgr Stepinac, présenté un peu rapidement comme un pilier de l’Etat croate, encensé par Pie XII et sanctifié par Jean-Paul II (en 1998) au nom de l’anticommunisme. L’affaire donne lieu à des controverses et quelques sermons de 1942 contre les persécutions raciales ne compensent peut-être pas le soutien massif de la hiérarchie épiscopale croate à ce régime épouvantable, mais ils ne méritent pas pour autant un silence complet.
Retour au sujet avec un chapitre intitulé « La Suisse collabore », rapide et schématique, assénant sans le démontrer que la Confédération a paradoxalement plus collaboré avec l’Allemagne lors de son déclin qu’après ses triomphes, par crainte de l’expansion du communisme. Le thème de l’anticommunisme court d’ailleurs comme un fil… rouge tout au long de l’ouvrage, de façon bien intentionnée sans doute (il s’agit de montrer à quel point, au nom de cette cause, des gens ont pu s’avilir, notamment des ecclésiastiques), mais en courant le risque de prêter aux gens, sans esprit critique, les motivations qu’eux-mêmes se sont attribuées. Alors que les raisons de collaborer étaient fort diverses et souvent exemptes de quelque préoccupation politique que ce soit.
Suit un chapitre sur l’histoire bien connue du ghetto de Lodz et de son dictateur juif au service des nazis, Chaim Rumkowski. Ce collaborateur avait été en tous points parfait, en obtenant de ses administrés un gros rendement productif, une livraison volontaire des bouches inutiles (enfants, handicapés et vieillards), des départs échelonnés en bon ordre vers les chambres d’exécution de Chelmno et finalement, dans l’été 1944, une liquidation quasi-totale à Auschwitz des 70 000 survivants, dont Rumkowski lui-même. Sous prétexte que les Allemands ont laissé sur place 700 personnes pour des travaux de nettoyage et ont omis de les tuer avant l’arrivée des troupes soviétiques, le chapitre s’achève sur l’idée étrange qu’elles doivent la vie à Rumkowski.
Les pages sur la France sont décousues et, surtout, entachées de surprenantes inexactitudes. Le renvoi de Laval à la date, pourtant fameuse, du 13 décembre 1940, aurait eu lieu en août suivant ; quant au discours du 22 juin 1942 où il souhaite la victoire de l’Allemagne, il se mue en un article de journal. L’explosion d’une caserne allemande à Grenoble, sous l’effet d’une bombe déposée par la Résistance, est censée avoir causé 500 décès. Le sentiment qui aurait envahi les communistes à l’annonce de l’agression allemande contre l’URSS serait le soulagement. Une place démesurée est accordée au dynamitage du quartier marseillais du Vieux-Port et le tout s’achève par une lettre sans intérêt de la fille de Laval à l’ancien chancelier allemand Brüning, en 1949, à propos d’événements de 1931.
Plus informé et original apparaît le chapitre sur le mouvement flamand et ses conflits internes, ainsi que ses relations avec les rexistes de Léon Degrelle, les nazis wallons. C’est ici qu’on perçoit le mieux l’art allemand de pénétrer et de diviser. La documentation est riche et en partie originale, avec des entretiens de 1974 entre Jacques de Launay et l’ancien chef des collaborationnistes flamands, Jef van de Wiele. En revanche, les chapitres suivants, sur les menées collaboratrices de Quisling en Norvège, celles de Mussert en Hollande et celles de Rallis en Grèce, n’offrent que des données rebattues (le Gauleiter de Norvège, Terboven, est appelé avec insistance Verboven alors qu’il est correctement nommé dans d’autres chapitres). Le chapitre final est consacré à Andrei Vlassov, le brillant général soviétique capturé devant Léningrad en 1942 et retourné par les Allemands, qui cependant se méfient de lui et lui rognent les ailes. La documentation provient essentiellement de ses mémoires, où il conte des entretiens avec Hitler et Göring.
L’intérêt essentiel du livre réside donc, une fois encore (cf. Carnets de guerre / Jeunesses hitlériennes), dans l’utilisation des archives de Jacques de Launay, et la facilité d’usage de la documentation serait fort augmentée si le propos était clairement centré sur elle.