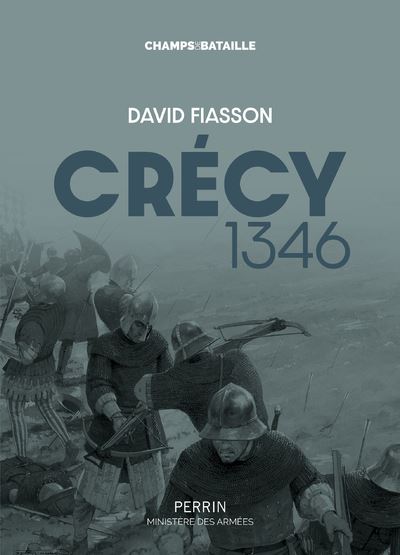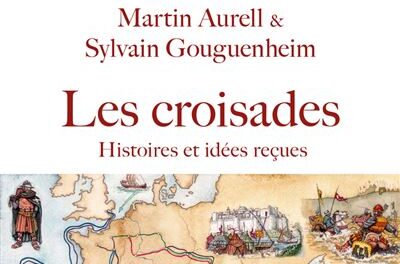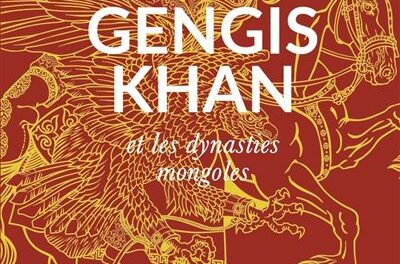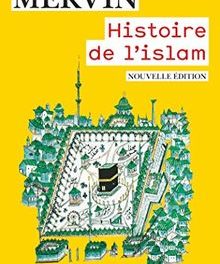De tous les affrontements dont fut parsemée la longue lutte que se livrèrent le Royaume de France des Valois et celui d’Angleterre dirigé par la maison Plantagênet puis celle de Lancastre au cours de la Guerre dite de Cent Ans (1337-1453), la bataille de Crécy a sans doute laissé la trace la plus marquante dans l’imaginaire collectif. Le 24 août 1346, la puissante chevalerie française, menée par son roi, lancée aux trousses d’une armée anglaise moins nombreuse, se vit infliger par les archers de celle-ci une défaite écrasante – première d’une lignée tragique qui, par ce qui semble être une sorte de fatalité tactique mâtinée d’aveuglement, devait être marquée par les autres désastres de Poitiers (1356) et d’Azincourt (1415), avant que l’ascendant de Jeanne d’Arc et les réformes de Charles VII ne permettent aux Français de reprendre l’avantage en bataille rangée.
Sur la route de Crécy
Les fiers seigneurs français bousculant, pressés d’en découdre, les arbalétriers génois combattant pour eux, leurs charges répétées stoppées par la pluie de flèches de l’ennemi, les vains exploits du roi aveugle Jean de Bohême, l’asile demandé par « l’infortuné Roi de France », blessé, au château de Labroye au soir de la bataille… Les images héritées de Crécy sont nombreuses, et on pourrait donc initialement s’étonner de voir cette défaite bien intégrée au récit national figurer dans la récente collection « Champs de bataille » co-éditée par Perrin et le Ministère des Armées en vertu de sa politique de soutien financier. Collection dirigée, dans le cadre d’une collaboration déjà féconde, par Jean Lopez, dont les ouvrages ont fait l’objet de plusieurs recensions dans la Cliothèque (voir par exemple les plus récentes ici, ici, ou encore là), et qui y a livré au début de l’année 2022 un premier titre consacré à un affrontement autrement méconnu, le désastre infligé par la Wehrmacht à l’offensive soviétique du printemps 1942 sur Kharkov.
C’est sur un tout autre registre que portent les travaux de David Fiasson : agrégé d’histoire passé par l’ENS de Lyon, l’auteur soutient fin 2019 sa thèse de doctorat sur la frontière du royaume de France face aux Anglais dans la seconde partie de la guerre de Cent ans. Enseignant-chercheur en histoire médiévale, il s’est spécialisé sur le phénomène guerrier sur la période… ce qui l’amène à intégrer dès 2018 l’équipe du magazine Guerres & Histoire réunie autour du même Jean Lopez.
Et il s’avère que le fruit de ce compagnonnage se trouve ici parfaitement pertinent, car, évidemment, les choses sont bien plus complexes et incertaines que le déroulé nourri d’images d’Epinal mentionné plus haut le laisse entendre, et ce n’est pas le moindre des mérites de l’ouvrage que de le mettre en valeur. Significativement, l’auteur l’introduit par une série de constats : l’historiographie sur la bataille est majoritairement étrangère ; et même la plus récente laisse encore place à un certain nombre de divergences marquées. C’est que les sources dont nous disposons reposent en quasi-intégralité sur les récits des chroniqueurs, nombreux, diversement connus et mis en valeur (on citera parmi les plus célèbres Les chroniques de Froissart, Les grandes chroniques de France…) et surtout emplis de différences voire de contradictions. D.Fiasson se propose donc d’aboutir à une synthèse actualisée par leur réexamen minutieux.
La suite de son avant-propos revient ainsi sur la genèse du conflit : à l’extinction de la lignée masculine capétienne, la difficile reconnaissance de Philippe VI de Valois comme Roi de France au détriment des prétentions d’Edouard III d’Angleterre (1328) est suivie, après un temps d’apaisement, d’une remontée des tensions du fait de l’accueil par le premier du roi d’Ecosse David Bruce en exil, de la piraterie normande, et du soutien apporté par le second à l’agitation des Flamands théoriquement vassaux du Roi de France. En 1337, Philippe ordonne la saisie des fiefs anglais sur le continent ; deux ans plus tard, son rival se proclame « Roi de France et d’Angleterre ». Dès lors, tous deux s’engagent sur « la route de Crécy » (première partie, p.19-91). Les débuts du conflit sont d’abord favorables aux Français ; en 1338, Edouard III prend cependant pied en Flandre. Il y détruit la flotte française lors de la bataille de l’Ecluse (juin 1340), s’assurant la maîtrise de la Manche, puis s’insère dans la guerre de succession de Bretagne qui débute l’année suivante. L’auteur avance que la préoccupation du monarque est, dès l’origine, d’attirer les Français en bataille rangée dans des conditions favorables, afin de remporter une victoire décisive susceptible de lui permettre de leur dicter sa paix (sinon la couronne, du moins la cession de l’Aquitaine en pleine souveraineté) ; une stratégie imposée par les moyens financiers limités de l’Angleterre et les exigences de ses créanciers, et autorisée par la confiance placée en son armée. Mais, à Buironfosse en octobre 1339 comme à Bouvines en septembre 1340, l’ost royal temporise devant un adversaire trop bien installé. Au printemps 1345, les Anglais rompent la trêve imposée par l’épuisement financier des protagonistes, et, menés par le comte de Derby, prennent l’offensive en Guyenne, où le fils du roi de France Jean (futur Jean II) vient les combattre l’année suivante. Edouard III prépare alors une nouvelle expédition en France, plus puissante que les précédentes ; et il décide audacieusement d’attaquer en Normandie, en plein territoire ennemi. Au rebours d’autres interprétations, D.Fiasson souligne de façon convaincante que ce choix n’est ni le fruit du hasard ni celui d’une improvisation : de nouveau, il s’agit vraisemblablement de pousser le Valois à l’affrontement par une chevauchée méthodique et provocatrice, au coeur du royaume cette fois-ci. Débarquée dans le Cotentin en juillet, l’armée anglaise, pillant et détruisant, marche sur Caen qu’elle prend d’assaut, puis sur la Seine devant laquelle elle arrive début août. Après plusieurs échecs, elle parvient à la franchir le 13 à Poissy, et réussit pareillement à traverser la Somme au gué de Blanquetaque le 24, alors que l’ost progressivement réuni par Philippe la talonne. C’est que, selon l’auteur, Edouard III est fermement décidé pour des raisons symboliques et pratiques à provoquer la bataille dans son ancien comté du Ponthieu.
Le 26 août, les deux armées se retrouvent donc en présence sur le site de la bataille – fort probablement celui que la tradition localise à la Vallée aux Clercs. Elles sont très différentes. Les peut-être 13 000 Anglais et Gallois sont majoritairement des archers (de loin les plus nombreux), piquiers et cavaliers légers de petite naissance recrutés selon les systèmes des retenues et compagnies d’array. S’y oppose sans doute le double de combattants du côté français, fournis par le domaine royal, les grands vassaux du monarque (Bourgogne, Flandre…), des contrats et alliances noués avec ses voisins ; pour 60 à 80 % des cavaliers nobles (chevaliers, et surtout écuyers, c’est-à-dire hommes d’armes non adoubés) renforcés par les milices des communes et quelques centaines d’arbalétriers mercenaires génois. Les Anglais ont choisi le terrain et ont eu le temps de l’aménager quelque peu ; ils se disposent vraisemblablement en trois « batailles » successives d’hommes d’armes et de piquiers, les archers étant massés aux ailes, les chariots à l’arrière. Les Français commencent à déboucher dans l’après-midi, après une longue marche estivale ; la décision initiale du roi est de remettre l’attaque au lendemain… mais, à la vue de l’ennemi et mue par le sentiment de l’honneur, l’attaque est lancée de façon brouillonne vers 18h, tragique erreur qui va amener « le triomphe d’Edouard III » (deuxième partie, p.93-170).
Dans l’ombre de Michelet
Le déroulé de la bataille elle-même reste parsemé d’incertitudes ; en une vingtaine de pages, D.Fiasson en propose la reconstitution suivante. Le tir préparatoire des arbalétriers génois, fatigués et privés de protection, tourne vite au fiasco face aux archers adverses. La première charge de cavalerie qui s’élance connaît le même échec ; au fur et à mesure que les hommes et les chevaux morts ou blessés s’amassent devant les rangs anglais, les assauts deviennent de plus en plus désorganisés, et la place prise par le corps-à-corps ou le coup de grâce à l’arme blanche s’accroît, tandis qu’échouent pareillement les attaques de revers lancées contre les chariots au sein desquels l’auteur place les quelques canons utilisés. On s’étonnera avec lui de l’obstination française, peut-être motivée par un engagement progressif des contingents arrivant sur le champ de bataille et la croyance en un succès toujours possible… A la tombée de la nuit, l’échec n’en est pas moins patent : avec les combats de hasard du lendemain, ce sont près de 6 000 Français, dont au moins un quart de nobles, et énormément de chevaux, qui perdent la vie à Crécy, contre environ 300 Anglais.
Victorieux, Edouard III marche sur Calais dont il entame le long siège (septembre 1346-août 1347). Confronté à d’autres revers en Guyenne, en Bretagne et en Ecosse, Philippe peine alors à mobiliser sa noblesse ; mais contrairement aux espoirs d’Edouard les Français ne renoncent pas, et ce sont les ravages de la Peste Noire qui, à partir de 1348, vont globalement geler les opérations jusqu’en 1355.
La troisième partie de l’ouvrage s’intéresse aux « postérités de la bataille » (p.171-242). Les leçons de Crécy sont d’abord politiques : alors que le prestige d’Edouard III est au plus haut, la défaite remet en cause la politique conduite par les Valois, voire leur légitimité ; mais Philippe puis son successeur Jean sauront y répondre par une épuration de leurs conseillers et une inflexion de leur politique centralisatrice. Pareillement, les Français paraissent, contrairement à l’opinion communément admise, tirer de véritables enseignements militaires du désastre dans les deux décennies qui suivent : la place laissée à l’infanterie augmente, l’encadrement et le contrôle des combattants sont renforcés, un signe distinctif est adopté, plusieurs adaptations tactiques sont expérimentées. Comme en témoigne le désastre suivant de Poitiers (19 septembre 1356), elles sont cependant insuffisantes à compenser les tares inhérentes à l’ost, et c’est par un coûteux revirement stratégique, la politique de la « terre déserte », que Charles V amène finalement les Anglais à signer la provisoire paix de Brétigny (1360). Il n’en reste pas moins que l’opinion communément admise d’un cycle de défaites reproduisant à l’identique le schéma tactique suicidaire et obsolète adopté à Crécy est fausse ; l’auteur explique sa genèse en décrivant les évolutions de l’historiographie de la bataille, dès l’origine partiale. En particulier, Jules Michelet , tout au processus de construction d’une mémoire nationale républicaine, y voit le signe du dépassement de la noblesse et de son déclin, une étape dans la longue gestation vers la souveraineté du peuple. Au delà de cette interprétation, l’auteur rappelle la place que l’événement, à travers le destin du roi Jean, prit dans la conscience nationale luxembourgeoise, et quel tourisme militaire, encore très vivace aujourd’hui, s’y développe dès le XVIIIe siècle.
C’est par de nouvelles considérations d’ordre militaire que se clôt l’ouvrage : à plus long terme, l’évolution entamée dans ce domaine du côté français dès après Crécy devait enfin déboucher au XVes. sur la reprise de la supériorité tactique et les victoires (Patay, Formigny, Castillon) qui allaient progressivement amener le conflit à son terme.
Au final, ce « Crécy 1346 » (on passera ici le sous-titre peut-être un peu emphatique, la participation du roi des Romains et de celui de Majorque du côté français n’étant guère connue) constitue un solide travail. Appuyé sur un riche corpus de sources et une bibliographie fournie auxquels renvoient de nombreuses notes, l’auteur passe au crible les différents aspects de l’événement. Circonstancié, chaque fait litigieux est traité rationnellement ; toutes les incertitudes ou partis pris sont relevés et discutés, une hypothèse argumentée étant finalement dégagée. Outre les points relevés ci-dessus, on signalera par exemple le portrait de Philippe VI bien plus nuancé que ceux qui se dégagent des chroniques qui est tracé à la fin de la deuxième partie. Bien charpenté, aéré de nombreux intertitres, l’ouvrage bénéficie en outre, conformément au choix fait pour cette nouvelle collection, de cartes en couleur de grande qualité réunies dans un encart central, d’un annexe détaillant l’ordre de bataille des deux armées (du moins ce qu’on en connaît), d’un lexique, d’un index et d’un marque-page regroupant chronologie et légende des cartes.
Il offre donc une lecture prenante, souvent convaincante sur son sujet, et l’envie de voir se poursuivre cette collection prometteuse.