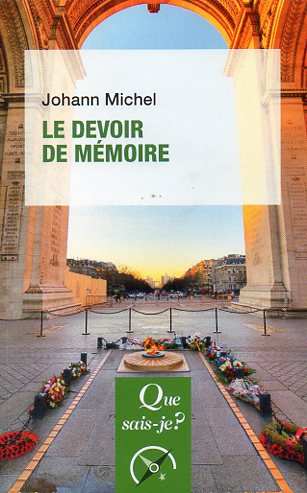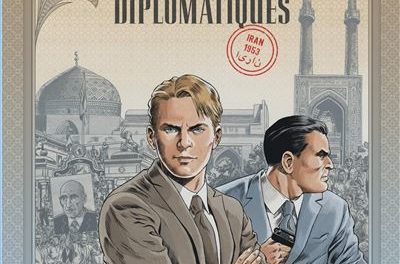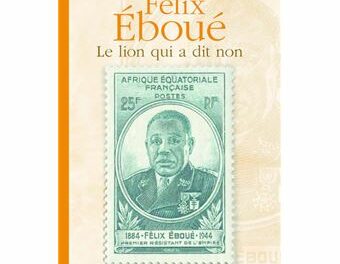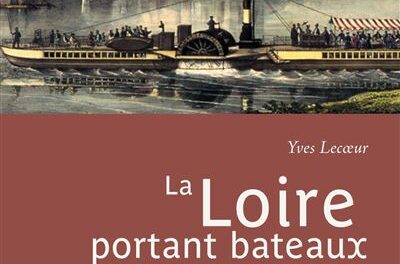Professeur à l’université de Poitiers, Johann Michel est chercheur au CEM/EHESS. Membre du Comité national pour la mémoire de l’esclavage, il est l’auteur de plusieurs articles et ouvrages sur les politiques mémorielles et plus particulièrement sur la mémoire de l’esclavage, notamment Gouverner les mémoires. Les politiques mémorielles de la France, Paris, PUF, 2010, et Devenir descendant d’esclave. Enquête sur les régimes mémoriels, PUR, 2015. Il signe dans la célèbre collection Que-sais-je ? la première édition d’une synthèse sur le devoir de mémoire. Respectant l’esprit et la lettre de la collection il répond en 126 pages d’un texte dense et très structuré aux questions que chacun peut se poser sur l’histoire, le sens et les usages d’une expression omniprésente dans le débat public depuis le début des années 1980-1990.
« Devoir de mémoire » est un néologisme inventé dans l’espace public et politique français. Il se présente comme une injonction, un impératif moral, voire un commandement politique : tu dois te souvenir. L’auteur traite des origines de l’expression, en rappelant que sur ce thème l’ouvrage de référence reste la thèse de Sébastien Ledoux, des cadres de sa problématisation, des modalités de son institutionnalisation, de ses enjeux éthiques, épistémologiques et politiques. Il expose dans un dernier chapitre les critiques dont fait l’objet le devoir de mémoire du fait de ses effets pervers, en abordant les notions de devoir d’histoire et de travail de mémoire.
Une notion plurivoque
Le « souviens-toi » s’inscrit dans le temps long
« Dans une perspective anthropologique sur le long cours des sociétés humaines, le devoir de mémoire n’est qu’une expression parmi d’autres pour désigner la fonction morale de la mémoire. » Paul Ricoeur a montré qu’il n’y a pas d’identité sans récits, et pas de récits sans mémoire. Certains événements doivent être oubliés, du moins momentanément quand c’est une condition de la concorde civile au sein d’une société ; d’autres mettraient en péril une société s’ils étaient oubliés. Ils doivent donc être rappelés. L’une des traductions religieuses fondatrices du devoir de mémoire se trouve dans la Bible : c’est l’injonction du « souviens-toi » (de la sortie de la servitude) faite au peule juif par Dieu. La Pâque juive est le rituel du devoir de mémoire. Par la suite, sous la monarchie française par exemple, le « souviens-toi » a pour objet les faits glorieux des rois, où de quelques personnages hors du commun.
Le paradigme du 11 Novembre : l’hommage aux morts pour la France
« C’est surtout après la Première Guerre mondiale que la démocratisation des politiques de la mémoire connaît une inflexion décisive » Les commémorations qui entourent l’armistice de la Grande Guerre inventent un nouveau cérémonial du devoir de mémoire. On crée un culte républicain avec ses rituels spécifiques ; on célèbre des citoyens morts pour la patrie, des héros mais aussi des victimes. Les commémorations du 11 Novembre deviennent le modèle à imiter pour honorer d’autres héros et d’autres victimes morts pour la France sur d’autres fronts. Le souvenir de la Résistance suscite « une frénésie commémorative » dans l’après-guerre, qui opère avec les mêmes rituels, toujours envers ceux qui sont morts pour ce qu’ils ont fait (combattre, résister). Il en ira de même pour les combattants des guerres coloniales. Le 11 Novembre reste « le référentiel par excellence » de ce que Paul Ricoeur appelle la « mémoire obligée », avant que l’expression « devoir de mémoire » ne s’impose.
Le référentiel de la Shoah : la reconnaissance des victimes innocentes
L’auteur rappelle la gestation de la mémoire des victimes de la Shoah dans les décennies d’après guerre, objet de l’étude de François Azouvi, Le Mythe du grand silence , étude qui démontre que la Shoah a été commémorée à l’intérieur de la communauté juive française dès le lendemain de la guerre, et qu’il n’y a pas eu de silence médiatique, intellectuel et officiel. Il expose ensuite les étapes et les acteurs du développement de la mémoire juive dans la société, en montrant l’importance des actions des époux Klarsfeld et des actions judiciaires intentées au nom du crime contre l’humanité. Le référentiel de la Shoah invente une nouvelle manière de concevoir le devoir de mémoire. On ne commémore plus les héros, mais les victimes, il ne s’agit plus des morts pour la France, mais des morts à cause de la France.
L’élargissement du devoir de mémoire : la traite et l’esclavage colonial
Les esclaves sont d’autres victimes, mortes à cause de la France. Le paradigme de la Shoah va s’élargir à ces victimes. L’auteur, qui est un spécialiste de la question, retrace les initiatives en vue de reconnaître la traite négrière et l’esclavage comme crimes contre l’humanité. Il montre que furent d’abord célébrées, dans le cadre associatif, les grandes figures de l’abolitionnisme, avant que, sous l’influence du référentiel de la Shoah, on ne rende hommage aux victimes persécutées à cause de a France.
Une injonction officielle du devoir de mémoire
L’auteur constate que le devoir de mémoire s’est d’abord exprimé au sein de groupes ou communautés restreintes (ce qu’il appelle le devoir de mémoire collective) ; que dans un second temps la société entière a été conduite à prendre conscience de la nécessité de se souvenir (devoir de mémoire publique) ; avant que, dans un troisième temps, les autorités politiques imposent ces souvenirs dans le cadre d’une politique de la mémoire (devoir de mémoire officielle).
Dans le second chapitre Johann Michel rend compte du processus de conversion du devoir de mémoire publique au devoir de mémoire officielle. Il structure son exposé en quatre parties : la judiciarisation du devoir de mémoire avec le procès Barbie (« avec le procès Barbie, le devoir de mémoire entre dans les foyers »), la politisation du devoir de mémoire avec Mitterrand, Chirac et la commémoration de la rafle du Vélodrome d’hiver (introduction sans précédent : celle d’une « commémoration négative », qui marque une période honteuse de l’histoire, tandis que la mémoire des Justes peut encore se lire dans un paradigme du 11 Novembre élargi aux non-combattants), la légalisation du devoir de mémoire avec la question de la commémoration de l’esclavage (officialisée dans la matrice forgée par la mémoire de la Shoah) et de la colonisation ; il aborde enfin la question de l’internationalisation du devoir de mémoire avec la question de l’Europe et des Journées internationales du souvenir (question de la reconnaissance du génocide arménien)
Un impératif controversé
C’est le thème du troisième et dernier chapitre qui s’ouvre sur cette citation de Simone Veil « Je n’aime pas l’expression devoir de mémoire. Le seul devoir, c’est d’enseigner et de transmettre. » Le devoir de mémoire est devenu omniprésent, peut-être en partie à cause d’un changement de régime d’historicité de nos sociétés, les utopies ayant perdu leur pouvoir mobilisateur, le présent étant anxiogène, les sociétés se tournent vers le passé ( voir les études de François Hartog ). L’intensification du devoir de mémoire, surtout à partir des années 2000, a provoqué des mouvements de contestation : le devoir de mémoire a été l’objet de critiques politiques, épistémologiques et juridiques.
Les historiens se mobilisent
En 2005 deux événements incitent les historiens à se mobiliser collectivement : la promulgation de loi du 23 février 2005 qui reconnait le rôle positif de la colonisation et l’affaire dite « Pétré-Grenouilleau », universitaire assigné en justice par une association lui reprochant des déclarations selon lesquelles la traite occidentale n’est pas la seule et que les traites ne sont pas des génocides. Les historiens demandent l’abrogation des lois mémorielles (pour certains d’entre eux sauf la loi Gayssot, voire la loi Taubira) qui sont contraires à la liberté de l’historien.
Le législateur s’interroge
Dans ce contexte le législateur met en œuvre des commissions chargées de réfléchir au sens des commémorations nationales et à la justification des lois mémorielles. La commission Accoyer reçoit une mission d’information sur les questions mémorielles et la commission Kaspi doit réfléchir à la modernisation des commémorations publiques. « De fait, c’est le procès du devoir de mémoire lui-même qui est alors instruit ». La commission Kaspi propose de réduire de 12 à trois le nombre de journées de commémoration nationale (11 Novembre, 8 Mai et 14 Juillet). La commission Accoyer, sans revenir sur l’acquis des lois mémorielles, demande qu’aucune nouvelle loi de ce type ne soit plus adoptée.
Le devoir d’histoire
C’est dans ce contexte de contestation du devoir de mémoire que des historiens forgent une nouvelle expression dont le but est de se substituer à la précédente : le devoir d’histoire, expression utilisée par Antoine Prost dans ses Douze leçons pour l’histoire. Il s’agit de donner la primauté à l’enquête distanciée et scientifique sur l’émotion de la mémoire. L’opposition de ces deux formules renvoie à l’opposition entre l’histoire et la mémoire (que tout n’oppose pas cependant puisque la mémoire est une des matrices de l’histoire). L’historien considère que le témoignage peut devenir une source archivée, et donc être soumis à la critique. « Les deux logiques, celle du devoir de mémoire et celle du devoir d’histoire, peuvent aller de concert lorsque la première est encadrée par la seconde. C’est le cas lorsque, par exemple, un professeur d’histoire d’enseignement secondaire, dans le cadre d’une leçon sur la Seconde Guerre mondiale (après restitution des faits et connaissances, établissement des régimes de causalité…) invite un rescapé ou un ancien résistant à venir témoigner de son expérience auprès de ses élèves. »
Le travail de mémoire
Une autre expression a vu le jour, celle du travail de mémoire, due au philosophe Paul Ricœur ; elle s’inspire de la pratique analytique et rappelle celle du « travail de deuil » inventée par Freud. Le travail de mémoire est un effort critique, réflexif et interprétatif : il permet d’extraire des souvenirs traumatisants leur valeur exemplaire ; comme le travail de deuil, il réconcilie le passé avec le présent et l’historien y prend toute sa place. C’est un travail dialectique de la mémoire et de l’histoire.
« Le devoir de mémoire n’a rien de condamnable ou de juste en soi. Sa légitimité dépend de ses usages. Le devoir de mémoire collective et publique restreint à l’identité d’un groupe particulier a toute sa place dans une société pluraliste et démocratique (…) C’est l’usage officiel, c’est-à-dire politique, du devoir de mémoire qui pose véritablement problème, lorsque la mémoire obligée devient en même temps commandée, et parfois soumise aux caprices du prince, à la démagogie du législateur et aux pouvoirs de pression. Le principe du devoir de mémoire pris en charge par les pouvoirs publics ne peut avoir une pleine légitimité, au nom d’un impératif de justice à l’égard des victimes, que s’il est adossé à la fois à un travail de mémoire et à un devoir d’histoire. »