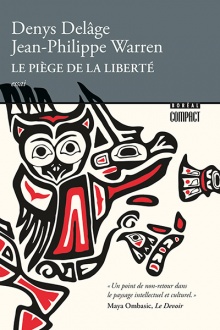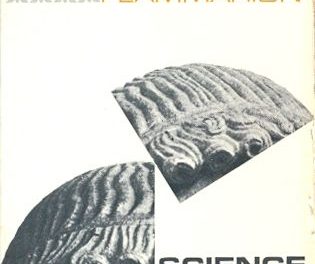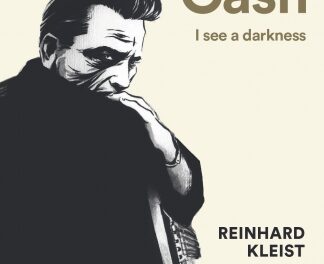Les peuples autochtones dans l’engrenage des régimes coloniaux
Dès l’introduction les auteurs donnent un résumé « à l’essentiel » de leur ouvrage : « Si les peuples occidentaux se sont imposés aux peuples autochtones en partie par la force des armes, en partie par l’unification microbienne du monde et en partie par la fourberie et les trahisons, ils l’ont fait aussi au moyen d’une interprétation nouvelle de la place de l’être humain dans l’ordre du monde qui, dans un premier mouvement, laissait dépourvus les Amérindiens. En d’autres termes, ces derniers ont également été brisés, malgré d’héroïques résistances, sur le terrain de la culture »1.
Opposant régime français de la Nouvelle-France, monarchique et quasi féodal, à la colonisation britannique puritaine et capitaliste, les auteurs interrogent les répercussions pour les Amérindiens du passage de la domination de l’un vers l’autre sur l’ensemble du nord-est du continent américain. Ils n’analysent pas le cas de chaque Nation : Algonquiens, nomades chasseurs-cueilleurs, Iroquoiens, agriculteurs semi-sédentaires… mais étudient l’ensemble des peuples présents avant l’arrivée des Européens dans leurs points communs et leurs différences en s’appuyant sur de nombreux exemples.
Un ouvrage dense, parfois redondant, en tout point passionnant.
La liberté des « Sauvages »
Le premier chapitre décrit de ce qu’est une chefferie autochtone, son organisation politique, les palabres, la circulation des biens dans un esprit de partage et de mépris de la possession des biens matériels.
Une société amérindienne contrastée par rapport au modèle monarchique français de soumission des sujets envers le roi et d’extrêmes écarts de fortune. La pauvreté observée en Europe par les premiers Amérindiens arrivés sur le sol français les a beaucoup choqués, d’autant qu’on a cherché à les impressionner avec les richesses de la cour.
Les auteurs appuient leur étude sur les travaux de Pierre Clastres, La société contre l’État et de Marcel Mauss, Essai sur le don. Ils décrivent comment, dans des groupes peu nombreux, les échanges de biens, de personnes, de symboles étaient habituels dans un système d’entraide. Le don et le contre-don étaient au cœur des relations entre groupes, y compris entre les Amérindiens et les Européens dans les postes de traites2.
Toutefois la nourriture n’était pas un objet d’échange mais toujours partagée.
Les relations humaines étaient vues comme des relations de parenté : l’adoption ou le mariage « à la mode du pays » permettaient d’accueillir l’étranger dans la famille comme le montre la situation des coureurs de bois. Le roi et son représentant le gouverneur étaient considérés comme un père, d’où l’appellation d’Onontio pour les désigner.
Les auteurs abordent ce qui marque l’autorité du chef dans ces sociétés égalitaires aux rites variés. Le chef qui va les mener à la guerre est choisi pour sa capacité à la palabre ; la parole « organise le monde » et le chef n’utilise pas la force pour s’imposer. Le chef parlait au nom des ancêtres, se devait d’organiser des festivités (ne rien garder des cadeaux reçus). Il est aussi médiateur dans les querelles. En cas de délit la peine est réparatrice et non punitive.
Quand on compare la cosmologie amérindienne à la religion chrétienne, on constate trois différences fondamentales. Chez les Amérindiens le principe dominant est la dette, individuelle elle devient collective face au péché chrétien personnel. L’unité de la communauté s’oppose à l’idée du peuple des élus. L’humanité autochtone englobe la nature (arbres, animaux, roches ont un esprit) alors que le chrétien est seul à avoir une âme.
Les auteurs décrivent longuement les systèmes de pensée amérindien et chrétien notamment l’enfer3.
Le joug de la liberté
Les auteurs tentent de comprendre comment on peut expliquer l’expression de l’historien américain Francis Parkman : « La civilisation espagnole a écrasé l’Indien, la civilisation anglaise l’a méprisé et négligé ; et la civilisation française l’a étreint et chéri »4. En Nouvelle-France les éléments climatiques, la faible présence d’agriculteurs amérindiens semi-sédentaires dans la vallée du Saint-Laurent, des colons essentiellement masculins voilà ce qui a favorisé les contacts avec les communautés de chasseurs trappeurs5.
Le lien féodal encore très présent dans la monarchie française a favorisé l’intégration des Amérindiens dans un système qui intégrait, en métropole aussi, la diversité des coutumes. La Nouvelle-France où domine la notion d’allégeance individuelle au roi s’oppose au système puritain des colons anglais rêvant d’une société homogène « des gens unis – des gens descendants des mêmes ancêtres, parlant la même langue, professant la même religion, attachés aux mêmes principes de gouvernement, très semblables dans leurs mœurs et leurs coutumes. »6
Le contrat social y est fondé sur le consentement et les responsabilités mutuelles ce qui suppose la négation des privilèges mais aussi des particularismes. Le pouvoir du peuple, base de la constitution étasunienne mais dans la soumission religieuse, une analyse qui éclaire aussi l’histoire américaine très contemporaine.
La société puritaine plus démocratique était aussi plus fermée, excluant les Amérindiens vus comme les enfants du diable.
D’autre part chez les catholiques français comme chez les protestants anglais la volonté de convertir les Amérindiens imposait une soumission totale à Dieu. L’exemple développé de la fondation de Ville-Marie montre son ancrage dans l‘esprit de la contre-réforme.
Si la concurrence missionnaire entre récollets et Jésuites était réelle, les uns comme les autres utilisaient les croyances indigènes pour les convaincre, les gestes et les paroles des prêtres étant souvent perçus comme des formes de chamanisme. On a même parlé de syncrétisme comme dans le dialogue du père Le Jeune et d’un chamane montagnais7, un rapprochement entre rites chrétiens et magie animiste.
Les auteurs reviennent ensuite sur le rapport au père hiérarchique : « Onontio » est un mot huron-iroquois qui désigne le roi, le gouverneur de Montréal mais la signification de l’obéissance au père n’était pas de même nature pour un Français et un Amérindien8. Une différence de conception de l’obéissance qui, si elle a permis des pratiques de clientélisme et d’alliance ne peut-être considérée comme un réel assujettissement. Chaque camp interprète, en effet, selon sa culture.
Les Amérindiens se plaçaient sous la protection du roi dont ils attendaient la générosité comme attendue de leur chef. Chaque année le renouvellement de l’alliance signifiait cérémonie et dons, en échange Les Amérindiens s’offraient comme guides, guerriers et fournisseurs de pelleteries.
Le pacte fondateur des rapports entre Amérindiens et Euro-Canadiens est semblable à celui qui lie les humains aux esprits protecteurs9. C’est ce qui explique la rhétorique de remboursement de la dette utilisée dans les pétitions contre les expropriations jusqu’au XIXe siècle face aux autorités anglo-saxonnes. Au XXe siècle encore les Innus perçoivent leur relation avec les autorités selon l’alliance traditionnelle alors même que les autorités y voient une demande répétée d’assistance et pratiquent une politique de charité.
Les auteurs rappellent que du côté des colons « La véritable liberté étant définie comme l’obéissance à l‘autorité légitime. La docilité, c’est-a-dire l’acceptation d’une soumission, devenait la marque de la civilisation.»10.
Par la religion et le choix des leaders parmi les convertis les autorités tentèrent de soumettre les Amérindiens à leurs principes : patriarcat, obéissance à un chef. La verticalisation du pouvoir s’exprime lors de l’éviction des alliés indiens lors des traités (Paris 1763), la propagande religieuse et l’écriture. L’introduction de l’écrit bouleverse le pouvoir indien même elle a pu être une arme contre le pouvoir colonial.
Les relations entre hommes et femmes sont analysées ainsi que leur évolution vers le patriarcat : de la complémentarité à la soumission des femmes.
L’intransigeance de la liberté
Ce chapitre porte sur la distinction fondamentale entre la conception totale des Amérindiens pour qui la construction d’un canot est, à la fois, un geste technique, économique, social et religieux alors que pour les colons ces différents aspects dont distincts et entraînent une différenciation sociale des pouvoirs politique (le fort), religieux (la mission) et économique (le comptoir). Ces trois pouvoirs ont, malgré des rivalités, des intérêts communs dans leurs relations avec les autochtones.
Les auteurs comparent les deux conceptions de la religion : animisme/chrétienté, chamane/prêtre ce qui permet une présentation approfondie de l’animisme amérindien : nature, rites, mythes. Ils montrent comment la contre-réforme a combattu des croyances populaires médiévales pas si éloignées de l’univers amérindien. Elle a aussi véhiculé une objectivation de la nature comme le montrent les ouvrages décrivant la botanique de la Nouvelle-France qui ne retiennent que les usages possibles des plantes.
Autre différence fondamentale : si les Amérindiens sont bien des humains pour les colons, les « vrais hommes » se limitent à la tribu. Les autres sont considérés comme ennemis, proies. Par exemple les Algonquiens les désignent sous le vocable de Mohawks, c’est-à-dire « mangeurs d’hommes », ce qui explique la cruauté dont ils pouvaient faire preuve au combat. La reconnaissance mutuelle se faisait dans le cadre des alliances ou de la parenté (mythe des origines de la confédération iroquoise).
Il faut noter que si les Amérindiens voient dans la religion des colons une croyance parallèle à la leur, le contact interculturel a aussi fait naître chez les Canadiens une réflexion sur la relativité de la civilisation chrétienne notamment dans les écrits du père Joseph-François Latifau ou du père Le Jeune. Cependant l’acceptation de la différence se limite à l’usage que chacun pouvait en tirer parti : le prêtre pour convertir, le marchand pour son commerce, les autorités pour la guerre.
L’ensauvagement, le respect des coutumes en Nouvelle-France s’opposent à l’idéal de pureté sociale des colons puritains des 13 colonies. Toutefois les auteurs montrent aussi que le métissage était plus le fait du peuple que les élites.
Du côté des Amérindiens, les auteurs, à la suite de Richard White, montrent que l’utilisation des rites et des attentes des Français à leur profit n’était pas rare mais sans renoncement à leur propre culture. Le compagnonnage entre Français et Amérindiens était réel mais avec des limites.
Les auteurs évoquent une triple conquête du monde à partir de la Renaissance qui prendra tout son sens au XIXe siècle : un christianisme prosélyte, un état impérialiste, une économie capitaliste.
Le commerce rend libre
La complémentarité entre le chasseur autochtone, le marchand de pelleterie et l’intermédiaire coureur de bois a conduit à un développement considérable aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cela a entraîné une évolution des pratiques de chasse au-delà de la nécessité alimentaire. A Tadoussac en 1710, à propos du Castor, on parle de destruction totale des animaux. Cette sur-chasse renforce aussi les guerres traditionnelles entre ethnies comme le montre la politique guerrière des Iroquois au XVIIe siècle.
Le développement de la pelleterie s’accompagne de la fin relative de l’autarcie, le troc pré-européen portait sur le tabac, le maïs, les perles. Les échanges entre peaux et « chaudières » en cuivre s’intensifie mais aussi contre des armes à feu qui contribue à l’intensification des guerres indiennes. C’est cette économie de la fourrure qui est décrite jusqu’au XIXe siècle, augmentation de la traite, recul de l’artisanat traditionnel, adoption d’outils manufacturés. L’évolution conduit vers une appropriation individuelle des territoires de trappe dans un contexte de libéralisme triomphant qui tire les prix des peaux vers le bas.
Pour les Amérindiens c’est un renversement du monde, du collectif vers l’individu et la propriété privée.
La propriété rend libre
Quand les Français revendiquent une terre au nom de roi la possession est plus symbolique (fort, croix à la fleur de lys) que réelle, faite de droits seigneuriaux qui impactent peu la vie des populations autochtones.
Au contraire Néerlandais et Anglais achetaient la terre, aux Indiens comme aux Européens11.
Cette appropriation du sol était complètement incompréhensible pour les Amérindiens pour qui les droits sur un espace étaient des droits d’usufruit qui s’accordaient plus facilement avec les seigneuries de la vallée du Saint-Laurent : « L’État colonial français garantissait aux peuples autochtones la jouissance d’un espace qui devenait dès lors leur territoire objectif »12.
Pour instaurer son autorité après 1763 le roi George III repris les dispositions françaises déclarant un vaste ensemble, des Appalaches au Mississippi, territoire de chasse indien donc où, théoriquement, on ne pouvait pas faire de commerce mais peu à peu on assiste à un accaparement des terres au profit des colons : construire sa maison vaut propriété et doit de clôture. Les auteurs montrent comment les idées libérales ont fondé la politique indienne aux Etats-Unis et au Haut-Canada et comment, pour se défendre les Amérindiens se sont pliés à cette notion de propriété privée et à déboucher sur la création des Réserves.
Le déclin de la chasse au XIXe siècle, par épuisement de la ressource, a profondément modifié les modes de vie et la culture. Les populations amérindiennes semi-sédentaires qui pratiquaient une agriculture itinérante n’étaient pas considérées comme propriétaires car leur mode d’exploitation du sol était éloigné de la ferme française ou anglaise.
L’analyse porte sur ces différences et les conséquences de l’appropriation des terres d’autant plus grandes que les colonies anglaises étaient, contrairement à la colonie française, des colonies de peuplement. Un discours Amérindien du Saint-Laurent aux Iroquois, tenu à Kahnawake en 1754, illustre bien les différences entre colonisation française et anglaise : « Ignorez-vous, nos frères, quelle différence il y a entre notre père [Onontio] et l’Anglais ? Allez voir les forts que notre père a établis et vous y verrez que la terre sous ses murs est encore en terres de chasse, ne s’étant placé dans celle que nous fréquentons que pour nous y faciliter nos besoins ; lorsque [alors que] l’Anglais au contraire n’est pas plutôt en possession d’une terre que le gibier est forcé de déserter, les bois tombent devant eux, la terre se découvre et nous ne trouvons de peine chez eux sur quoi nous mettre la nuit à l’abri. »13. Le passage d’une économie de traite à une économie agricole entraîna des résistances (guerre de Pontiac) et des migrations, des famines désastreuses dénoncées par exemple en 1851 par l’abbé Pilote : « les Montagnais subissent la loi commune au reste des sauvages. Notre civilisation les tue. »14.
Cette pression est d’autant plus forte qu’elle repose sur la pense européenne que la civilisation est forcément sédentaire et que seul un peuple agricole connaît la valeur du travail.
Les auteurs détaillent la politique de création des Réserves indiennes sous prétexte de les civiliser. Ils montrent le refus masculin constant de pratiquer l’agriculture car dans la tradition le potager était l’affaire des femmes. Dans certains cas les amérindiens ont cherché à faire reconnaître leur droit à percevoir une rente quand des agriculteurs mettaient en culture leur territoire.
Le travail rend libre
Reprenant des textes du XVIIe et du XVIIIe siècle, notamment ceux de Benjamin Franklin15, les auteurs rappellent l’éthique bourgeoise du travail comme obligation morale. Les coureurs de bois, comme les Indiens étaient perçus comme oisifs par les Anglais.
Les auteurs reprennent leur comparaison entre les univers français et anglais d’Amérique même si les uns et les autres étaient surpris du peu d’intérêt des Amérindiens pour la possession de biens matériels et plus enclins à satisfaire leurs besoins primaires. Quelques exemples permettent de nuancer quelques idées communes : non les Amérindiens n’ont pas toujours été abusés dans le commerce des peaux, l’alcool n’a, sans doute, pas été la plus grande cause de mortalité, ils ont été appauvris par les aléas de la traite et l’absence de thésaurisation. L’analyse des trocs montre que le numéraire était peu présent en Nouvelle-France alors que le troc et crédit étaient intégrables aux modes d’échange des Amérindiens, ce système dura jusqu’à la fin du XIXe siècle. Sur les immenses territoires contrôlés par la Compagnie de la baie d’Hudson l’unité de troc était la peau ou la demi-peau de castor : « pushkutai » en langue innue. Cela imposait de se servir dans les comptoirs de la compagnie, un rapport de force très favorable aux Euro-Canadiens. Comme le montre les nombreux exemples cité, le système était aussi utilisé pour les bûcherons, draveurs, scieurs des compagnies forestières.
Les Amérindiens restent peu présents dans le salariat industriel, jusqu’aux années 1930 la chasse représente le quart des ressources des Amérindiens du Québec à côté de l’artisanat traditionnel (tannage des peaux, fabrication de mocassins, de raquettes à neige16, de canots y compris en jouets par les Hurons de Lorette ou les vanneries des femmes abenaquises).
Les auteurs n’éludent pas la question de l’esclavage en analysant la distinction entre position, sort, avenir entre les Noirs et les Amérindiens. Dans l’imaginaire nord-américain l’Indien est un « bon sauvage » même si on le pourchasse, il est racialement différent du Noir ; l’Indien devait disparaître par une assimilation jamais possible pour le Noir. En quelques chiffres, on parle de 30 à 50 000 captifs amérindiens vendus en Virginie occidentale, il existait aussi des serfs en Alaska dans les années 1820. Les métis avaient la possibilité de jouer, selon les circonstances, sur leur double identité17.
La référence à Tocqueville : « pour connaître les bienfaits de la civilisation, il manquait aux Amérindiens de se conformer au travail qui rend libre »18 éclaire le titre de ce chapitre, une formule qui fut reprise par le National socialisme allemand.
Réformer et refouler
Le programme colonial européen était de sortir les Amérindiens de l’obscurité, civiliser les « sauvages ». qu’en était-il du projet éducatif ?
En Nouvelle-France pour un observateur, comme le Suédois Pehr Kalm, il y avait y plus un ensauvagement des colons qu’une francisation des « Sauvages ». L’instruction fut confiée aux ecclésiastiques qui les voyaient comme de grands enfants à soumettre à l’autorité, un modèle à l’opposé de l’instruction autochtone qui reposait sur l’imitation, la participation à la vie collective dans un climat permissif.
Les faibles succès de la politique éducative ne doivent rien à la querelle entre récollets et Jésuites : fallait-il civiliser pour faire de bons chrétiens ou convertir pour civiliser.
Aux États-Unis la construction de la nation passait par une unification, l’adoption d’une culture commune et rejetait à la fois les Noirs et les Amérindiens hors de la communauté. Il s’agissait au sens propre ou figuré de tuer l’Indien pour en faire un individu de raison selon les préceptes de Locke. Seuls ceux qui acceptaient les normes de la société libérale pouvaient être libres. Les autres devaient êtres soumis pauvres Anglais(Poor Law amendment Act – 1834) comme amérindiens (travail forcé, prison, réserve). Au cours du XIXe siècle on passe de l’attitude humanitaire, plus ou moins romantique, croyant à la possibilité de réformer les jeunes amérindiens à une attitude plus cynique de la victoire du plus fort et à un désinvestissement de l’effort d’instruction et à la création d’une administration des affaires indiennes distincte du reste de la société. Des internats scolaires, notamment au Canada, furent créés pour couper des enfants de leur milieu, de leur famille qui, ont perduré au XXe siècle et sont aujourd’hui dénoncés19.
Les auteurs reviennent sur un sujet déjà abordé au chapitre 2 : Le joug de la liberté, la politique du présent qui après la guerre d’indépendance américaine devient une politique de l’aumône aux conséquences paradoxales. Les Amérindiens virent là un moyen de conserver leur identité. Les auteurs rapportent l’attitude des Abénaquis d’Odanak en 1919 quand les autorités d’Ottawa propose pour l’émancipation des Amérindiens l’autorisation de vendre la terre des réserves et la fin de leur statut de pupilles de l’État : « Nous ne sommes pas prêts à jouir de la liberté, nous avons encore besoin de la tutelle du Gouvernement et, en plus, nous tenons à conserver les droits et privilèges dont nous jouissons depuis plus de deux siècles. »20. S’ils recevaient peu de l’État, ce peu était une reconnaissance de leur différence, de l’alliance passée quand l’émancipation signifiait le risque de tout perdre. Les auteurs rappellent les lois canadiennes sur les Indiens (Loi sur les Indiens de 1876, Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle des Sauvages de 1869, Acte d’avancement des Sauvages de 1884) qui traient de leur accès à une représentation citoyenne, en fait leur relégation dans un système en marge. Leur conception différente du travail et de la propriété demeure un fait aujourd’hui.
Un ouvrage d’histoire passionnant qui éclaire des aspects de l’actuelle société nord-américaine.
_____________________________
1 Cité p. 10-11
2 Description du cérémonial de la traite p. 30
3Dont le grand spécialiste fut Jean Delumeau : La peur en Occident (1978), puis Le péché et la peur (1983), enfin Rassurer et protéger (1989)
4Cité p. 71
5Les auteurs citent notamment l’historien Allan Greer : « De bons alliés militaires et de bons pourvoyeurs de fourrure ont besoin d’espace et d’autonomie, voilà pourquoi les Français ont intérêt à mettre au point une version plus subtil du colonialisme » extrait de Brève histoire des peuples de la Nouvelle France, Montréal, Boréal, 1998, p. 98 ; cité p. 73
6Cité p. 80, extrait de John Jay, The Federalist papers, NewYork, Bantam Books, 1982 p. 7
7Pages 90-91
8Il est ici fait référence à Gilles Havard, Empire et métissages, Indiens et Français dans le Pays d’en Haut 1660-1715, Québec, Éditions du Septentrion, 2017, 2e édition
9Comme dans les récits iroquois, l’entente avec les Néerlandais d’Albany, développé p. 110-111
10 Cité p. 119
11 Par exemple l’achat de la Louisiane à la France en 1803, le Nouveau-Mexique et l’Arizona à l’Espagne en 1853, plus tard l’Alaska
12 Cité p. 243
13 Extrait cité p. 267
14 Extrait de François Pilote, Le Saguenay en 1851, Québec, Imprimerie d’Augustin Côté & Cie, 1852, p. 20 ; cité p. 277
15 Benjamin Franklin, Des nécessités s’imposent à ceux qui veulent devenir riches, Essai de 1736, publié chez Lux édition en 2013
16 Cela demeure une activité des actuels Hurons de Wendake, par exemple l’entreprise Gros-Louis
17Exemple de Charles de Langlade, cité p. 333
18 Cité p. 335
19 Sur ce sujet voir de récit de Nathalie Bernard, Sauvages, Editions Thierry Magnier, 2018
20 Cité P. 388
—————-
Présentation sur le site de l’éditeur ici