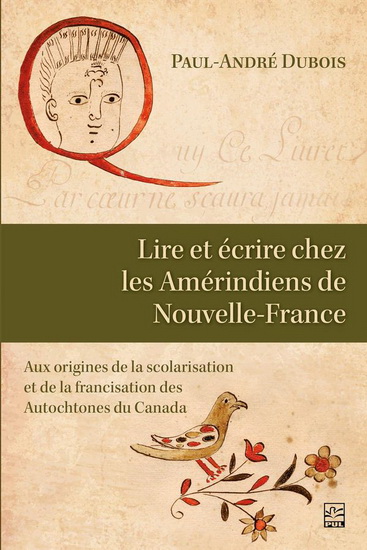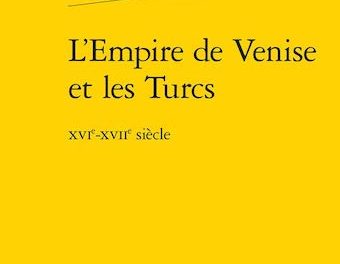L’enseignement du lire-écrire fut un projet à la fois linguistique et religieux : quelle école pour les jeunes amérindiens de la Nouvelle France, des premiers contacts à la Révolution américaine.
La francisation par l’école est étudiée notamment par des trajectoires individuelles, un arrimage culturel par l’écrit pour ces peuples de tradition orale. Ce qui est visé c’est aussi la christianisation de « sauvage » par le lire – écrire – chanter de la tradition monastique incarnée en Nouvelle France par les Récollets, les Jésuite et les Ursulines. L’auteur décrit la « rencontre initiale entre Européens et Amérindiens jusqu’aux premières mesures d’alphabétisation de groupes autochtones, un long chemin allait donc être parcouru. » (p.3) Dans son introduction il précise le cadre géographique et chronologique de son analyse et rappelle les principales études sur le sujet : Philippe Martin, James Axtell, Gilles Havard.
Le papier qui parle, papier qui chante : maîtres et élèves dans la Nouvelle-France naissante 1600-1659
Les premiers contacts montrent l’attrait de l’écrit pour les Amérindiens et en même temps pour les colons qui le perçoivent comme un instrument pour la christianisation. Le français est d’autant plus important en l’absence d’une langue locale qui puisse être un trait d’union entre les peuples comme le nathual que les Espagnols ont utilisé au Mexique.
Le français était porteur de la religion face aux cosmologies indiennes. L’auteur montre les réflexions de l’époque à partir de l’expérience de l’apostolat en culture non occidentale.
L’œuvre des Récollets est illustrée de quelques exemples comme l’alphabétisation de quelques enfants à Tadoussac, la fondation du premier séminaire pour former des catéchumènes parmi les autochtones avant que les Jésuites, fondent à leur tour, des écoles à Québec.
Dès les années 1630 la scolarisation des filles est envisagée et confiée aux Ursulines. Quelques portraits de jeunes huronnes alphabétisée montre le lien indissociable entre christianisation et apprentissage du français : lire – écrire – chanter à Québec comme pour celles qui furent envoyées en France comme une jeune franco-micmaque Marie Madeleine Amiskoueian.
L’auteur aborde les écoles en Acadie et dresse le portrait de quelques religieuses très investies dans ces efforts de scolarisation.
Francisation et alphabétisation au masculin 1660-1700
L’auteur replace son sujet dans les évolutions de la Nouvelle France dans la seconde moitié du XVIIe siècle. La multiplication des villages de « sauvages domiciliés » favorise la francisation en sujets : soldats mobilisables face au danger, bons chrétiens. Les vêtir à la façon occidentale et inciter à renoncer à la mobilité sont les premiers pas de l’éducation.
Au-delà du Lire – écrire, c’est rendre les Amérindiens sédentaires, cultivateurs : «les instruire et eslever en la manière de vivres des naturels sujets du Roy et de ne rien obmettre de nos soins pour les despendre de leurs humeurs barbares, et les rendre capables par les mariages de faire communauté de sang avec les françois habitants de la Nouvelle-France » (lettre de Gabriel Souart 1667 citée p. 83).
Cependant les résultats sont mitigés et les Jésuites sont plus favorables à enseigner des bribes de religion en langue huronne.
Devant la menace anglaise et sous son influence inspirée des méthodes britanniques, le nouveau gouverneur Frontenac veut franciser pour catéchiser et s’assurer de la fidélité de ses alliés hurons, montagnais ; en opposition au catéchiser en langue locale sans contacts avec les Français des Jésuites. On retrouve, en Nouvelle France, l’idée colbertienne du développement par le travail manuel qui se traduit par l’école et l’apprentissage d’un métier sédentaire pour éviter le vagabondage et l’ivrognerie. C’est le programme des écoles sulpiciennes calqué sur celui de leurs écoles parisiennes.
Des exemples illustrent ces deux conceptions avec un développement à, propos de l’œuvre du Sulpicien François Vachon de Belmont.
Lire et écrire au féminin 1666-1700
Ce troisième chapitre, après les premières tentatives décrites au premier chapitre, met en évidence le rôle majeur des Ursulines de Québec.
Quelques exemples montrent la « rééducation » des jeunes Françaises ensauvagées après leur capture par les Iroquois1.
Le français devient le trait d’union entre ces enfants qui parlent des langues différentes (huron, montagnais, iroquois…). Vu le coût de leur pension, leur nombre reste faible. On sait peu de chose de l’organisation des études et de la pédagogie utilisée.
Si au début on voit parmi ces jeunes filles de futures auxiliaires de la catéchèse, dans un second temps la francisation évolue pour servir le mariage et la diplomatie, alliances marchandes ou politiques (francisation des filles de chefs).
Après 1671 la Congrégation de Notre-Dame enseigne en Nouvelle-France. A côté du lire – écrire les séculières de la congrégation enseigne le travail manuel à leurs élèves amérindiennes comme françaises : textile et travaux de la ferme. Il s’agit pour Marguerite Bourgeoys, comme pour les garçons, de former une main-d’œuvre. La petite école de la mission de la Montagne (Ville-Marie (Montréal) est à la fois un lieu de socialisation et de remodelage identitaire.
Au crépuscule de la francisation 1700-1725
Le début du XVIIIe siècle est plutôt la Nouvelle-France entre les attaques iroquoises et les guerres importées d’Europe en cette fin de règne de Louis XIV. Si l’école reste, pour certains, un atout pour la colonie elle est menacée par la perte de soutien financier pour les Ursulines et par le peu de maîtrise des langues huronne, algonquine par les sœurs-enseignantes.
Si pour Lamothe Cadillac, fondateur de Détroit, la francisation est enfants est le point de départ d’un métissage ethnique et culturel pour peupler la colonie, les filles de la congrégation de Notre-Dame sont plus attachées à la transmission du travail du textile qu’à l’alphabétisation.
Un autre fait marquant de cette période troublée est la francisation des captives anglaises. Derrière ce terme on trouve de jeunes Anglaises kidnappées Sur ce thème voir John Demos, Une captive heureuse chez les Iroquois, Québec, Presses Universitaires Laval, 2019 lors des incursions des Abénaquis, alliés de la France, dans les colonies de Nouvelle-Angleterre. Elles sont rachetées par le gouverneur Vaudreuil
et confiées aux couvents de la vallée du Saint-Laurent. Outre l’apprentissage du français pour ces fillettes qui ne parlent souvent qu’iroquois, c’est la conversion au catholicisme qui les attend. L’auteur évoque les problèmes de communication, rares étant les habitants de la Nouvelle-France à connaître la langue anglaise.
Le coup de grâce porté à la politique d’éducation des jeunes amérindiennes est porté en France par Mme de Vaudreuil qui obtient que le budget soit alloué à la francisation des jeunes captives surtout si elles sont de bonne naissance et peuvent donc faire de bonnes épouses pour les nobles et officiers de la colonie. Privé de soutien financier les petites écoles périclitent.
L’auteur décrit aussi l’enseignement des garçons au Sault-au-Récollet (sur l’île de Montréal), à l’action des frères Charron et à celle des Frères des écoles chrétiennes. Cette francisation des garçons peine à se remettre en place par manque de personnel qualifié plus que par manque de financement.
Francisation au réel
Après un parcours chronologique l’auteur tente d’en faire un bilan.
L’histoire de quelques filles francisées par les Ursulines et le parcours de leur descendance permet d’appréhender cette réalité.
Ce qui domine c’est la diversité des situations et des métissages tant biologiques que culturels. Leur nombre est faible : 69 de 1639 à 1725 ont laissé des traces dans les archives.
Parmi les Huronnes retenons Marie-Felix Asentohonsen-Dubosc qui épouse en 1662 Laurent Dubosc, interprète comme certains de leurs sept enfants dont Jean incorporé à la garde du gouverneur. Cet exemple illustre la politique de sécurisation des alliances avec les tribus alliées comme c’est aussi le cas pour Louison Tekouerimat, fille d’un chef montagnais de Sillery-Lac Saint-Jean, association qui fortifie les liens de trappe face à l’influence des Anglais de la Baie d’Hudson.
Dans le cas de la famille Peltier on voit une association marchande et un moyen d’ascension sociale. Le mariage avec une amérindienne assure une association dans la traite et les filles nées de cette union sont éduquées par les Ursulines. On constate que le plus souvent les jeunes Amérindiennes ou métis sont déjà baptisées quand elles arrivent à l’école et que souvent elles aspirent à leur sortie à une vie à la mode occidentale. Certaines, faute de dot, se font srvantes , souvent de marchands et sont liées à la traite des fourrures.
Marie-Anne Denys de Fonsac incarne la « face grimaçante » (p. 277) de la francisation. Fille d’un noble acadien et d’une Micmaque elle connaît le sort parfois malheureux des enfants métis.
Marie-Thérèse Petitpas, originaire des environs de la Rivière du Loup fut formée au rôle de la catéchèse en tant que mère de famille. Elle est conduite à Miramichi où elle épouse Claude Petitpas dit Lafleur interprète en langue micmaque et pêcheur de morue. Travaillant avec les Français comme les Anglais, leur fils part faire des études à Hervard aux frais du Council of Massachusetts qui compte sur son trilinguisme pour attirer les Micmacs à l’alliance anglaise.
Marie-Anselme est petite fille d’un chef abenaquis d’Acadie, elle devint, par mariage dans une famille enrichie dans la traite de fourrure, baronne de St Castin et fini ses jours au pied des Pyrénées.
Catherine Annennontak-Durand est, elle aussi, huronne et bonne épouse. Elle, ses filles, petites filles, toutes formées par les Ursulines sont des archétypes de ce que voulait la politique de francisation. Un de ses descendant Jean-Baptiste Cadot est coureur de bois.
Le dernier portrait, celui de Rosalie, concerne une jeune captive anglaise née dans le Maine et enlevée en 1703. Ramenée à Bécancour par les Abénaquis, elle est confiée aux Ursulines de Qué »bec en 1705. Mariée à un autre captif Samuel Gill, ils sont 40 ans plus tard considéré comme un couple modèle de la mission de St-François du lac. C’est une famille que l’on retrouve au centre de la concurrence commerciale entre Abénaquis, Canadiens, marchands d’Albany, implantation hollandaise, et dont un membre s’est engagé en faveur de la Révolution américaine.
D’après ces exemples, l’éducation est au centre des préoccupations de familles franco-amérindiennes, des trajectoires faites de mobilité géographique, sociale, linguistique et culturelle.
Francisation et écriture en liberté
Si les premiers chapitres sont consacrés à l’école missionnaire, il s’agit ici de voir comment l’écrit et le français sont entrés dans la culture orale amérindienne.
Pour définir l’acte d’écrire les Jésuites qui veulent l’exprimer en langue algonquienne utilisèrent, par analogie, le terme « massinahigan », faire des marques qui était une pratique largement répandues chez les Amérindiens.
Malgré l’absence d’école on constate que l’écrit était présent par exemple les calendriers (reproduction p. 323) induisant un nouveau rapport au temps profane comme sacré. Dans le cadre du commerce de traite on observe des traces de crédit quand d’autres concernent les alliances avec les Canadiens ou les Anglais.
A la mission, l’écrit est l’affaire du religieux. Ce sont les bréviaires sur lesquels le missionnaire appuie sa prédication et son pouvoir.
L’auteur explique comment le symbole, la lettre devient un élément de décor des colliers de Wampum. L’écriture pénètre le système symbolique des Amérindiens. Au XVIIIe siècle les chefs amérindiens considèrent qu’un accord avec les Européens n’a de valeurs que complété par un écrit même s’ils ne maîtrisent pas la lecture.
La lente progression de la présence de l’écrit s’accompagne de la pénétration de la langue française par la fréquentation des coureurs de bois, marchands, soldats, missionnaires jusque dans des lieux assez éloignés de la vallée du Saint-Laurent comme le suggère le récit de voyage de Claude Lebeau (p. 337 et suivantes).
Si le contact avec les Canadiens et le métissage ont, sans doute, joué un grand rôle le préceptorat est une piste suivie par l’auteur. Enseigner le français à un jeune Amérindien pour en faire un interprète peut s’avérer profitable. Il en va de même de l’imprégnation linguistique pour les esclaves [oui l’esclavage a existé en Nouvelle-France2].
Au milieu du XVIIIe siècle le français semble assez répandu en Acadie ou dans les villages de « sauvages domiciliés », même s’il est difficile d’en évaluer la maîtrise.
L’école sans la lettre
Faire fonctionner une école est assez onéreux aussi les missionnaires ont-ils utilisé, dans leur action évangélisatrice, les marques et les images sans recours à l’écriture proprement dite.
La description de l’initiative du Récollet Christian Le Clercq montre l’originalité de cette pratique crée pour christianiser les Micmacs de Gaspésie : inscrire des marques mnémotechniques au charbon de bois sur des écorces de bouleau, rejoignant ainsi la technique de l’« inscrit » des Algonquiens qui représentent aussi des données cartographiques ou symboliques (reproduction de pétroglyphes du site archéologique de Woodview p. 371). Cette méthode fur efficace pour la catéchèse en langue locale. L’auteur la compare avec la méthode des pictogrammes utilisée par les missionnaires espagnoles au Mexique. Il montre l’utilisation d’images représentant la messe.
Les images furent aussi utilisées en matière diplomatique.
Pierre Maillard, en Acadie au début du XVIIIe siècle a amélioré les marques micmaques, ce qu’il a lui-même appelé hiéroglyphes (reproduction p. 397) qui peuvent être assimilés à un système d’écriture. L’auteur évoque comment, en métropole, on a considéré ces pratiques.
Pouvoir de l’écrit et rêves d’empire dans les colonies
Si au XVIIIe siècle l’effort de scolarisation recule au Canada, il prend une certaine ampleur dans les colonies anglaises dans un contexte politique et religieux de concurrence impériale. C’est cette comparaison qui est décrite au chapitre 8, entre expériences missionnaires catholiques et protestantes chez les Abénaquis d’Acadie et les Iroquois. L’auteur analyse notamment les différences entre sens des sacrements et rapports à l’écrit.
L’école et l’alphabétisation au gré des changements de régime, 1760-1800
La Nouvelle-France est alors sous autorité britannique.
Les élites amérindiennes, plus ou moins métissées, recherchent dans l’école pour leurs enfants un moyen de consolider leur position dans un contexte de concurrence entre une école française catholique qui se maintient et une école anglaise qui peine à se développer.
L’auteur décrit le contexte politique et institutionnel.
Il montre quelques expériences concrètes :
- l’école du père jésuite de La Brosse chez les Montagnais du Domaine du Roy (région de Tadoussac) favorisée par les autorités anglaises pour raisons économiques liées à la traite des fourrures et avec le soutien des marchands de Québec.
- La Moor’s indian charity school qui met le travail notamment agricole au centre des apprentissages. Venu du New Hampshire, Wheelock tente d’implanter ses écoles dans les missions de Sault-St-Louis et du Lac-des-deux-montagnes et au village de « sauvages domiciliés » de Lorette. Cette éducation offre des perspectives de promotion sociale et économique et par l’alphabétisation un moyen de défendre ses droits par le système des pétitions sur le modèle administratif anglais. Deux exemples d’élève de cette école illustrent le propos.
L’auteur aborde enfin la scolarisation des jeunes iroquois. Et leur positionnement dans la révolution américaine. L’édition d’un livre de prières anglicanes et d’abécédaires en langue iroquoise montre, à la fois, l’alphabétisation croissante de ce groupe et le jeu politique des autorités anglaises, non sans réactions de la communauté catholique canadienne.
L’étude de la scolarité des Malécites et des Penobxcots montre les conséquences de la révolution américaine sur la politique des gouverneurs anglais face aux missions catholiques et protestantes. Du choix de l’école découle la langue et la religion. Comme en Nouvelle-Ecosse l’anglicisation des enfants micmacs.
Conclusion
L’école fut longtemps inadaptée aux réalités culturelles et socio-économiques des Amérindiens. Elle montre pourtant une réelle volonté d’intégrer des hommes et des femmes qui puissent être des modèles pour leur peuple.
Un ouvrage très documenté qui montre toute la diversité des échanges interculturels entre Canadiens et populations amérindiennes.
_____________________________________
2 Sur ce point voir : https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/population/esclavage/
_____________________________________