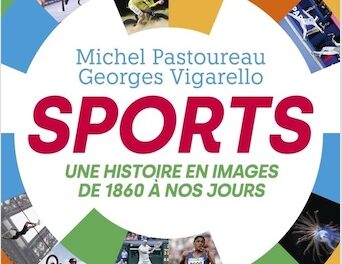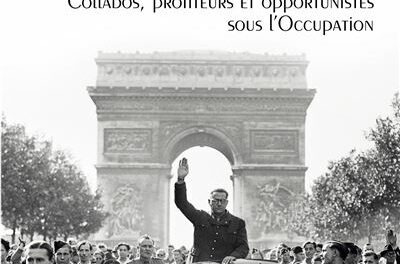Les éditions Chandeigne propose en ce mois de septembre un texte particulier : les carnets d’une jeune portugaise, née à Lourenço Marques (aujourd’hui Maputo) en 1963, qui témoigne de ce que fut la colonisation dans cette partie de l’Afrique australe. Isabela Figueiredo a construit son identité de femme et d’écrivaine sur une expérience douloureuse de retornada (rapatriée).
Léonora Miano, en introduction, réfléchit aux notions de racialité, racialisation indissoluble de la colonisation. Si les Africains et Afro-descendants en sont, bien sûr, les principales victimes, les Blancs sont, en quelque sorte, pris dans un contexte qui leur impose une position de dominant blanc, comme assignés à leur place de colonisateurs. Elle montre en quoi le récit d’Isabela Figueiredo met en lumière la recherche d’une identité de cette enfant blanche/noire, née sur la terre d’Afrique, une recherche sans issue.
Le carnet d’Isabela FigueiredoIls ont été publiés en portugais en 2009 sont, dès les premières lignes, d’un ton très cru, une manière peut-être de situer la barrière infranchissable entre deux communautés en présence, étrangères du fait de la colonisation qui assigne chacun à un rôle, une mentalité, en fonction de sa couleur.
Dans ce récit de vie l’écrivaine rapporte les éléments d’un racisme ordinaire, quotidien largement incarné par son père. La famille de « petits blancs » vit le racisme colonial comme une façon de sortir de son état social. Le père d’Isabela Figueiredo a fui la pauvreté du Portugal en s’installant comme artisan électricien au Mozambique. Il y vit modestement, une réalité dont sa fille n’est pas consciente car elle se sent riche face aux petits mendiants noirs qu’elle voit à sa porte : « ceux qui étaient de la même terre que moi mais qui ne pouvaient pas être comme moi » (p. 93).
Dans les mots de l’autrice certaines pages sont des morceaux d’anthologie de l’expression du racisme colonial : « les nègres étaient des fainéants[…] ils vivaient aux dépens de sa négresse[…] Il fallait absolument apprendre à ses nègres à travailler pour leur propre bien » (p.91). Même si elle-même enfant se méfie de ces discours, si elle n’adhère pas à cette différenciation raciale.
Au détour de ses souvenirs, c’est un tableau de Mozambique avant la Révolution des Œillets, de la vie quotidienne aperçue par les interstices des palissades du caniçoQuartier périphérique de la capitale. Quelques pages évoquent la guérilla dans le Nord mais aussi l’idée que l’indépendance était possible après le 25 avril 1974, une rupture avec la lointaine métropole mais sans changement, un Mozambique libre sous domination blanche. La violence envahit la vie de la fillette lors des massacres de septembre 1974, elle les raconte de manière brutale, crue cette fin d’un monde. Envoyée chez sa grand-mère au Portugal elle voit la misère et surtout le sentiment de l’exil, le rejet des colons rapatriés et un étrange sentiment de culpabilité : « Le Mozambique est cette image figée de la petite fille au soleil, aux cheveux blonds impeccablement tressés, devant l’enfant noir couvert de poussière, presque nu, affamé, tous deux silencieux, ne sachant que se dire, se découvrant unis par l’âge et opposés par la justice, le bien et le mal, la survie. »(p. 228)
Un récit très personnel qui cependant fait écho à d’autres, ces hommes et ces femmes qui ont dû partir au moment des indépendances.
Sur ce thème on pourra trouver des témoignages et des analyses dans : Carmel Sammut, Itinérance d’un pied-noir de Tunis de souche maltaise, L’Harmattan, 2017 – Alain Vincenot, Les pieds noirs, bernés de l’histoire, L’Archipel, 2014 – Fred Neidhardt, Les pieds noirs à la mer, Éditions Marabout – Marabulles, 2013 et plus général : Olivier Dard, Anne Dulphy (dir.), Déracinés, exilés, rapatriés ? Fin d’empires coloniaux et migrations, Bruxelles, Editions Peter Lang, collection « Pour une histoire nouvelle de l’Europe », volume 12, 2020
Présentation sur le site de l’éditeur.