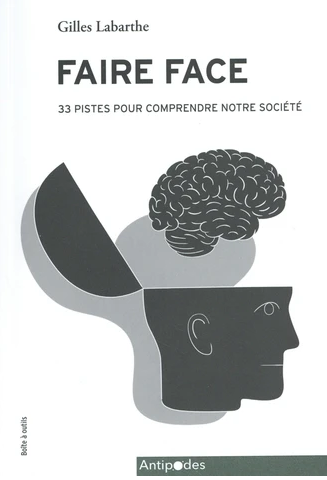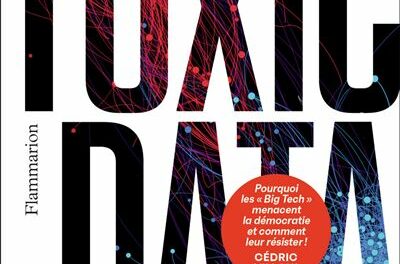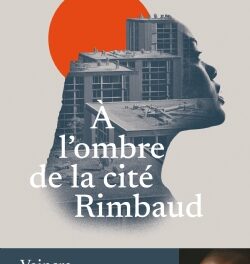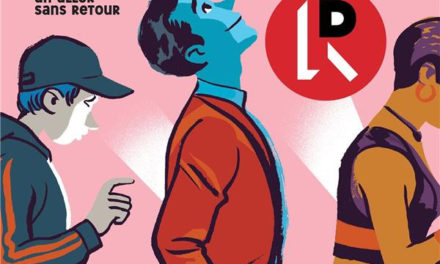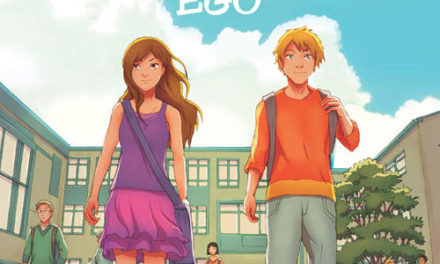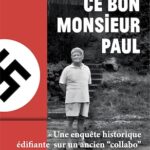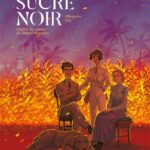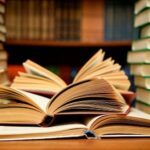Dans le climat actuel de remise en cause de la science, Gilles Labarthe, chercheur scientifique et de journaliste indépendant, donne la parole aux scientifiques de diverses disciplines et de plusieurs pays, même si la Suisse est majoritaire. L’idée est de donner à comprendre, dans un langage accessible, la complexité de la science pour recréer du sens et des repères utiles. Les propos des chercheurs témoignent de leurs questionnements, leurs problématiques et leur doute. Montrer comment se construit le discours scientifique.
Les 33 interviews peuvent se regrouper autour de quelques disciplines. Chaque article, trois ou quatre pages, est complété d’une sitologie pour aller plus loin. Chaque intervenant est invité à expliquer pourquoi elle, il a choisi ce sujet de recherche, le contexte de son étude,
Histoire
Parona Ghose, dans sa thèse sur l’histoire du Rap français (1981-2012), analyse le sentiment de marginalisation des banlieusards, souvent issus de l’immigration qui exprime une critique de la société française, mais aussi une volonté de participer à la République.
Davide Rodogno, analyse les traces racistes dans les lieux en SuisseIl évoque notamment le cas de Woodrow Wilson. À Genève, le palais à son nom rappelle son rôle dans la naissance de la SDN, il abrite aujourd’hui le haut Commissariat aux Droits de l’Homme, situation paradoxale puisque Woodrow Wilson avait été sympathisant pour le Ku Klux Klan et favorable aux théories de la suprématie blanche. et pose une question qui dépasse largement ce pays : que faire des statues de personnages controversés ?
Carl Chinn analyse l’histoire des Reaky Blinders, un gang des années 1920-1930, symptôme de la misère sociale de l’Angleterre loin des clichés des récentes séries télévisuelles.
Mark Bittman, auteur de L’Histoire aberrante et l’alimentation 10 000 ans d’impacts sur la santé et l’environnementPublié chez Actes Sud en 2024 dénonce la catastrophe sanitaire et climatique de la malbouffe, conséquence de notre système alimentaire (production et consommation), en particulier aux États-Unis avec la production de viande.
Fabien Knittel, avec un titre étonnant Aux origines de la voie lactée, propose une rapide histoire de la croissance de la consommation de produits laitiersDu lait et des hommes, Didier Nourrisson, Vendémiaire, 2021 – La fabrique du lait – Europe occidentale, Moyen-Âge-XXe siècle, Fabien Knittel, CNRS Éditions, 2023 quand la baisse des cours des céréales encourage l’élevage à la fin du XIXe siècle.
Anthropologie
Anne Lavanchy étudie les procédures, souvent opaques de la naturalisation en Suisse, entre question d’intégration et trajectoires de vie.
Grégoire Mayor et Yann Laville proposent une analyse de l’exposition de Neuchâtel : Cargo Cults Unlimited. Cette exposition met en évidence la mondialisation entre mythe de l’abondance, idéologie du libre-échange, croissance des activités illégales génératrices de richesse et crises financières.
Sociologie
Les recherches de Liliane Azevedo portent sur le retour au pays des migrants portugais, installés en Suisse, au moment de la retraite.
Sibylle Gollac s’intéresse aux inégalités Femmes – hommes face au capital. Elle présente sa méthodologie qui, contrairement aux idées reçues, montre un accroissement des inégalités de constitutions d’un patrimoine, aujourd’hui où la séparation de biens est la norme des couples.
Éric Doidy montre le retour d’une genre musical : le Blues, forme d’expression des minorités pauvres, dans le Sud des États-Unis. Un phénomène en plein renouveau depuis la pandémie de COVID.
Gérald BronnerAuteur d’Apocalypse cognitive, PUF, 2021 s’intéresse au « marché de la peur » véhiculés sur Internet. Les informations visent nos émotions et les peurs ancestrales, alors que, dans la société actuelle, chacun a le temps de la réflexion.
« Quand l’IA « profile » notre avenir », quels risques ? Telle est la question que pose Philippe Huneman. Il montre les risques de mise en place d’une société de contrôle en référence à Foucault.
Anusha Jain revient sur les risques politiques, notamment en Inde, du ciblage, des chatbots . Deepfakes et désinformation profitent des vides juridiques pour manipuler l’opinion publique.
Géographie
Julie de Dardel dresse un tableau peu glorieux des prisons suisses, devenus un mode de gestion des migrations.
Raphaël Mathevet et Roméo Bondon voient dans les sangliers, en surnombre, présents y compris en zone urbaine, un révélateur des enjeux économiques et politiques de gestion de l’espace.
Yvette Veyret et Richard Laganier identifient les risques naturels dans le contexte du changement climatique. Les conséquences, notamment économiques, en sont amplifiées par l’interconnexion du monde. Ils militent pour une réflexion prenant en compte les aléas dans tout projet d’aménagement.
Climatologie
Jean-François Doussin explique pourquoi la diffusion de l’information sur le changement climatique doit changer de forme, en choisissant par exemple la BDBonpote, Anne Brès, Claire Marc, Tout comprendre (ou presque) sur le climat, CNRS, 2022 pour atteindre un large public.
Ethnographie
Floriane Morin aborde la question de la restitution des œuvres d’art volées lors de la colonisation. Son étude porte sur les œuvres du Bénin dans les collections du musée de Genève.
Sur cette thématique qui n’est pas seulement suisse, voir : Les otages – contre histoire d’un butin colonial, Taina Tervonen, Ed. Marchialy, 2022
Droit
Samson Yemane analyse la discrimination raciale en Suisse à l’occasion de la création d’un espace d’accueil et de soutien aux victimes de racisme.
Christophe Champod explique la naissance de la police scientifique en 1909 avec les travaux de Reiss qui prolonge ceux de Bertillon. En opposition à l’anthropologie criminelle de Cesare Lombroso, l’objectif est de fixer des règles pour éviter une interprétation subjective des photographies de scènes de crime. L’auteur fait un parallèle avec certaines dérives actuelles comme « le crime inscrit dans l’ADN ».
Journalisme
Barnie Choudhury montre la permanence, à la BBC, d’une sous-représentation des minorités issues de la migration. Il propose des solutions pour favoriser la diversité des journalistes.
Jean-Philippe Ceppi a travaillé sur les méthodes du journalisme d’investigation, comme l’usage de la « caméra cachée » (France, USA, Grande Bretagne) Il en rappelle la longue histoire, faisant référence à Nelly Blye. Il en montre l’intérêt et les limites éthiques.
Manisha Ganguly aborde les enquêtes sur les crimes de guerre et notamment les méthodes d’OSINT (open source intelligence), notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine.
« X, le réseau social qui insulte la science », Didier Pittet analyse, en médecin, la désinformation à propos de la COVID et les insultes contre le corps médical et les chercheurs.
Littérature
Andréï Kourkov aborde le recours à l’humour, noir, comme seule expression possible en Ukraine avant Maïdan. Il montre une situation plus favorable à la dénonciation des scandales politiques, économiques, malgré la guerre, depuis 2014.
Psychologie
Clinique avec Pascal Romain qui interroge un sujet répandu et tabou, les violences intrafamiliales et plus spécialement l’inceste.
Biologie, médecine
Pénélope Lacombe s’intéresse aux comportements des grands singes. Ses expériences au zoo de Bâle cherchent à définir si les orangs-outans font des choix raisonnés.
Francis Saucy se penche sur le déclin des abeilles.
Gilbert Greub aborde la question du risque viral lié à la fonte du permafrost, sans pour autant se montrer alarmiste.
Olivier Michielin montre les progrès possibles dans le traitement des cancers grâce aux avancées digitales : IA et ARN messagers.
Hartmut Rosa propose de renouer avec l’indisponibilité, une expérience de la vie.
Un article intéressera particulièrement les enseignants. Richard-Emmanuel Eastes plaide pour former les élèves à une utilisation critique de Chatgpt.