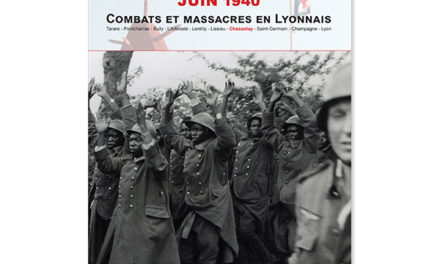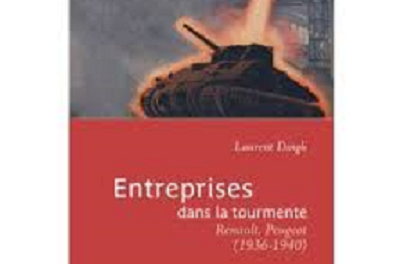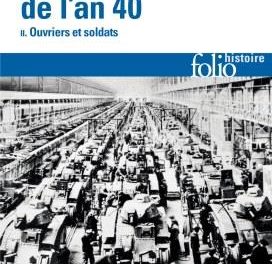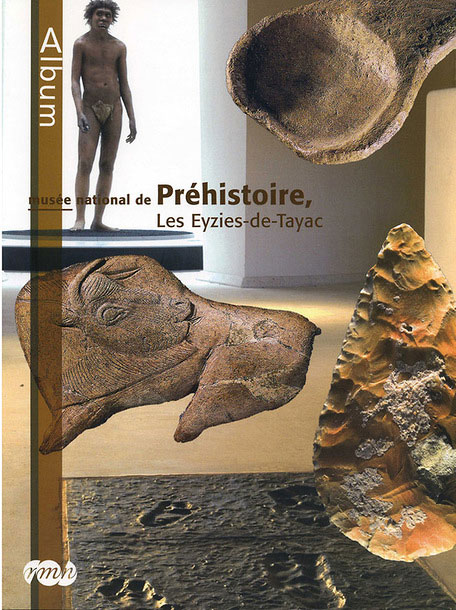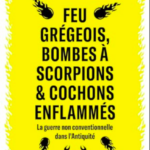C’est sur le plan historique que j’émettrai des réserves, qui n’iront pas, bien au contraire, jusqu’à déconseiller l’usage du film en classe ; mais l’enseignant aura un rôle important à jouer pour que les élèves comprennent ce qui se passe et en tirent de claires leçons. Tout d’abord, les propos des historiens, en vertu d’une mode qui tend à envahir les documentaires, sont hachés menu et aucun raisonnement n’est jamais développé. Sur le point le plus fondamental, l’attitude de Paul Reynaud, on passe sans transition d’une phrase de Roussel à une de Jeanneney, mais seul le premier prétend que Reynaud était un « homme de la Troisième République » qui laissait s’éterniser les discussions, ne trouvait pas anormal d’abriter dans son gouvernement les tendances les plus variées et tolérait même, en temps de guerre, des désaccords de fond sur la poursuite du combat, notamment entre le gouvernement et le commandement. On voit classiquement un « parti de l’armistice » guidé par Pétain et Weygand monter comme une marée et emporter une digue à la fin ; une digue de gens qui auraient trouvé on ne peut plus naturelle la poursuite de la guerre en Afrique du Nord. De tous les poncifs classiques un seul nous est épargné, celui d’un Reynaud courageux le jour mais affaibli la nuit par une Dalila nommée Hélène de Portes, sa compagne. Non moins naturelle serait la continuation de la guerre par l’Angleterre seule. Tout cela reste bien proche des mémoires de Churchill, intéressés à tenir ce discours pour reprendre le pouvoir aux travaillistes en 1951, en exhibant un parti conservateur en ordre de bataille. Il n’empêche que celui-ci s’était gravement divisé en mai et juin 1940, non moins dramatiquement que le gouvernement français et sur les mêmes enjeux –et qu’une différence abyssale entre les personnalités et les orientations des deux chefs de gouvernement expliquait en grande partie la divergence du résultat. Il convient donc d’introduire dans le débat l’image que pouvait donner, à Bordeaux, l’Angleterre, à la lumière notamment des divisions qu’avait pu observer Reynaud à Londres même, le 26 mai. Quelques publications récentes peuvent y aider, par exemple le Fateful Choices d’Ian Kershaw (2007) et les Mémoires de Roland de Margerie (2010).
En ce qui concerne le camp français, on peut noter une certaine hypertrophie du rôle de Laval et de la « commune de Bordeaux » qu’il est censé animer avec le maire de l’endroit, Adrien Marquet ; elle sera surtout active les jours suivants, pour empêcher les départs vers l’Afrique du Nord dans la période (du 17 au 21 juin) où Hitler prend un malin plaisir à faire attendre ses conditions d’armistice. On peut notamment regretter l’absence de toute allusion à un propos de Weygand, « dans trois semaines l’Angleterre aura le cou tordu comme un poulet », peut-être apocryphe, en tout cas mal situé dans le temps et dans l’espace, mais résumant fort bien l’horizon d’attente des milieux favorables à l’armistice (un point longuement développé dans un télégramme à Roosevelt de son ambassadeur Bullitt, qui vient de confesser la plupart des dirigeants de Vichy, le 1er juillet 1940 –cf. Bullitt (Orville), For the President, Londres, André Deutsch, 1972, P. 481-487).
Dans le générique final on est surpris, d’une part, de ne pas trouver un mot sur les historiens sollicités et leurs ouvrages, d’autre part de ne pas voir apparaître la mention d’un consultant historique. On s’explique mieux dès lors une grave bévue initiale mais heureusement unique, l’attribution à Pétain du titre de ministre de la Défense et non de vice-président du conseil.
En résumé : une belle idée, une réalisation inégale.