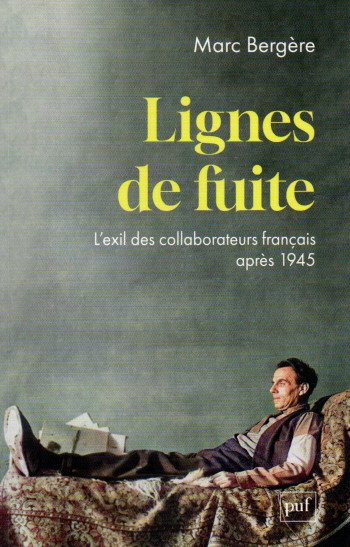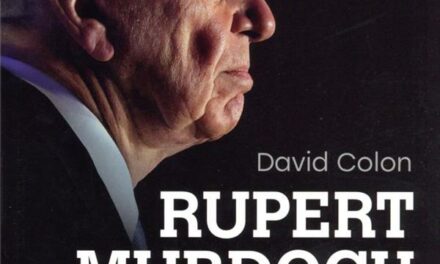Voilà un travail de recherche universitaire aux très nombreuses références (plus de 500 notes et quinze pages de sources et bibliographie). Néanmoins l’ouvrage est très clairement structuré et la démarche toujours explicitée. Il se compose de trois parties inégales La première et la plus longue (140 pages) traite de l’exil des collaborateurs et collaborationnistes français à l’étranger. La seconde concerne celles et ceux qui se cachèrent en France (50 pages). La troisième partie intitulée « L’écriture comme refuge » traite d’abord du vaste domaine de la littérature de témoignage : celle des collaborateurs en fuite et de leurs soutiens, puis celle de leur descendants et sympathisants ; enfin l’auteur explore un terrain aux frontières de la littérature et de l’histoire, en étudiant l’œuvre littéraire de Michel Mohrt. La lecture de cet ouvrage tout à fait accessible est d’autant plus agréable que de nombreux profils de collaboratrices et collaborateurs fugitifs sont présentés, rendant les situations très concrètes, les personnalités vivantes et les enjeux politiques et judiciaires tout à fait abordables. On y trouvera si on le souhaite d’innombrables références littéraires… et bien des motifs de colère contre ceux qui n’ont rien compris et n’ont cessé de se poser en victimes, tout en bénéficiant des largesses amnistiantes de la République !
Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Rennes 2, auteur d’une thèse de doctorat sur l’épuration en Maine-et-Loire, Marc Bergère s’est imposé au fil de ses recherches et de ses publications comme un éminent spécialiste de l’histoire de l’épuration en France. Il a notamment publié Une société en épuration. Épuration vécue et perçue en Maine-et-Loire de la Libération au début des années 50, version remaniée de sa thèse de doctorat, Presses universitaires de Rennes, 2004 ; Vichy au Canada. L’exil québécois de collaborateurs français, Rennes/Montréal, PUR/PUM, 2015 et L’épuration en France, PUF, collection « Que-sais-je ? », 2018, 2e édition, 2023. Il est aussi le co-auteur de Pour une histoire connectée et transnationale des épurations en Europe après 1945, Peter Lang, 2019 et de Une poignée de misérables. L’épuration de la société française après la Seconde Guerre mondiale, Fayard, 2003, sous la direction de Marc-Olivier Baruch.
Des collaborateurs français exilés à l’étranger
Combien ?
« On peut raisonnablement estimer qu’ils ont été entre 15 000 et 25 000 à se regrouper dans le sud de l’Allemagne » à la fin de l’été 1944, avec notamment 6 000 miliciens accompagnés de 4 000 membres de leurs familles et 5 000 PPF avec leur entourage. Sigmaringen devient, jusqu’à la capitulation, la nouvelle capitale de cette « France allemande ». Puis c’est « de nouveau la débandade ». Et il devient très difficile pour l’historien de donner des chiffres car les exilés cherchent à ne pas se faire repérer ! Marc Bergère peut affirmer qu’ils seront « plusieurs centaines d’individus installés au moins pour un temps » en Espagne, Italie, Suisse et Argentine, destinations majeures de l’exil, « quelques dizaines d’individus seulement » au Canada et en Irlande. « La prétention à toute exhaustivité en matière de comptage serait vaine et illusoire »
Où vont-ils ?
« Ce chapitre (Les routes de l’exil) se propose d’établir une première synthèse, inédite en l’état, de l’exil politique des collaborateurs français au sortir de la Seconde Guerre mondiale. S’appuyant sur des travaux de référence déjà disponibles pour certaines destinations, telles la Suisse, l’Irlande , l’Espagne ou encore le Canada, il repose également sur une exploitation systématique d’archives diplomatiques relatives aux « réfugiés politiques » français de l’après-guerre, en particulier à partir des fonds des postes diplomatiques français en Argentine, en Belgique, au Canada, en Espagne, en Italie », ainsi que sur le dépouillement des travaux de diverses commissions d’enquêtes dans les années 1980-1990.
Les destinations premières sont les pays voisins, Italie, Espagne, Suisse. Dans un second temps, les fugitifs gagnent des destinations plus lointaines, Irlande, Canada, Argentine. Ils affluent en Italie, et particulièrement dans un premier temps dans les régions du Trentin et du Haut-Adige. Anciens nazis et collaborationnistes arpentent les rues de Merano, Bolzano et Trente. Rome n’est pas en reste, présence du Vatican oblige : « Toutes les études convergent aujourd’hui pour faire de Rome une véritable plaque tournante de l’exfiltration des nazis et collaborationnistes européens ». On en trouve aussi à Gênes et à Naples, qui veulent prendre le bateau pour l’Espagne, l’Afrique ou l’Amérique du Nord. On trouve en Espagne plusieurs grands noms de Vichy et de la collaboration : Abel Bonnard, Louis Darquier de Pellepoix, le général Bridoux… Certains d’entre eux déjà installés durant les années précédentes, comme en Suisse ou se trouve Jean Jardin, ex-chef de cabinet de Laval. Il peut rencontrer d’autres dignitaires de Vichy, tels René Belin, Jacques Benoit-Méchin, ou des intellectuels. D’autres vont plus loin : 100 à 200 sont accueillis à bras ouverts en Argentins, moins nombreux sont ceux qui gagnent le Québec, tandis que les militants bretons optent pour l’Irlande, imaginant une fraternité celtique qui ne sera pas au rendez-vous. On peut encore trouver des nostalgiques de Vichy et du Reich en Belgique, au Brésil, en Bolivie, au Danemark si l’on pense à Louis-Ferdinand Céline qui ne cesse de geindre contre les persécutions que la France lui infligerait.
Par quelles filières parviennent-ils à fuir ?
Ils ont bénéficié de réseaux « plus ou moins clandestins ». Se procurer de faux papiers suppose une certaine logistique. Ils ont pu trouver des « complicités actives ou passives au cœur même de nos services diplomatiques ». Le rôle de l’Eglise catholique est avéré, qu’il s’agisse du Vatican ou du clergé régulier (dominicains londoniens et bénédictins irlandais aident les Bretons, l’abbaye de Solesmes et celles d’En-Calcat jouent un rôle actif), et séculier. Églises, couvents, foyers, œuvres caritatives, institutions ont constitué une « chaîne de solidarité ecclésiastique efficace ». L’aide objective ne fait aucun doute, mais le devoir d’asile est souvent évoqué. La cavale de Marcel Déat et de son épouse s’appuie sur une chaîne de communautés religieuses. Frappé par la grâce, il se convertit et meurt en bon chrétien.
De quel accueil bénéficient-ils ?
Il existe « une vaste constellation de soutiens » pour ceux qui sont considérés comme des « réfugiés politiques » par ceux qui partagent leurs choix politiques et idéologiques. Franquistes et catholiques intégristes en Espagne, l’historien Robert Rumilly, « un homme de droite farouchement contre-révolutionnaire » eu Canada français, divers comités de soutien et d’entraide Argentine, en Suisse, et un peu partout. Avec la guerre froide qui arrive, l’anticommunisme est un excellent motif pour aider celles et ceux qui auraient combattu le communisme avec un peu d’avance et davantage de clairvoyance ! La Commission pontificale d’aide aux réfugiés joue un rôle fondamental, pour les nazis et pour les collaborateurs. Elle permet aux fugitifs d’obtenir un passeport de la Croix-Rouge internationale, puis les exfiltre vers l’Espagne ou l’Argentine. Le cardinal Tisserand, déclaré à titre posthume en 2021, « Juste parmi les nations » joue un rôle actif dans l’exil des collaborateurs vers l’Argentine ; comme l’écrit Marc Bergère, « les voix du Seigneur sont impénétrables ».
Des connivences gouvernementales complètent les collusions ecclésiastiques : c’est particulièrement net pour l’Espagne de Franco et l’Argentine de Peron, « véritables sanctuaires pour les nazis et autres collaborateurs de même acabit ». Franco fait verser d’importantes rentes mensuelles à plusieurs d’entre eux, les plus importants dignitaires vichystes recevant des traitements de ministres !
Refont-ils leur vie en exil ?
« Leur histoire apparaît d’emblée comme une expérience à la fois familiale, sociale et politique ». Même si les fugitifs et les fugitives (les femmes constituent une part notable de l’effectif mais le phénomène a été peu étudié) partent seuls, les couples se reconstituent et les familles aussi. Mais il arrive aussi que les couples se séparent et que des vies se refassent. L’épouse et le fils de Joseph Darnand optent pour l’exil en Italie puis en Argentine. « L’exil est souvent l’occasion de refaire sa vie, ou plutôt de la recomposer sur d’autres bases ; nouvelles relations, adultère, divorce ». Darquier de Pellepoix s’affiche en Espagne avec une nouvelle maîtresse qui lui donne une fille… avant que son épouse légitime ne le rejoigne. Dans d’autres cas la famille est séparée par l’exil, mais des relations fortes et régulières sont maintenues malgré la distance. Des femmes ont pris le chemin de l’exil politique du fait de leur propre engagement. La plupart ont quitté la France pour l’Allemagne avec les convois de la Milice et du PPF, souvent avec leur conjoint.
Si au début beaucoup de ces réfugiés doivent se contenter de modestes emplois, assez vite les plus diplômés s’intègrent dans un milieu professionnel qui leur ouvre des relations sociales : médecins, intellectuels, militaires, policiers, journalistes, ingénieurs, curés. Des solidarités professionnelles fortes fonctionnent : « Entre purs, on se donne la main » dira l’un d’eux.
Ils demeurent nostalgiques de Vichy, contempteurs de la France républicaine et efficaces relais du négationnisme naissant
« La dénonciation de l’épuration et de ses excès est immédiatement au cœur d’une contre-mémoire portée par les épurés et leur entourage unis dans une double communauté de vaincus et, plus encore de victimes. » Ils utilisent la presse réactionnaire des pays d’accueil, ou créent leurs propres revues et journaux, pour dénoncer le bain de sang de l’épuration en France, entretiennent le souvenir de Vichy (à Lausanne se crée une association des amis de Robert Brasillach) et le culte du Maréchal (surtout en Espagne), affirment à longueur d’article leur antisémitisme et leur anticommunisme.
Maurice Bardèche, beau-frère de Brasillach, qui n’est pas inquiété et épouse le parti de la collaboration après la Libération, entreprend de relativiser les crimes nazis et reçoit un très large accueil au sein des milieux collaborationnistes français réfugiés en Suisse et en Argentine. Fort de sa notoriété, il fonde à Paris en 1951 Défense de l’Occident et publie en 1954 la traduction d’un article allemand (« Le mensonge des six millions ») qui remet en cause l’extermination des Juifs. « Le milieu des réfugiés politiques français constitue très vite un terreau favorable à la diffusion des premières théories négationnistes. » Interrogé par L’Express en 1978, Darquier de Pellepoix, ex-commissaire général aux Questions juives entre 1942 et 1944 « se livre à une diatribe féroce où il laisse libre cours à sa haine des Juifs et à la négation du génocide ». « Cette prise de position stupéfiante et décomplexée dans les colonnes d’un grand hebdomadaire libère la parole d’un courant révisionniste (…) qui se tenait en embuscade. » Etrangers à toute forme de repentir, ils s’estiment « victimes d’une machination antichrétienne, communiste et juive », selon l’expression de Jacques de Bernonville, ancien milicien, ancien Waffen SS, condamné à mort en France, installé au Québec, et finalement assassiné au Brésil en 1972. « Ils ne regrettent rien et veulent pouvoir le dire. »
Quelques-uns néanmoins souhaitèrent réintégrer la communauté nationale. Marc Bergère montre que des affectations dans l’empire colonial servirent de « purgatoire » Une grâce suspensive permit à certains de partir combattre en Indochine ; d’autres furent affectés dans les filiales ultramarines des entreprises dans lesquelles ils étaient employés. Le groupe L’Oréal, dont le fondateur avait financé la Cagoule, recycle de nombreux anciens collaborateurs dans ses filiales à l’étranger, ainsi Jacques Corrèze ou Jean Azéma. Georges Simenon, « un opportuniste plus suspect que coupable », assigné à résidence en Vendée puis bénéficiaire d’un classement sans suite, quitte la France pour l’Amérique où il reste dix ans. Ceux qui revinrent le firent au début des années 1950, après l’adoption des lois d’amnistie de 1951 et1953, puis dans les années 1960-1970, lorsqu’intervint la prescription des poursuites principales.
Se cacher en France ?
Les complots d’anciens « collabos » : une menace surestimée
L’auteur présente « le complot des soutanes » : en 1947 des ecclésiastiques séculiers et surtout réguliers sont accusés de cacher d’anciens collaborateurs condamnés. Les faits sont prouvés, des arrestations sont effectuées, mais l’affaire est instrumentalisée par la presse communiste, ce qui suscite une vive réaction de la presse catholique. Le père Riquet, authentique résistant de la première heure, déporté, intervient en chaire et adresse une lettre ouverte au président du Conseil Ramadier, le 21 mars 1947.
Trois mois plus tard, le ministre de l’Intérieur dénonce dans la presse un nouveau « complot contre la République ». Il s’agit du « Plan bleu », un projet de prise du pouvoir dont les auteurs seraient d’anciens collaborateurs alliés à des résistants communistes (on sent le parfum de guerre froide). Une cinquantaine de prévenus se retrouvera devant le tribunal correctionnel en 1949. La plupart étant d’anciens résistants, le ministre de l’Intérieur se voit accusé d’avoir dénoncé un complot imaginaire. On évoque alors la question des « maquis blancs » et des agents infiltrés de l’Abwehr.
L’exil intérieur
Les 15 000 à 20 000 condamnées et condamnés à des interdictions de séjour et à des interdictions de résidence, par les cours de justice et par les chambres civiques se voient de fait condamnés à un exil intérieur. C’est une sanction massive et durable, qui frappe un individu et touche souvent toute une famille. La mesure incite quelques-uns, particulièrement audacieux ou protégés, à changer d’identité et à refaire leur vie sous une nouvelle fausse identité. Marc Bergère présente quelques cas d’imposteurs, dignes de romans policiers. Un bon mariage permet à certaines femmes de faire oublier leur nom. La Légion étrangère offre la même solution, dans des conditions plus dures à coup sûr.
Marc Bergère présente des cas de vies clandestines qu’il qualifie « hors normes », qui sont stupéfiantes. Ainsi Jacques Vasseur, dont Dominique Jamet fit un personnage de roman en 2008. Condamné à mort par contumace en 1945, il vécut reclus chez sa mère pendant 17 ans. Arrêté par hasard en 1962, il fut de nouveau condamné à mort en 1965, gracié par De Gaulle, incarcéré et libéré en 1983 : il fut le dernier collaborateur français libéré. « Plus connue mais tout aussi improbable reste la longue cavale du milicien Paul Touvier entre 1945 et 1989. » Il bénéficia de l’aide constante du clergé et du soutien de sa famille, ses enfants ayant toujours pris le parti de leur père tortionnaire, qui ne renia aucun de ses engagements et voulut absolument obtenir une grâce, qui, comme le dit l’auteur « précipita sa disgrâce ». Absolument hors norme, le cas d’Esther Albouy, la « tondue de Saint-Flour » qui vécut 38 ans de réclusion volontaire dans sa maison. Lorsque le GIGN donna l’assaut au domicile le 20 octobre 1983, ce qu’il découvrit dépassait l’entendement : « Esther et son frère Hubert vivent dans un véritable taudis, sans eau ni électricité, au milieu d’immondices et avec le cadavre « habillé et enfermé dans un duvet » de leur frère Rémi, décédé plus de trois ans auparavant mais toujours sur son lit dans une pièce voisine ». Le frère et la sœur avaient sombré dans une forme de folie qui leur faisait percevoir le monde extérieur comme une menace. Marc Bergère présente le cas de cette pauvre femme, qui ne fut guère collaboratrice, qui fut violée et harcelée et finalement tondue.
L’écriture comme refuge
« La mémoire en marge des vaincus de la Libération »
« Les récits véhiculés par les exclus de la Libération participent grandement à l’élaboration d’une véritable légende noire de l’épuration ». Les anciens collaborateurs épurés se posent en victimes. De 1944 à 1947, leurs écrits sont confidentiels et clandestins le plus souvent. Mais dès 1948 on publie plus d’ouvrages d’anciens collaborateurs que de témoignages d’anciens résistants et déportés ! Relayés par des revues et des maisons d’édition spécialisées dans les écrits d’extrême droite, en France ou en Suisse (Le Cheval ailé), quelques ouvrages atteignent de gros tirages, 50 000 exemplaires pour les « mémoires » de Pierre Laval présentés par René de Chambrun et 10 000 pour le Journal de la France d’Alfred Fabre-Luce.
« D’abord porté par les épurés eux-mêmes, ce courant éditorial trouve assez vite ses prolongements dans la littérature qui lui apporte aussi une vitalité nouvelle », ainsi Uranus de Marcel Aymé en 1948. Puis ce sont de jeunes écrivains de droite qui dénoncent « l’escroquerie de la résistance », le bain de sang de l’épuration, et affirment leur aversion pour la France libérée : les « hussards » que sont Roger Nimier, Antoine Blondin, Michel Déon et Jacques Laurent. Jacques Chardonne et Paul Morand se refont une virginité, et ce dernier entre sous la Coupole.
« Ainsi se forge une mémoire qui s’érige contre les représentations dominantes du moment et qui, à ce titre, peut aussi être lue comme une contre-mémoire de la Résistance, voire comme un premier horizon de « réécriture de l’histoire » récente (…) Cette mémoire affirme que le pays fut toujours fidèle au Maréchal et que ceux qui ont servi Vichy n’ont donc pas trahi. » On met sur le même plan la Libération à la Terreur, la guerre des maquisards à celle de la Milice, le sort des épurés et celui des Juifs, Drancy qui interne des épurés en 1944 et Buchenwald en 1943… et il se trouve des résistants authentiques pour appuyer ce discours : Bruckberger, André Mutter, Rémy.
Puis vient la prise de parole, et de plume, des enfants et des petits-enfants d’épurés. L’ouvrage de Marie Chaix, Les Lauriers du lac de Constance, publié en 1974 autour de la trajectoire de son père, le cadre du PPF Albert Beugras, eut une influence déterminante, en ouvrant la voie à nombre de témoignages plus ou moins romancés. Au début des années 2000 des écrivains installés abordèrent le sujet, Frédéric Vitoux, Dominique Jamet, Emmanuel Carrère, Alexandre Jardin. Le spectre des attitudes possibles va de l’adhésion à la cause parentale au rejet brutal. « Par cette quête de compréhension, ils montrent que leurs parents ne peuvent rester indéfiniment des proscrits et qu’ils appartiennent bien désormais à une histoire nationale commune. C’est en ce sens que ces écrits, quoi que l’on pense des choix des intéressés, contribuent à les réintégrer dans la mémoire collective. »
« Michel Mohrt, ou l’écriture comme patrie intérieure »
C’est le titre du dernier chapitre de l’ouvrage. La problématique n’est pas d’un accès aisé, surtout si l’on n’a pas lu l’œuvre prolifique (36 ouvrages publiés entre 1943 et 2002) de cet auteur plutôt méconnu, distingué deux fois par l’Académie française, avant d’être élu en son sein en 1985. Michel Mohrt est un homme de droite, qui publia dans la presse vichyste et collaborationniste des articles non politiques, non inquiété à la Libération, mais qui choisit l’exil au Québec puis aux Etats-Unis, puis revint en France en 1952. Il fait carrière chez Gallimard, il est aussi critique littéraire et cinéma au Figaro et décède en 2011.
Ses romans oscillent entre autobiographie et autofiction et Marc Bergère s’y intéresse pour les trois hèmes centraux qu’il y trouve : « La défaite comme traumatisme originel, la guerre civile et son cortège de réprouvés, l’engagement et l’exil comme échappatoires possibles ». Le monde le déçoit, il n’a pas le courage de l’engagement, il choisit donc la fuite dans l’exil. Mais cette émigration peut être intérieure, le refus de voter en est la traduction. Marc Bergère termine son chapitre par un extrait du discours de réception de Michel Mohrt à l’ Académie française, écrit et prononcé par Jean D’Ormesson : « Anarchiste de droite et même d’extrême droite de son propre aveu, tour à tour exilé volontaire aux Amériques et émigré de l’intérieur en France ayant fait le choix de l’écriture comme refuge ultime, Michel Mohrt aura incarné par sa vie et plus encore à travers son œuvre littéraire les grandes figures de l’exil des vaincus de la Libération. Un camp plus perçu que vécu comme le sien mais auquel il s’est immédiatement identifié dans l’événement comme dans sa postérité. »
« Le pardon sans l’oubli » ?
Dans les dernières lignes de l’épilogue, Marc Bergère s’interroge à propos d’une expression de Jean-Marc Théolleyre dans le journal Le Monde où il était chroniqueur judiciaire, qui se demandait si l’on pouvait accorder à ces anciens collaborateurs « le pardon sans l’oubli ». Et voici ce qu’il écrit : « Concernant l’oubli, le métier d’historien et ces « lignes de fuite » sont en soi une réponse. S’agissant du pardon, le plus troublant à l’issue de cette étude reste l’absence de remords ou de repentir de la plupart de nos candidats à l’exil. Mieux, on l’a vu, ces foyers de réfugiés politiques disséminés par le monde vont constituer les premiers incubateurs du révisionnisme. Même si l’on ne peut exclure un effet de sources, dont il est toujours périlleux d’interroger les silences, il n’apparaît pas établi que l’exil ait été vécu par le plus grand nombre comme une voie de rédemption. »